|
Quelques objets matériels traditionnellement
associés à la mort en croix de Jésus-Christ ont suscité pendant des
siècles une
fascination sur le monde chrétien. La question de leur authenticité a
donné
lieu à de vifs débats, ainsi d'ailleurs que le sens à donner à leur
vénération.
On présentera ici rapidement deux exemples en s'interrogeant sur leur
crédibilité historique.
Qu'est
devenue la Vraie Croix ?
Une tradition bien établie
affirme
que c'est la mère de l'empereur Constantin, sainte Hélène, qui exhuma
les
restes de la croix véritable de Jésus sur les lieux-mêmes de sa
crucifixion. En 325, Hélène partit en
pèlerinage pour la Terre Sainte. A Jérusalem, sur les lieux présumés du
Calvaire, elle fit détruire le temple de Vénus bâti par Hadrien et se
mit en quête
des reliques de la Passion. Ses recherches furent apparemment
couronnées de succès,
puisque la plupart des objets de l'exécution auraient été retrouvés à
cette occasion.
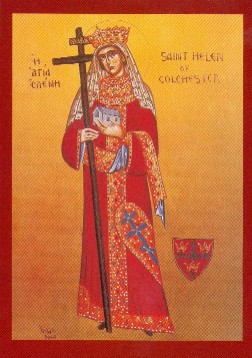
Icône anglaise
contemporaine représentant
sainte Hélène en possession de la vraie
Croix
(stcome.avignon.free.fr).
Les
circonstances de l' "invention" de la vraie croix (au sens
de sa redécouverte, selon le vocabulaire de l'époque) sont rapportées
dans un
texte écrit en 395 par l'évêque saint Ambroise de Milan. Il écrivit
qu'Hélène
aurait retrouvé les trois croix dans une ancienne citerne, et que pour
reconnaître celle du Christ elle aurait exhumé également l'inscription
:
"Jésus de Nazareth, roi des Juifs" [1] :
"Elle
commença par visiter les Lieux saints ;
l’Esprit lui souffla de chercher le bois de la croix. Elle s’approcha
du
Golgotha et dit : « Voici le lieu du combat ; où est la victoire ? Je
cherche
l’étendard du salut et ne le vois pas. » Elle creuse donc le sol, en
rejette au
loin les décombres. Voici qu’elle trouve pêle-mêle trois gibets sur
lesquels la
ruine s’était abattue et que l’ennemi avait cachés. Mais le triomphe du
Christ
peut-il rester dans l’oubli ? Troublée, Hélène hésite, elle hésite
comme une
femme. Mue par l’Esprit-Saint, elle se rappelle alors que deux larrons
furent
crucifiés avec le Seigneur. Elle cherche donc la croix du milieu. Mais,
peut-être, dans la chute, ont-elles été confondues et interverties.
Elle
revient à la lecture de l’Evangile et voit que la croix du milieu
portait
l’inscription : «Jésus de Nazareth, Roi des Juifs». Par là fut terminée
la
démonstration de la vérité et, grâce au titre, fut reconnue la croix du
salut".

Reliquaire contenant quatre fragments de la
Croix,
dans la collégiale Sainte-Croix de Liège
(fabrice-muller.be).
Des faits similaires
sont rapportés à la même époque par le théologien saint Jean
Chrysostome, ainsi
que par l'écrivain chrétien Rufin d'Aquilée ; celui-ci attribue
cependant l'identification
de la croix du Sauveur à un miracle de guérison qui aurait eu lieu à
son
contact. Plus tard, au XIIIème siècle, Jacques de Voragine expliqua
dans sa
"Légende Dorée" que l'emplacement de la croix fut révélé par un Juif
nommé Judas qui se convertit au christianisme et prit le nom de
Quiriace.
Le destin de la vraie croix est semblable à celui de
beaucoup d'autres
reliques. Découpée en trois parts, elle fut encore fragmentée en de
multiples
morceaux qui furent distribués à de nombreux bénéficiaires, au point
que d'innombrables
reliques reposent aujourd'hui dans des églises du monde entier. Il
existe dans
nos régions des fragments conservés dans des sanctuaires tels que la
basilique Saint-Cernin de Toulouse, l'église copte de Sarcelles,
l'hospice de
Baugé en Anjou, la collégiale Sainte-Croix de Liège [2][3]
...
Au Moyen Age, le
nombre d'églises prétendant posséder des reliques de la vraie croix
était tel qu'il suscita des
doutes croissants quant à leur authenticité. Pourtant, l'ensemble des
fragments
encore existants ne représente pas une quantité excessive par rapport à
ce
qu'aurait pu être une croix du Ier siècle.

Reliquaire
d'un fragment de la
vraie Croix,
conservé à Saint-Cernin de Toulouse
(E.
Revault - pmaude.free.fr).
|

Un autre
reliquaire contenant
un
fragment de la Croix,
forme à l'origine de la croix de
Lorraine
(chris.burtin.chez-alice.fr).
|
La sainte tunique
d'Argenteuil
Un tissu de couleur rouge sombre,
aujourd'hui conservé dans la basilique Saint-Denys d’Argenteuil, passe
pour être
un vêtement qui aurait été porté par Jésus de Nazareth, et précisément
le jour
de son exécution. Les informations disponibles concernant cette relique
rendent son authenticité plus ou moins
crédible.
Deux versets de
l'évangile de Jean font référence à ce tissu, en évoquant le vêtement
que se
partagèrent les soldats romains au moment de la crucifixion (Jn. 19,
23-24) :
"Quand les soldats eurent crucifié
Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour
chaque
soldat. Ils prirent aussi la tunique ; mais la tunique était sans
couture,
tissée d'une seule pièce de haut en bas. Ils se dirent donc entre eux :
"Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui l'aura." Ainsi
s'accomplirait cette parole de l'Ecriture : Ils se sont partagé mes
habits et
ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats".
Les
témoignages ultérieurs concernant l'histoire de
cet objet sont assez épars. Il aurait été retrouvé lui aussi par sainte
Hélène
au IVème siècle. On retrouve sa trace en 590 à Joppé, chez un Juif
nommé Simon,
puis à Jérusalem, puis à Constantinople. En 803, l'empereur Charlemagne
déposa
l'objet dans le monastère de sa fille à Argenteuil, ville où il est
demeuré
jusqu'à nos jours [4][5].

La Tunique
d'Argenteuil,
visible dans sa
châsse
(anagogie.online.fr).
|

La Tunique
d'Argenteuil, sortie de sa châsse
(catholique95.com).
|
L'objet
a été plus ou moins bien conservé et présente
d'importantes dégradations. Aujourd'hui conservée dans une châsse de la
basilique d'Argenteuil, la relique possède des caractéristiques à
première vue compatibles
avec le récit de la Passion. Tissée dans une sorte de laine teinte en
brun-rouge, elle est effectivement d'un seul morceau, sans couture. Des
taches
sombres sur l'épaule et le dos pourraient correspondre à des taches de
sang
dues à une flagellation et au transport d'un lourd fardeau [6].
Des études
scientifiques minutieuses ont été effectuées à partir de 1882, moins
poussées
toutefois que celles du Linceul de Turin. En 1892, le chimiste P. Lafon
et le
pharmacien J. Roussel confirmèrent que ces taches sombres étaient bien
du sang.
Plus récemment, en 1985, le docteur hématologue Saint-Prix identifia le
groupe
sanguin AB, le même que sur le Linceul de Turin. Le professeur Gérard
Lucotte,
généticien au Centre de Neurogénétique Moléculaire de Paris, fit
également une
analyse de l'ADN de ce sang et conclut qu'il appartenait à un Juif du
Proche-Orient. Enfin, une étude pollinique réalisée en 2003 permit
d'établir
que sur dix-huit sortes de pollens recueillies sur la tunique, deux
espèces ne
se trouvaient qu'en Palestine.

La basilique
Saint-Denis à Argenteuil
(journeesdupatrimoine.culture.fr).
|

La Tunique
d'Argenteuil
(leparisien.fr).
|
En octobre
2003,
une analyse de datation au radiocarbone fut effectuée par le
Laboratoire des
mesures du carbone 14 de Saclay. Là aussi, le résultat fut décevant
pour les
pélerins qui y croyaient : il donnait une gamme de dates comprises
entre
530 et 650 de notre ère. On en déduisit que cet objet n'était pas
d'époque et
que c'était probablement un faux.
Le résultat de
cette datation fut contesté, et justifia une seconde campagne de
mesures. Celle-ci
fut effectuée à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et donna une
fourchette de dates proche de la précédente :
de 670 à 780 ap. J.-C..
Dans les deux cas, la méthodologie fut remise en question. Le
docteur
Marie-Claire Van Oosterwijck, auteur d'une importante étude sur le
Linceul de
Turin, expliqua que la technique de nettoyage utilisée avant l'analyse
était
sans doute inefficace, car le traitement chimique appliqué n'avait pas
dû éliminer
la totalité de la pollution organique [7].
Un colloque
scientifique organisé à Argenteuil en 2005 par le Comité Œcuménique et
Scientifique de la Sainte Tunique d'Argenteuil (COSTA), résuma les
résultats de
ces travaux. Ses membres prirent position pour l'authenticité, et
formulèrent
deux groupes de conclusions : d'une part, les taches sont bien
constituées de
sang, et d'autre part, l'analyse au radiocarbone est erronée [8].
Que conclure à
propos de l'origine de cet
objet ? Là aussi, les résultats de la datation au radiocarbone ne vont
pas dans
le sens des autres études effectuées. La mesure du carbone 14 ne peut
être
fiable que si l'échantillon analysé est exempt de pollution, condition
peut-être
plus difficile à garantir pour un tissu que pour un morceau de bois
compact.
Comme dans le cas du Linceul de Turin, il n'y a pas de consensus autour
des résultats
des travaux scientifiques réalisés sur la tunique d'Argenteuil.
Le Titulus Crucis
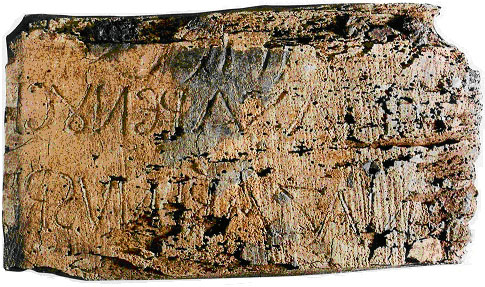
Le Titulus Crucis
(zeably.com).
Une
autre relique intéressante est une planchette de bois exposée dans la
basilique
Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome, le Titulus
Crucis,
qui ne serait rien moins qu'un morceau de l'écriteau fixé sur la
croix du Christ au Golgotha ... L'objet aurait été rapporté de Terre
sainte, toujours
par sainte Hélène, et conservé ensuite dans une chapelle de son palais
à Rome, plus tard transformée en église puis élevée en basilique.
Longue
de vingt-cinq centimètres, la planchette porte trois lignes d'écriture
gravées en
araméen, en grec et en latin. L'inscription est composée des lettres
suivantes
:
...
ΝΑΖΑΡΕΝΥΣ
Β
US
NAZARENUS RE
Bien
que la première ligne fût très fragmentaire, l'historienne Maria-Luisa
Rigato a
tenté une reconstitution des lettres hébraïques. Elle proposa de lire :
"Jeschu
nazara m m", expression
abrégée qui peut signifier : "Jésus Nazara, votre roi". Les
deux autres lignes comportaient des fragments probables des mots
"Jésus",
"nazaréen" et "roi".
En
1998, des examens des
styles d'écriture furent effectués par plusieurs paléographes
israéliens et par
l'écrivain allemand Michael Hesemann. Ceux-ci datèrent l'objet du Ier
siècle,
résultat qui fut confirmé par le paléographe Carsten Peter Thiede et
par Maria-Luisa
Rigato. Cependant, une analyse au radiocarbone faite en 2002 par
l'université
de Rome indiquèrent que le Titulus Crucis
ne pouvait remonter qu'au XIème siècle
[9]. Dès lors, suivant l'avis de Maria-Luisa
Rigato, la plupart des chercheurs en conclurent qu'il pouvait s'agir
d'une
copie conforme du véritable écriteau de la Passion.
Autres objets
La liste des reliques associées à
la mort de Jésus-Christ recèle encore bien des artéfacts dont on ne
donnera ici
qu'un bref aperçu. Une couronne d'épines conservée dans la cathédrale
Notre-Dame de Paris est considérée comme celle ayant coiffé le condamné
au
Golgotha. Plusieurs "clous de la Passion" qui auraient transpercé ses
membres sont conservés dans des reliquaires, notamment à Notre-Dame de
Paris, à
Florence, à Tèves et à Monza en Lombardie. Un autre de ces clous,
curieusement
transformé en mors de cheval, repose dans la cathédrale Saint-Siffrein
de
Carpentras. Un tissu conservé à Oviedo en Espagne passe pour être le
suaire qui
aurait recouvert son visage dans le tombeau, en complément du Linceul
de Turin.
S'il
est souvent difficile d'attester de l'authenticité de tel ou telle
relique,
celle-ci est quelquefois appuyée par des témoignages de particuliers
qui leur
attribuent des vertus miraculeuses. Cependant il convient de se garder
d'un
attachement excessif à l'aspect matériel de ces objets de vénération.
L'essentiel
du message de Jésus-Christ est ailleurs, et consiste avant tout en une
démarche
de nature spirituelle et humaine.
Références :
|