|
Le miracle
supposé de la Résurrection de Jésus-Christ est mentionné
dans les quatre évangiles mais n'est pas décrit directement : il est
seulement
évoqué à travers les témoignages des personnes qui auraient revu
l'homme
vivant. Le premier est celui de trois femmes, parmi lesquelles se
trouvait
Marie-Madeleine, qui s'étant rendues auprès du tombeau le matin de
Pâques dans l'intention
d'embaumer le corps, auraient trouvé la sépulture vide. A la place du
corps elles
auraient vu deux anges leur annoncer la Résurrection du défunt ;
Marie-Madeleine aurait alors reconnu Jésus lui-même en la personne du
jardinier, lui demandant de retourner témoigner de son retour à la vie.
Ce
fut ensuite au tour des apôtres de constater le
fait. Ceux d'entre eux qui se déplacèrent également jusqu'à la tombe
déclarèrent
n'avoir trouvé que les bandelettes et le suaire. Mais Jésus se
manifesta plusieurs
fois auprès d'eux, d'abord sur la route d'Emmaüs, puis dans une salle
de
Jérusalem où ils s'étaient tous réunis, puis encore au bord du lac de
Tibériade
où il leur fit faire une pêche miraculeuse. Il demeura auprès de ses
disciples
jusqu'au jour de son Ascension céleste.
La
Résurrection évoquée par
Flavius Josèphe
Les autres livres du Nouveau Testament reconnaissent comme une
vérité de foi le retour du Christ à la vie après sa mort et son
inhumation. Mais
contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Bible n'est pas le seul
document de l'époque à faire état de cet évènement.
On trouve en effet des allusions à ce miracle dans
les oeuvres
de l'historien Flavius Josèphe, composés à la fin du Ier siècle.
Plusieurs de
ses écrits font référence à l’histoire de Jésus et au fait qu'il ait
été
exécuté et qu'il ait ensuite repris vie.
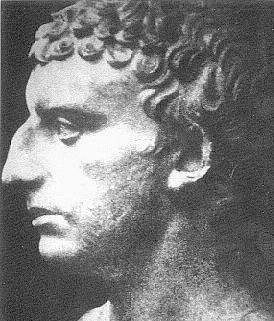
Buste
supposé de
Flavius Josèphe
(livius.org).
| 
Page
d'un
exemplaire médiéval
des écrits de Josèphe
(collectionscanada.ca).
|
L'un
de ses ouvrages intitulé les "Antiquités
judaïques" et écrit vers 93 contient un passage appelé le Testimonium
flavianum (témoignage flavien) qui disserte sur un personnage
"sage" nommé Jésus et qui est revu vivant après son exécution. La
version rapportée ci-dessous nous est transmise par l'évêque Eusèbe de
Césarée
(265-340) dans son "Histoire ecclésiastique". L'authenticité de
certains passages est mise en doute par plusieurs érudits actuels
(termes
discutés figurant entre parenthèses) [1] :
"En ce temps-là paraît
Jésus, un homme
sage, (si toutefois il faut l'appeler un homme, car) ; c'était un
faiseur
de prodiges, un maître des gens qui recevaient avec joie la vérité. Il
entraîna
beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs ; Celui-là était le
Christ.
Et quand Pilate, sur la dénonciation des premiers parmi nous le
condamna à la
croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment ne cessèrent pas. (Car il
leur
apparut après le troisième jour, vivant à nouveau ; les prophètes
divins
avaient dit ces choses et dix mille autres merveilles à son sujet).
Jusqu'à maintenant
encore, le groupe des chrétiens (ainsi nommé après lui) n'a pas
disparu"
(Antiquités Judaïques 18 / 63-64).
Bien que le
passage explicite sur la Résurrection soit susceptible d'être un rajout
tardif, il existe d'autres versions très semblables du même texte de
Josèphe qui contiennent également le passage sur le retour de Jésus à
la vie. Celle de l'évêque
Agapios de
Hiérapolis en Syrie au Xème siècle, écrite en arabe, a été redécouverte
en 1971
par le professeur israélien Shlomo Pinès. Nous le retrouvons aussi dans
la
chronique de Michel le Syrien, qui fut patriarche jacobite d'Antioche
au XIIème
siècle.
Une autre
œuvre littéraire de Josèphe, "La guerre des Juifs", rédigée vers 79
et consacrée au récit de la première révolte juive, parle également de
Jésus et
des premiers chrétiens. La première version grecque de ce
livre est
perdue, mais on a retrouvé en 1905 une version en vieux russe (slavon)
qui
désigne Jésus sous le terme de "thaumaturge", c’est-à-dire d'auteur
de miracles.
Cette source fait elle aussi référence à la Résurrection :
”Si
quelqu'un s'écartait de la lettre de la
Loi, le fait était révélé aux docteurs de la Loi. On le mettait à la
torture,
et on le chassait ou bien on l'envoyait à César. Et sous ces
procurateurs
apparurent de nombreux serviteurs du thaumaturge déjà décrit, et ils
disaient
au peuple que leur maître était vivant, bien qu'il fût mort : “ Et il
vous libérera
de la servitude.” (Guerre des Juifs, texte Slavon, 2 / 221).
Dans
l'hypothèse où les passages contestés seraient authentiques, question
qui
n'est pas tranchée, tous ces documents permettraient de supposer que
Josèphe a
réellement eu
connaissance de ce fait. On peut au minimum admettre que les écrits de
Flavius
Josèphe sont les plus anciens documents connus qui font référence à la
vie de
Jésus-Christ.
Emmaüs-Nicopolis
Sur
le terrain archéologique, outre le tombeau du Christ lui-même, il
existe un
autre lieu biblique indissociablement lié au récit de la Résurrection.
C'est
le village d'Emmaüs, vers lequel deux de ses disciples se dirigeaient
lorsqu'il
leur apparut vivant. Il fit route avec eux, mais ne se fit reconnaître
qu'à
une courte
distance du village, au moment où ils allaient se restaurer. A cet
instant il
disparut de leurs yeux ; les deux disciples retournèrent alors à
Jérusalem pour
rendre compte de leur vision (Lc. 24, 13-27).
Le
site traditionnel d'Emmaüs, appelé encore Nicopolis ou Amwas, se trouve
à 30
kilomètres à l'ouest de Jérusalem sur la route de Tel-Aviv. La
localité
est ancienne, et son nom figure dans des documents bibliques tels que
le
Ier livre
des Macchabées, au IIème siècle av. J.-C..

Routes
reliant Jérusalem à Emmaüs-Nicopolis
(emmaus-nicopolis.org).
Au
IIIème siècle de notre ère, Emmaüs devint une ville et reçut le statut
de
"polis", sous le nom de Nicopolis. L'époque byzantine vit la
construction d'une basilique et d'un important complexe
ecclésiastique chrétien sur le lieu
supposé de
l'apparition de Jésus. Lors de la conquête musulmane, Emmaüs reprit son
ancien nom
sémitique d'Amwas. Au temps des croisades, une nouvelle
présence
chrétienne y fit bâtir une église médiévale.

La
basilique byzantine d'Emmaüs-Nicopolis
(fr.wikipedia.org).
| 
Le
baptistère d'Emmaüs-Nicopolis
(fr.wikipedia.org).
|
Identifié à
nouveau au XIXème siècle à l'Emmaüs biblique par l'archéologue
américain Edouard
Robinson,
Amwas fut l'objet d'une série de campagnes de fouilles menées par
plusieurs
équipes successives dont les pères franciscains et dominicains. Les
murs de
l'église croisée du XIIème siècle étaient encore visibles à côté des
restes
de l'ancienne. La basilique byzantine livra de splendides mosaïques
polychromes, ainsi qu'un remarquable baptistère en forme de croix
creusé dans
le rocher. On découvrit également des tombes juives du Ier siècle et
des
éléments romano-byzantins, parmi lesquels figuraient des inscriptions
lapidaires.
Cependant
l'identification du site n'est pas encore
totalement reconnue, car d'autres villages du même secteur sont
également
candidats pour s'apparenter à l'Emmaüs biblique : Ha-Motsa, Qoubeïbé et
Abou
Gosh .
L'argument avancé est qu'ils sont plus proches de Jérusalem qu'Amwas.
Le débat
n'est toujours pas clos, d'autant plus qu'un élément d'un autre ordre
s'est
rajouté en faveur d'Amwas. Que l'on y prête crédit ou non, une
religieuse
carmélite, Mariam Baouardi de Bethléem, affirma en 1878 avoir reçu des
révélations à
caractère mystique au cours desquelles Jésus lui aurait indiqué que le
site
d'Amwas était bien l'Emmaüs du Nouveau Testament.

Plan de la basilique
(emmaus-nicopolis.org).
| 
Mosaïque
byzantine
(rc.net).
|
|