|
Le
livre des Actes des Apôtres, qui succède aux
quatre évangiles, relate les évènements qui se sont déroulés
immédiatement après
l'Ascension. Il est sans doute du même auteur que l'évangile de Luc,
puisqu'il
s'adresse en préambule au même destinataire, un certain Théophile. La
tradition
assimile l'évangéliste Luc à un médecin grec qui aurait rencontré saint
Paul au
cours de ses missions.
Les Actes
des Apôtres,
première partie
Le texte revient
en détail sur l'Ascension, puis enchaîne sur l'histoire des disciples
après
Jésus. Ceux-ci nommèrent d'abord un nouvel apôtre, Matthias, pour
remplacer
Judas qui s'était donné la mort. Puis ils décrit l'expérience mystique
qu'ils vécurent le jour de la Pentecôte, fête juive traditionnelle des
moissons
célébrée cinquante jours après Pâques.
Jésus leur avait
annoncé l'intervention prochaine d'un "Défenseur", ou Esprit-Saint,
source spirituelle de l'inspiration nécessaire pour perpétuer son
oeuvre. Les
apôtres étaient réunis dans la chambre haute de Jérusalem, lorsqu'ils
perçurent
le souffle d'un violent coup de vent, suivi par l'image d'une grande
flamme
apparaissant sous le plafond et se posant sur leurs têtes.
Dès
cet instant ils furent animés d'un zèle missionnaire et d'une
éloquence qui ne les quittèrent plus. Quelques passants attirés par le
bruit les
trouvèrent en train de discourir sur la mission divine de Jésus,
prononçant des
paroles compréhensibles dans toutes les langues.

La
Pentecôte, icône grecque
(addisabram.wordpress.com).
Les apôtres se
rendirent ensuite dans le Temple où ils dissertèrent pareillement sur
la
mission divine de Jésus le Messie. Mal reçus par les prêtres juifs, ils
furent
arrêtés et jetés en prison ; rapidement relâchés, ils continuèrent à
parler
inlassablement à la foule tout en opérant eux-mêmes des miracles. Leurs
paroles
eurent un succès croissant et suscitèrent de nombreuses conversions. Un
jeune baptisé
nommé Etienne le paya de sa vie, en étant pris à parti et lapidé par
des Juifs restés
fidèles à la tradition. Sa mort fut le signal de la première
persécution.
La plupart des
disciples de Jésus échappèrent aux poursuites en quittant Jérusalem,
sans pour
autant cesser de diffuser la nouvelle foi. Cela ne se fit pas sans
heurts : un
Juif nommé Saul (ou Paul) et originaire de Tarse combattit violemment
la
doctrine des apôtres. Sur la route de Damas où il cheminait pour y
procéder à des
arrestations, il eut une apparition aveuglante de Jésus-Christ qui
l'invitait à
se convertir. Saul reçut le baptême et devint par la suite l'un des
plus
fervents missionnaires.
La nouvelle
doctrine continuait à se propager sur la terre d'Israël. En Samarie,
les
miracles des apôtres dépassèrent ceux d'un magicien nommé Simon. Sur le
chemin
de Gaza, l'apôtre Philippe rencontra un fonctionnaire juif d'Ethiopie
qu'il
baptisa. Pierre se rendit à Joppé où il ressuscita une femme qui venait
de
décéder.
Hébergé chez un corroyeur nommé Simon, il eut ensuite la vision
mystique d'un drap rempli de nourriture et accompagné d'un message
énigmatique concernant
la pureté rituelle. L'interprétation qu'il en donna était que le
baptême
pouvait également être accordé aux païens, impurs aux yeux des Juifs ;
la question
se posait à propos d'un centurion romain nommé Corneille, qui reçut dès
lors le
sacrement. Pierre rentré à Jérusalem convainquit ses frères de la
portée
universelle de la révélation évangélique, qui n'était désormais plus
réservée
aux seuls Juifs.

La Palestine au temps
des Actes des Apôtres
(nthci.org).
Une nouvelle
persécution éclata cependant sous le règne d'Hérode Agrippa, roi de
Judée. Le monarque tua par l'épée l'apôtre Jacques, frère de Jean, et
fit
arrêter Pierre. L'apôtre fut cependant délivré de sa prison par un ange
qui lui
ouvrit les portes en pleine nuit pendant le sommeil de ses gardiens. Le
roi Hérode quant à lui mourut brutalement à la
suite d'un malaise pendant une cérémonie publique.
Une
importante communauté de disciples de Jésus s'était constituée dans
la ville d'Antioche, où le mot "chrétien" fut prononcé pour la
première fois. C'est de là aussi que saint Paul et son disciple Barnabé
partirent pour leurs premiers voyages missionnaires à l'étranger.
Ces récits qui
occupent la première moitié du livre des Actes, trouvent quelques
correspondances
dans l'Histoire et sur le terrain. Le
contexte politique se réfère au règne d'Hérode Agrippa Ier, qui
gouverna
l'ensemble du territoire hébreu de 41 à 44. Flavius Josèphe confirme sa
mort
brutale survenue en public, alors que la foule venait de le diviniser à
cause
de ses vêtements étincelants. Il fut à l'instant frappé de violentes
douleurs abdominales qui
l'emportèrent au bout de cinq jours (Ant. judaïques XIX).
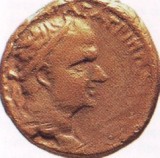
Monnaie à l'effigie du
roi
Hérode Agrippa Ier
(bible-people.info).
Traces de
l'Eglise primitive à
Jaffa
Sur la terrasse
d'une habitation de Joppé, l'apôtre Pierre aurait eu la vision d'un
drap rempli
de nourriture alors qu'il était hébergé par un certain Simon, tanneur
de
profession (Act. 10).
Aujourd'hui
la ville de Jaffa, l'ancienne Joppé, est implantée sur la
Méditerranée au sud de l'actuelle Tel Aviv et en continuité avec elle.
Jaffa
possède un port typique ainsi que d'agréables ruelles étroites qui
occupent une
colline dominant la plage. Plusieurs monastères médiévaux se cachent
derrière ses
murs de pierre ocre, et une église baroque dédiée à Saint-Pierre a été
construite au XVIIème siècle. Jaffa est aussi connue par la désastreuse
épidémie
de peste qui y ravagea l'armée de Napoléon Bonaparte en 1799.
Des fouilles
effectuées à Jaffa entre 1955 et 1974 par l'archéologue municipal Jacob
Kaplan ont
révélé des traces de l'antique cité, l'occupation humaine s'échelonnant
du
néolithique à la période actuelle. Les indices d'une présence
égyptienne se remarquent
en particulier par les fragments d'un portail de pierre marqué au nom
de Ramsès
II.
 Vue
aérienne de Jaffa
(scriptures.lds.org).
Vue
aérienne de Jaffa
(scriptures.lds.org).
L'épisode
de la vision de Pierre pourrait trouver
sa place dans une maison de village, encore considérée aujourd'hui
comme celle de Simon
le tanneur. Cette habitation
qui a sans doute été remaniée depuis l'Antiquité est bâtie pratiquement
en
surplomb de la plage. Du côté de la rue, une entrée percée dans un mur
est la
seule partie aujourd'hui visible de cette propriété privée.
Un aperçu de l'intérieur de ce patrimoine est cependant fourni par
quelques photographies centenaires, qui montrent une petite cour
comprenant un
puits, un lavoir et un escalier montant vers une terrasse. Qui sait si
ces
aménagements n'ont pas servi dans l'Antiquité à alimenter un atelier de
cordonnerie, et si cet escalier n'est pas celui qu'emprunta saint
Pierre pour
accéder à la terrasse ? Rien ne permet de l'affirmer, mais à première
vue
l'emplacement de cette demeure peut correspondre à celui de la maison
du
tanneur Simon évoquée dans les Actes des apôtres.

L'entrée de la maison
de Simon le tanneur
(flickr.com).
| 
Cour intérieure de la maison
de Simon le tanneur
(israelimages.com).
|
L'essor de
l'Eglise d'Antioche
Une autre
localité a également joué un rôle important dans l'expansion du
christianisme naissant
: Antioche-sur-Oronte. Implantée dans l'est de l'actuelle Turquie près
de la frontière
syrienne, la cité occupait à l'époque romaine une place de premier
plan. Capitale
de la province de Syrie, elle ne comptait pas moins d'un demi-million
habitants
et constituait la troisième ville de l'empire après Rome et Alexandrie.
Ce fut
aussi un centre spirituel important au tout début du christianisme. La
communauté
chrétienne d'Antioche ne devait pas cesser de croître au cours des
premiers
siècles de notre ère.
Ce qui reste de
l'antique cité d'Antioche est partiellement recouvert par l'actuelle
ville d'Antakya,
dont le terrain a été partiellement fouillé entre 1932 et 1939 par une
équipe
franco-américaine associant la faculté de la Sorbonne à l'université de
Princeton. Les chercheurs ont dégagé sur les rives de l'Oronte une
partie de
l'ancienne cité et notamment un rempart, un aqueduc, un hippodrome, un
temple
et un palais impérial, sans compter une vingtaine d'églises
paléochrétiennes.
Dans cette
dernière catégorie est classé un site qui présente un intérêt
particulier. Il
s'agit d'une grotte connue sous le nom d'église Saint-Pierre, et
creusée dans
le flanc de la colline bordant la limite est de la ville. Cet abri
naturel
passe pour être l'une des plus anciennes églises rupestres du monde,
car la
tradition locale soutient que les premiers disciples du Christ s'y
retrouvaient
et s'y réfugiaient au moment des persécutions.
 L'entrée de l'église
Saint-Pierre à Antioche
(sacred-destinations.com).
L'entrée de l'église
Saint-Pierre à Antioche
(sacred-destinations.com).
C'est là que se
seraient déroulées plusieurs réunions évoquées dans les Actes des
apôtres, et c'est
là que Paul et Barnabé auraient annoncé leurs départs en mission (11,
19-30 ;
13, 1-3). Une légende locale affirme encore que la grotte aurait été
aménagée par
saint Pierre en personne, conformément à l'épître aux Galates (2,11)
d'après
laquelle il se serait rendu à Antioche.
Au
temps des apôtres, l'entrée du site n'était qu'un passage discret
creusé dans le rocher. Les Croisés le transformèrent au Moyen Age en
une prestigieuse
façade en maçonnerie, que l'on peut franchir aujourd'hui pour pénétrer
dans une
vaste caverne. Sous sa voûte naturelle soutenue par de larges piliers,
trônent
un simple autel en maçonnerie et un vieux siège de pierre. Des traces
de
fresques et de mosaïques sont encore visibles sur les parois et le sol.
A
gauche de l'autel, une ouverture creusée dans la paroi conduit via un couloir étroit à une seconde
sortie dissimulée d'un autre côté de la colline. Sans doute cette
galerie était-elle
une sortie dérobée permettant aux occupants de s'échapper en cas
d'alerte.

L'autel de l'église
Saint-Pierre
(sacred-destinations.com).
| 
L'intérieur
de l'église
Saint-Pierre
(sacred-destinations.com).
|
Le destin
des douze apôtres
A partir du
chapitre 12 du livre des Actes, le récit du parcours de Pierre et des
onze autres
disciples s'interrompt pour laisser la place aux voyages de Paul. Ce
qu'il
advint des apôtres ne figure pas dans la Bible ; seules quelques
informations extérieures
nous sont parvenues indirectement.
Au XIIIème
siècle, le moine et évêque de Gènes Jacques de Voragine réalisa à
partir de documents
alors disponibles un ouvrage de synthèse sur l'histoire des apôtres et
des premiers
saints. Sous le nom de "Légende dorée", cette compilation tirée de
documents
aujourd'hui disparus connut un grand succès et constitue encore une
source littéraire
précieuse.
On
trouve dans la "Légende dorée" des renseignements sur les voyages
d'évangélisation entrepris par les douze apôtres, qui se seraient
dispersés
dans le monde pour y fonder des églises. De l'Inde à l'Espagne, de
l'Ethiopie à
la mer Noire, les disciples du Christ Jésus prêchèrent la "bonne
nouvelle" avec un zèle infatiguable, se heurtant souvent aux cultes
païens
ou juifs. La plupart d'entre eux le payèrent de leur vie dans des
conditions
cruelles, le paradoxe étant que les circonstances héroïques de leurs
martyres
favorisèrent encore davantage la diffusion de leur message.
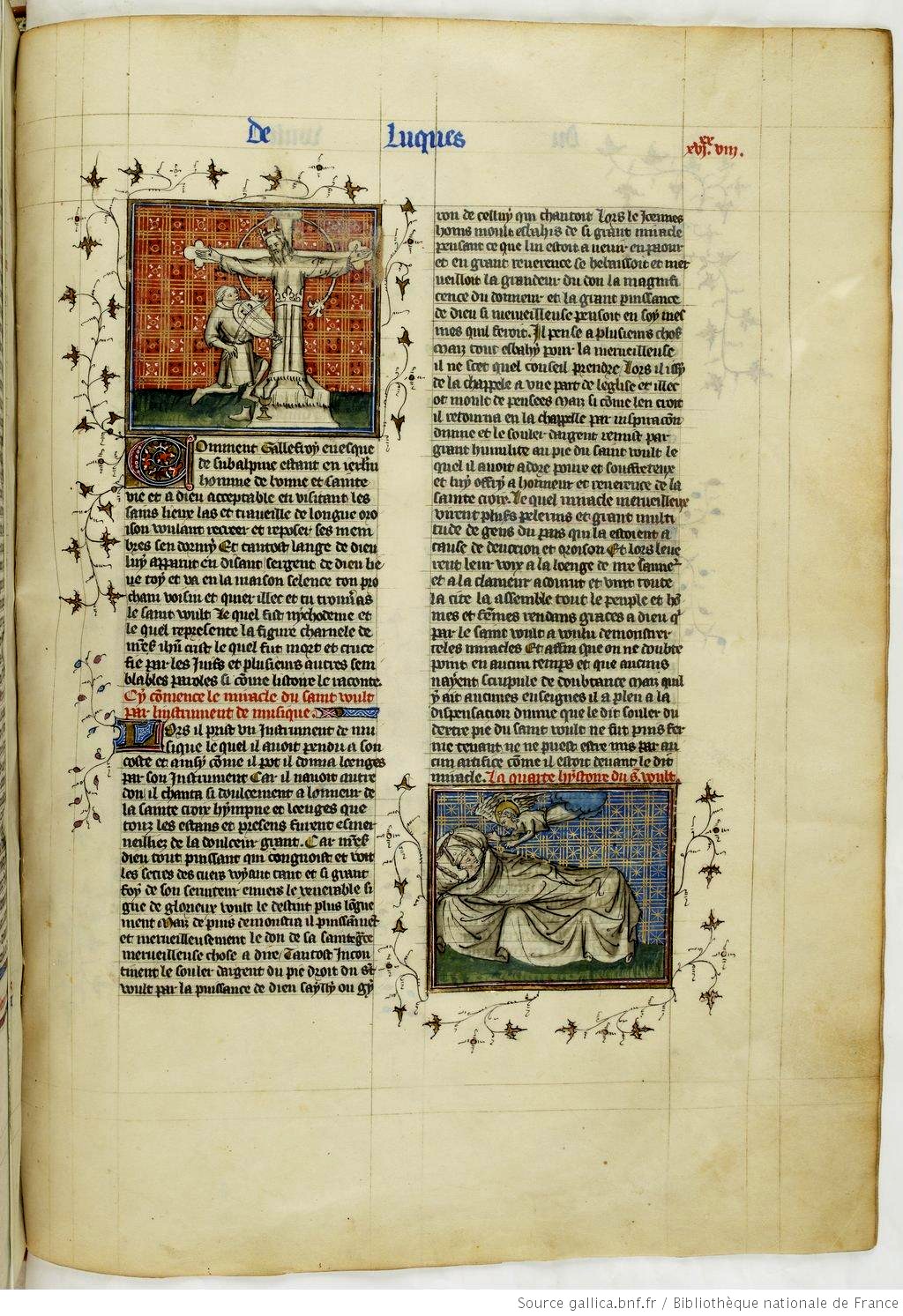 Un
exemplaire médiéval
de la Légende dorée de Jacques
de Voragine
(gallica.bnf.fr).
Un
exemplaire médiéval
de la Légende dorée de Jacques
de Voragine
(gallica.bnf.fr).
Ainsi apprend-on
que Pierre se rendit à Rome pour y vaincre le magicien Simon, et qu'en
représailles l'empereur Néron le fit crucifier la tête en bas. De même,
Jacques
dit "le Majeur", fils de Zébédée et frère de Jean, séjourna en
Espagne puis devint à son retour le premier évêque de Jérusalem où il
fut
décapité. André, après un voyage autour de la mer Noire, fut arrêté en
Grèce et
mourut sur une croix en forme de X. Matthieu partit évangéliser
l'Ethiopie où
il fut assassiné après avoir célébré une messe. Le seul apôtre non
martyr
serait l'apôtre Jean, évangéliste et auteur supposé de l'Apocalypse.
Les
autres apôtres moins connus furent également victimes de leur zèle
missionnaire. Thomas et Barthélemy partirent pour l'Inde où ils furent
tués, le
premier d'un coup de lance et le second écorché vif puis décapité.
Jacques
"le Mineur", fils d'Alphée, prêcha dans plusieurs pays et finit
crucifié en Egypte. Philippe aurait prêché en Asie Mineure et serait
mort à
Hiérapolis par lapidation ou crucifixion. Simon et Thaddée (ou Jude)
partirent
annoncer l'Evangile en Mésopotamie et en Perse, où ils furent égorgés
dans un
temple païen [2].

L'ancienne tombe de
saint Pierre à Rome
(standrewwbo.blogspot.fr). | 
La tombe de saint Jacques à Compostelle
(gnostictemplars.org). |
Des
traditions locales relatives à la mémoire des apôtres se mêlent parfois
à
des éléments archéologiques. Ainsi le tombeau de saint Pierre a-t-il
été
retrouvé à Rome en 1940 dans le sous-sol de la basilique pontificale.
De même
l'Espagne honore-t-elle la traditionnelle sépulture de l'apôtre Jacques
le
Majeur, dont la redécouverte légendaire au IXème siècle fut faite à la
suite de
l'apparition d'une étoile miraculeuse au-dessus du champ où la tombe
était
dissimulée. Le lieu-dit du "champ de l'étoile", campus
stella en latin, est peut-être à l'origine du nom de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Mais
sait-on que l'Inde vénère à Mylapore un tombeau de l'apôtre Thomas,
et que son squelette presque complet est actuellement conservé à Ortona
en
Italie ? Sait-on que cette tombe est en outre associée à une curieuse
stèle
gravée d'une croix et qui avait l'étrange réputation de saigner au
XVIème
siècle [3][4] ? Est-on
informé que la sépulture de saint Philippe a
été découverte en 2011 à Pamukkale, l'ancienne Hiérapolis, dans les
ruines
d'une basilique byzantine ? De nombreuses tombes de saints ont ainsi
été
retrouvées sur les lieux supposés de leurs martyres.
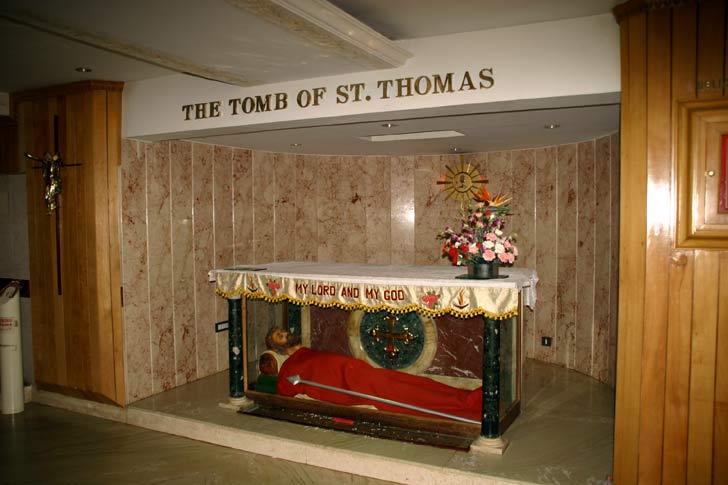
L'ancienne tombe de
saint Thomas à Mylapore
(backpackers-around.com).
| 
La
stèle de saint Thomas
(usf.usfca.edu).
|
L'ossuaire de "Jacques,
frère de Jésus"
C’est
le lieu d’évoquer l'existence
d’un objet qui fut révélée en 2002 et dont l’authenticité a suscité un
grand
débat. Un collectionneur de Tel Aviv montra un jour à l'épigraphiste
français
André Lemaire un ossuaire antique gravé d'une courte inscription en
araméen. Le
spécialiste français traduisit celle-ci sans difficulté de la manière
suivante : "Jacques, fils de
Joseph, frère de Jésus". D'après le style des lettres,
l'inscription
paraissait authentique et semblait dater du premier siècle.
Du
fait que les noms des personnages cités pouvaient désigner Jésus de
Nazareth et
sa famille, le déchiffrement de cette inscription fit grand bruit dans
les
médias et déclencha une vive controverse. L'objet pouvait apparaître
comme une
preuve de l'existence historique de Jésus-Christ ; mais en même
temps
l'hypothèse qu'il ait eu un frère pouvait mettre en doute le dogme
catholique
de la virginité de Marie. L'apôtre Jacques est certes présenté comme
son
"frère" dans le Nouveau Testament, mais la contradiction est
habituellement résolue par le sens du mot parfois utilisé pour désigner
un
cousin.
Un
colloque de spécialistes réuni à Toronto à propos de cet objet vit se
dérouler
des débats houleux. Le propriétaire affirmait avoir acheté l'ossuaire à
un
antiquaire de Jérusalem, selon lequel il proviendrait d'un caveau du
quartier
arabe de Silwan, au sud du mont des Oliviers.

L'ossuaire
de Jacques
(en.wikipedia.org).
| 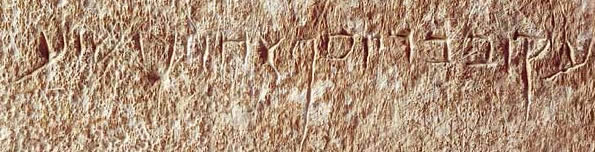
L'inscription
de l'ossuaire de Jacques
(abu.nb.ca).
|
D'autres
chercheurs estimaient que l'objet était authentique, mais que
l'inscription ne l'était pas. Pour trancher la question, l'Institut de
géologie
israélien effectua alors une étude minéralogique des impuretés
incrustées dans
les lettres gravées : il conclut à l'ancienneté réelle des
inscriptions.
Mais inversement, une analyse isotopique de l'oxygène de la même patine
montra
des anomalies à mettre sur le compte d'une couche d'impuretés rajoutée
artificiellement ... Les résultats des examens étaient donc
contradictoires [5][6].
En
fait, le propriétaire de l'ossuaire était déjà soupçonné d'activités
frauduleuses et de contrefaçon d'antiquités. Une enquête officielle
démasqua un
réseau de faussaires, et révéla un atelier de fabrication d'objets
"bibliques" qui aurait fonctionné pendant plus de vingt ans. Il
apparut dès lors que l'ossuaire de Jacques en était vraisemblablement
une
production [7][8].
Le
problème de la contrefaçon sur le marché des antiquités n'est pas
nouveau, et
la recherche historique doit parfois faire appel à des expertises
pointues.
L'un des critères est le suivi de l'origine des objets, la prudence
s'imposant
lorsqu'ils ne proviennent pas de fouilles de terrain ouvertement
déclarées.
L'énigme de
l'église de Rihab
De
nouveaux indices parlant de la naissance du
christianisme se révèlent de temps à autre sous la truelle des
archéologues.
Dans le Nord de la Jordanie par exemple, la petite ville de Rihab
a livré
en 2008 les ruines d'une église à classer elle aussi parmi les plus
anciennes
du monde [9][10][11].
Les fouilles
dirigées par le docteur Abdul Qader al-Husan, du centre d'études
archéologiques
de Rihab, ont d'abord permis de dégager au niveau du sol les ruines
d'une
église byzantine consacrée à Saint-Georges. Quelques bases de murs
émergeant
des dunes de sable entourent des fragments de piliers et de motifs
finement
sculptés qui représentent des croix et des rosaces. Le sol est
recouvert d'une
splendide mosaïque, en parfait état, dans laquelle se lit une
inscription grecque
au pied des marches du chœur. Le texte occupe six lignes et rend
hommage à
"soixante-dix divins bien-aimés de Dieu".
On ignore
véritablement à quel groupe de personnes cette inscription fait
référence. Il
pourrait s'agir du cercle plus large des soixante-dix disciples de
Jésus cités dans
l'Evangile de Luc (10, 1-24). La suite de l'étude du site devait
fournir une
réponse plus exacte.

L'église Saint-Georges
à Rihab en Jordanie
(johnsanidopoulos.com).
| 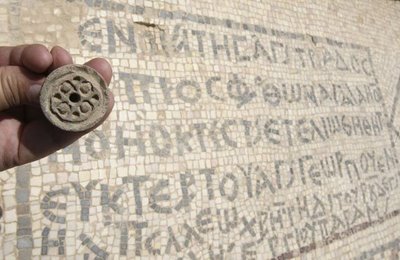
L'inscription de
l'église Saint-Georges
(johnsanidopoulos.com).
|
A gauche de la
nef, quelques marches descendent vers une porte étroite donnant accès à
une
crypte. L'intérieur de cette cave est séparé en deux parties. Une
petite pièce à
peu près circulaire est entourée de sièges grossièrement taillés dans
la paroi.
Un mur la sépare d'un espace plus vaste, depuis lequel un profond
tunnel
conduit à une citerne et à une source d'eau.
Cette crypte située
en-dessous de l'église byzantine est vraisemblablement un ancien
sanctuaire
paléochrétien. La pièce circulaire serait l'ancienne abside, et la
grande salle
aurait servi de nef ou de lieu de refuge lors des persécutions.
Au niveau du
sol, un cimetière attenant a fourni des artéfacts permettant de dater
le site.
Des poteries dont les âges s'échelonnent du IIIème au VIIème siècles
ont donné
la date la plus ancienne, qui tourne autour de 230. Mais le docteur
al-Husan estime
que l'occupation de cette cave par des chrétiens a pu commencer encore
plus
tôt, dès le milieu du Ier siècle. Selon lui, les soixante-dix disciples
de
Jésus seraient venus séjourner à Rihab et auraient aménagé l'église
souterraine.
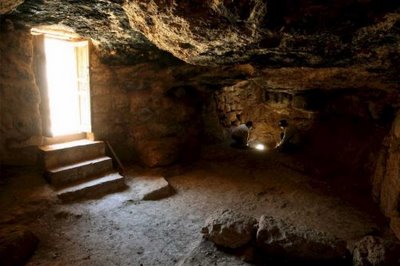
Le sous-sol de l'église
Saint-Georges
(johnsanidopoulos.com).
| 
Le sous-sol de l'église
Saint-Georges
(stmaterne.blogspot.com).
|
Cependant
une autre suggestion à été faite quant à l'identité des personnages
mentionnés par la mosaïque byzantine. John Sexton, étudiant de
l'Université de Biola, associe cette inscription à un vieux texte de
l'historien
Eusèbe de Césarée, d'après lequel un groupe de soixante-dix chrétiens
s'échappa
de Jérusalem assiégée lors de la révolte juive de 66-70, et se rendit à
Pella en
Jordanie [12]. Qui
sait si ces réfugiés n'auraient pas prolongé
leur fuite jusqu'à Rihab, située encore plus à l'Est que Pella ? Si tel
était
le cas, l'église Saint-Georges constituerait une trace du passage de
cette
communauté mentionnée par Eusèbe de Césarée.
Références :
[1] - J. Kaplan : "The Archaeology and
History of Tel Aviv-Jaffa".
The Biblical Archaeologist, Vol. 35, No 3 (Sep.
1972), pp.65-95.
[2] - J. de Voragine "La
légende dorée. Vie des douze apôtres". Librio, Paris 2004.
[3] - "The tomb of the saint". Thomas
the apostle (stthoma.com).
[4] - "Analogical
review on Saint Thomas Cross - The symbol of
Nasranis - Interpretation of the Inscriptions" (nasrani.net).
[5] - J. de Voragine : "La légende dorée. Vie
des douze apôtres". Librio, Paris 2004.
[6] - P.M. Raja (fr.) : ew Discovery on St. Thomas ». Joshua Williams Northwest
Nazarene College, 1995.
http://discoveryonstthomas.blogspot.fr/2011/11.
[7] - “Analogical Review on
Saint Thomas Cross - The symbol of Nasranis - Interpretation of the
Inscriptions”. NSC Network, 8/3/2009.
http://www.nasrani.net/2008/02/29/analogical-review-on-st-thomas-cross-the-symbol-of-nasranis.
[8] - F. D'Andria : “Conversion, Crucifixion and Celebration”. Biblical
Archaeology Review 37.4 (Jul/Aug 2011) : 34-46, 70.
http://members.bib-arch.org/publication.asp?PubID=BSBA&Volume=37&Issue=4&ArticleID=2.
[9] - "Archéologie : la première église
au monde découverte en Jordanie ?" Saint Materne, 11 juin 2008
(stmaterne.blogspot.com).
[10] - Y. Menissier : "Jordanie : on aurait
découvert la plus vieille église du monde" (fepef.com).
[11] - J. Sanidopoulos : "A First
Century Church in
Jordan ? "(johnsanidopoulos.com).
[12]
- J. Sexton : "Very Ancient Church Discovered in Jordan (updated photos)"
(verumserum.com).
|
|