|
En-dehors du groupe
des douze apôtres qui partirent diffuser le message de Jésus-Christ à
travers
le monde, d'autres disciples et parents de Jésus cités dans le Nouveau
Testament ont également quitté la Terre sainte et connu des destins
étonnants.
Tragiques ou non, leurs parcours sont rapportés dans la littérature des
premiers
siècles et l'historiographie chrétienne primitive.
Arrêtons-nous sur celui
d'une poignée
d'entre eux, à l'origine d'une tradition populaire établie dans le sud
de la
Gaule romaine : la barque des saintes Maries. Cette aventure et ses
implications dans l'Histoire de l'Occident chrétien méritent qu'on s'y
attarde.
Le récit figure dans la
Légende dorée de
Jacques de Voragine, composée au XIIIème siècle à partir de l'ensemble
des
documents alors disponibles, mais on le trouve également dans les
révélations mystiques
faites par la religieuse allemande Anne-Catherine Emmerich au XIXème
siècle.
Vers
l'an 45, une dizaine de
disciples de Jésus fuyant la persécution d'Hérode Agrippa se rendirent
à Joppé,
où ils furent pris par des Juifs hostiles à leur foi. On les condamna à
être
jetés dans une barque sans voile ni rames, et abandonnés en pleine mer
au large
de la Palestine.

Paroi abrupte de la montagne
de la
sainte-Baume, et
entrée
de la grotte où vécut sainte Marie-Madeleine
(la-provence-verte.net).
| 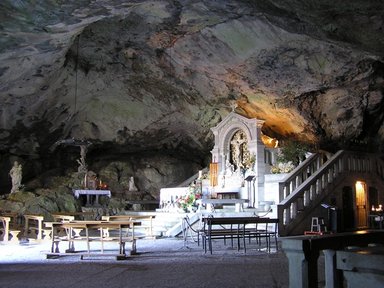
Intérieur de la grotte de
sainte Marie-Madeleine
(saintebaume.dominicains.com).
|
Dans cette frêle
embarcation se trouvaient plusieurs proches du Nazaréen, parmi lesquels
Marie-Madeleine, Marthe sa soeur probable, Lazare leur frère, Marie
Jacobé une
soeur de la Vierge, Marie Salomé la mère de deux apôtres et un certain
Maximin,
notable de Béthanie.
Les occupants de la barque livrée au hasard
des flots furent cependant sauvés par le souffle puissant d'un vent
providentiel,
qui les poussa jusqu'à la côte provençale de Camargue où ils
accostèrent sans
encombres ni pertes humaines. Ses occupants furent recueillis par des
bergers,
puis ils décidèrent de se séparer afin de prêcher l'évangile en des
lieux
différents du pays.
L'histoire de la Provence
traditionnelle est imprégnée des récits plus ou moins légendaires du
destin de
ces personnages. Marie-Madeleine prêcha quelques temps à Marseille aux
côtés de
Lazare, puis elle se retira dans une grotte de la montagne Sainte-Baume
où elle
vécut encore trente ans. Elle mourut dans la plaine où elle était
descendue à
la rencontre de Maximin.

Statues des saintes Marie Jacobé
et
Salomé dans une barque.
Basilique des Saintes-Maries-de-la-Mer
(herveda.free.fr).
| 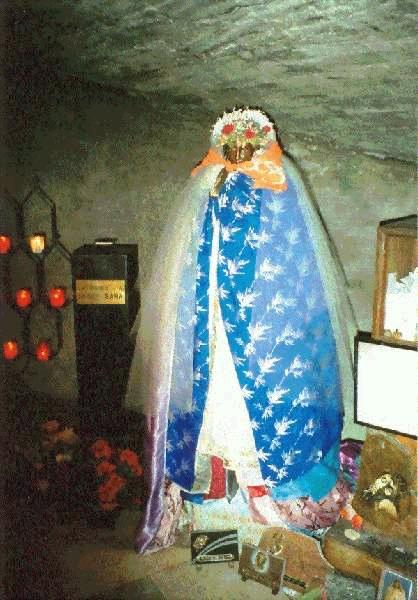
Statue de sainte Sara. Basilique
des Saintes-Maries-de-la-Mer
(herveda.free.fr).
|
Maximin fut le
premier évêque d'Aix-en-Provence ; il éleva un oratoire en l'honneur de
Marie-Madeleine à l'emplacement de sa mort et du futur village de
Saint-Maximin.
Les
autres passagers du navire
ont également leurs destins, encore gravés dans la mémoire locale.
Marthe
s'installa à Tarascon où elle combattit avec succès la "Tarasque", un
animal fabuleux qui dévorait ses habitants. Son frère Lazare
serait devenu
le premier évêque de Marseille, demeurant dans une grotte de la rive
sud du
lacydon jusqu'à ce qu'il soit arrêté, torturé et décapité. Enfin, les
deux
Marie Jacobé et Salomé seraient quant à elles demeurées en Camargue sur
le site
de l'actuel village des Saintes-Maries.
La
crédibilité historique de ces récits n'en finit
pas d'être débattue. Le cas le plus connu et qui présente le plus
d'intérêt
archéologique est peut-être celui de Marie-Madeleine, dont le parcours
est riche
en éléments concrets découverts à la suite de nombreuses recherches. A
sa mort,
la sainte fut enterrée dans la chapelle que Maximin lui avait édifiée.
Ses
reliques y demeurèrent jusqu'au temps de l'invasion de la Gaule par les
Sarrasins au VIIIème siècle, époque à laquelle sa tombe fut rendue
invisible
par des chrétiens qui craignaient une éventuelle profanation.

La
crypte de Saint-Maximin
(crc-resurrection.org).
Un texte du IXème
siècle attribué à Girart de Roussillon, fondateur de l'abbaye de
Vézelay, rapporte
que deux moines seraient venus chercher ses reliques en 745 ou 749 pour
les porter
à Vézelay. La version provençale dit pourtant que les ossements de la
sainte ne
quittèrent pas leur place de Saint-Maximin. Toujours est-il qu'après le
départ
des Sarrazins au Xème siècle, on avait perdu la trace des reliques de
Marie-Madeleine.
En 1254, le
roi de France saint Louis était
de retour d’une croisade, lorsqu'il fit un pèlerinage à la grotte de la
Sainte-Baume. Intéressé par l'énigme des reliques, il chargea son neveu
le comte
de Provence Charles II d'Anjou, de mener des recherches afin de
retrouver les
restes de la sainte. En 1279, Charles II fit donc une enquête et
entreprit des
fouilles près du village de Saint-Maximin où la mémoire locale les
situait.
Charles
d'Anjou explora l'ancien
monastère cassianite de Saint-Maximin qui renfermait quatre sarcophages
d'albâtre
vides. Il décida de creuser une tranchée profonde dans le sol. Son
intuition
était bonne, car il exhuma en effet un cinquième sarcophage de marbre
scellé. Lorsqu'on
en souleva le couvercle, une odeur suave s'en dégagea tandis que l'on
vit
apparaître les ossements en désordre d'un corps humain presque entier.
Etaient-ce ceux de la sainte Marie-Madeleine des évangiles ? L'examen
de
plusieurs indices allait permettre de le préciser.

Graffiti d'époque romaine tardive (Ve-VIe s.),
gravé sur une dalle de la crypte
(crc-resurrection.org).
Au milieu des
ossements était posé un vieux morceau de liège qui tomba en poussière
lorsqu'on
le manipula. Il cachait un petit fragment de papyrus, sur lequel une
inscription latine était inscrite, et qui pouvait se traduire par :
"L'an de la
Nativité 716, au mois de décembre, sous le règne d'Eudes, très pieux
roi des
Francs, au temps des ravages de la perfide nation des Sarrazins, très
secrètement et pendant la nuit, le corps de la très chère et vénérable
Marie
Madeleine, par crainte de ladite nation perfide, a été transféré de son
tombeau
d'albâtre dans celui-ci de marbre, car il y est plus caché, après en
avoir
enlevé le corps de Sidoine".
Le même cercueil contenait également
un
globe de cire, dans lequel une planchette de bois d'apparence encore
plus
ancienne portait inscrits en latin les mots suivants : "Ici repose le
corps de Marie Madeleine".
L'identité
du corps de Marie de
Magdala semblait donc authentifiée par deux inscriptions manuscrites.Mais
ce ne furent pas les seuls indices déterminants.
Charles d'Anjou constata que le squelette était presque complet, à
l’exception
de la mâchoire inférieure qui manquait. Il eut alors une inspiration
qui allait
se révéler providentielle. Désirant faire reconnaître par le
Saint-Siège les
reliques de la sainte, il partit pour Rome en emportant le crâne du
personnage.
Lorsqu'il rencontra le pape Boniface VIII à Saint Jean-de-Latran, il
fut
surpris d'apprendre qu'une mâchoire attribuée à Marie-Madeleine était
précisément conservée dans la même basilique. On alla donc chercher la
précieuse relique, et devant une foule de témoins rassemblée pour
l'occasion,
on confronta les deux parties de la tête : elles se complétaient
exactement !
Ce résultat
spectaculaire suscita l'enthousiasme général, et le pape offrit à
Charles la
mâchoire inférieure. Le comte rapporta donc en Provence le chef
complet, qui
reprit sa place dans le caveau. La nouvelle de l'authenticité vérifiée
des
reliques se répandit dans l'Occident chrétien.
Pour honorer la
mémoire de Marie-Madeleine,
une somptueuse basilique fut érigée au-dessus de la tombe.
Aujourd'hui encore, un escalier
descend
depuis la partie gauche de la vaste nef vers
une petite crypte, qui contient quatre splendides sarcophages de
pierre ornés de bas-reliefs. Ce sont ceux de Maximin, de Sidoine, de
Marcelle
et de Marie-Madeleine. Cette dernière repose dans celui du fond, sur
lequel est
posé un reliquaire contenant son crâne. Lorsqu’on emprunte la volée de
marches
qui descend dans cette cave, on se trouve ainsi face au premier témoin
de la
Resurrection de Jésus-Christ.
Références :
[1] - Association de soutien
à la tradition des saints de Provence (saintsdeprovence.com).
[2] - Fr. Ph.
Devoucoux du Buysson O.P. : "Marie-Madeleine
repose-t-elle à Saint-Maximin ?".Cahiers
de la Sainte-Baume No 6,
1er déc. 1989.
[3] - U.
Villevieille : "Nos saints de Provence". C.P.M. Marcel Petit,
Raphèle-les-Arles
1995.
[4] - "La
basilique de Saint-Maximin". Association
des amis de la basilique
Sainte-Marie-Madeleine (lesamisdelabasilique.fr).
[5] -
G.
de Nantes : "Sainte
Marie-Madeleine est-elle
venue en Provence ?" Il est
ressuscité n° 83, juillet 2009 (crc-resurrection.org).
[6] -
Fr. Ph.
Devoucoux du Buysson,
O.P.
: "Visite
de
la basilique de
la Madeleine à Saint-Maximin. Suivez le guide !". Maison Marie
Magdeleine (afsmm.assoc.pagespro-orange.fr).
|