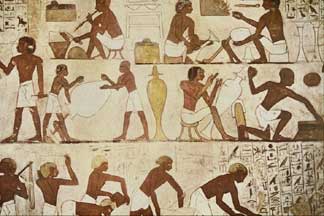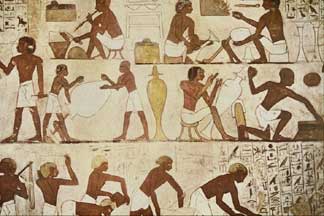|
L'histoire de Joseph est celle de
l'un
des fils du patriarche Jacob, promu vice-roi de la puissante monarchie
égyptienne. Né sous la tente d'une famille nomade de Canaan, Joseph est
d'abord
victime dans sa jeunesse de la persécution de ses onze frères, qui le
vendent comme
esclave à des marchands itinérants. Emmené captif en Egypte, il entre
comme serviteur
auprès d'un officier nommé Potiphar. Il arrive qu'en l'absence du
maître, l'épouse
de celui-ci courtise Joseph sans succès. Pour se venger de son refus,
elle
l'accuse faussement d'avoir tenté de la séduire, et il est jeté en
prison.
L'emprisonnement
donne l'occasion à Joseph de montrer à ses gardiens qu'il possède le
don
d'interpréter les rêves. On lui demande alors d‘expliquer un rêve
étrange qu'a
fait le pharaon. La signification qu'il en donne est celle d'un message
prophétique
annonçant qu'une terrible famine va s'abattre sur le pays. Sept années
de récoltes
surabondantes seront suivies par sept années de sécheresse et de
pénurie
alimentaire.
Le
roi est immédiatement convaincu, et en reconnaissance il élève Joseph
au rang
de premier administrateur du pays, en charge de gérer la crise
économique
annoncée. Joseph s'acquittera brillamment de cette tâche en faisant
emmagasiner
d'importantes réserves de nourriture. Pendant les années de famine, ses
entrepôts fournissent du blé à l'Egypte et aux pays voisins. Il
retrouve ses
frères venus acheter des provisions, leur pardonne et les invite à
s'installer
durablement en Egypte. La famille de Joseph et ses descendants
demeureront dans
le pays pendant plus de quatre siècles (Gn. 37-50).
Ce
merveilleux récit qui termine le livre de la Genèse a suscité des
recherches historiques
et archéologiques visant à en retrouver les traces. Loin de prouver la
réalité
du récit, les résultats de ces travaux se limitent à quelques points de
comparaison intéressants entre les versets bibliques et la société
égyptienne
antique. Face à ce manque de preuves, beaucoup d’érudits actuels
considèrent
que le texte est une création littéraire tardive. Cependant les
comparaisons sonnent
juste quant au contexte, et indiquent que la culture égyptienne a bel
et bien influencé
la rédaction du récit.
Les
patriarches en Egypte et
l'archéologie
Un
premier indice est constitué par une peinture murale célèbre qui
illustre le
mode de vie des nomades du désert à l'époque pharaonique. Près du
village de
Beni Hassan en Moyenne-Egypte, sur la rive est du Nil, la tombe
rupestre du
fonctionnaire égyptien Khnoumhotep II porte sur ses parois l'image
d'une
caravane de bédouins, dont l'aspect physique tranche avec celui des
personnages
égyptiens qui l'entourent. Les visiteurs sont habillés de tuniques en
toile rayurée,
équipés d'armes et accompagnés d'ânes et de chèvres chargés de bagages.
L'inscription
hiéroglyphique qui complète l'image désigne les bédouins par le mot
« Aamou »,
un terme égyptien qui définit les peuples asiatiques de l'Est. Elle
précise que
ce groupe de trente-sept nomades apporte du fard pour les yeux et qu'il
se rend
auprès du fils de Khnoumhotep. Le nom ou le titre de leur chef, Heka
Khase
Abish, peut se traduire par « prince du pays des montagnes de
Abish » [1].
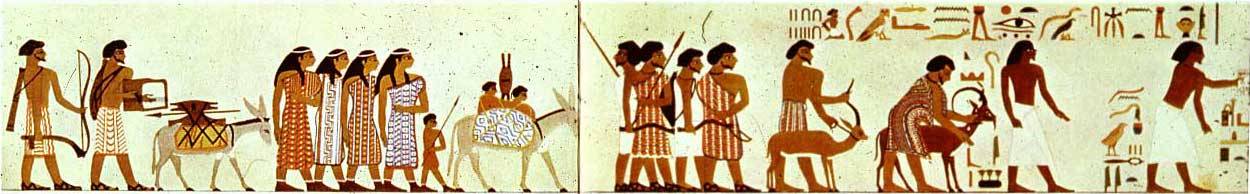 Tombe de Khnoumhotep II à Beni Hassan.
Tombe de Khnoumhotep II à Beni Hassan.
(jesuswalk.com)
Cette peinture est auto-datée de
l'an 6 du règne de Sésostris II, c'est-à-dire d'environ 1900 av. J.-C.,
une date
plutôt antérieure à l'époque des patriarches bibliques. Il est tentant
de faire
un lien contextuel entre ces bédouins et les personnages de Joseph et
de ses
frères, et même d'Abraham qui fit un bref séjour en Egypte (Gn. 12,
10). Ce
document illustre le mode de vie des nomades au temps des patriarches,
qui
paraît n'avoir pas changé depuis des millénaires.
Le
cadre historique de l’histoire de Joseph est difficile à préciser. Le
roi d'Egypte
est appelé « Pharaon », mais son nom propre n’apparaît pas.
En
revanche, le texte contient d'autres indices précieux. Par exemple,
lorsque
Joseph devient vice-roi d’Egypte, il est doté de vêtements de lin,
revêtu du
collier d’or, porte la bague du pharaon et parcourt l’Egypte sur un
char
d’apparat aux côtés du roi, symboles typiques du pouvoir pharaonique
(Gn. 41,
42-43).
Un
autre verset de la
Genèse contient également des noms et des titres d’origine
incontestablement
égyptienne : « Pharaon appela
Joseph Tsaphnath-Panéach, et lui donna pour femme Aséneth, fille de
Potiphar,
prêtre de On » (Gn. 41, 45). Le nom du dignitaire Potiphar
peut en
effet s'assimiler à l'expression Pa-di-pa-Râ qui signifie « celui
qui
donne Râ ». Potiphar est en outre présenté comme étant
« prêtre de
On », une référence probable à la cité égyptienne d’Onou vouée au
culte du
soleil (Râ) et plus connue sous le nom d’Héliopolis. De même, l’épouse
de Joseph
s'appelle Aséneth, un prénom qui peut se traduire par « suivante
de la
déesse Neith ». Enfin, le titre honorifique attribué à Joseph par
Pharaon,
Tsaphnath-Panéach, signifie vraisemblablement « le dieu a dit
qu'il
vivrait » [2]. Cette dernière expression contient
d’ailleurs
une subtilité remarquable : sa référence à une divinité anonyme
(« le
dieu ») omet toute déité égyptienne et donc païenne, conformément
au monothéisme biblique (Gn. 41, 45).
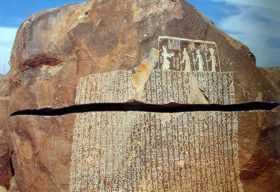 La stèle de la famine à Eléphantine.
(image :
http://www.narmer.pl/map/asuan_en.htm)
La stèle de la famine à Eléphantine.
(image :
http://www.narmer.pl/map/asuan_en.htm)
L'histoire
de Joseph n'a
laissé aucune trace connue dans la littérature égyptienne antique. En
marge de
cette absence il faut toutefois relever un texte hiéroglyphique
étonnant,
quoique anachronique, gravé sur un bloc de granite de la petite île de
Sehel,
au sud d'Assouan. Ce rocher connu sous le nom de « stèle de la
famine » porte un décret émanant du pharaon Djoser, l’un des tout
premiers
rois d'Egypte. En réalité l'inscription est beaucoup plus tardive et ne
date
que de l'époque grecque (ou ptolémaïque, IIIe siècle av. J.-C.). Le
texte parle
d'une famine désastreuse ayant duré sept ans, au cours de laquelle le
pharaon aurait
vu en rêve le dieu Khnoum lui annonçant la fin imminente du fléau. A
son
réveil, le monarque célèbre une fête pour remercier le dieu et instaure
un
impôt destiné à financer son culte. Les points
communs avec l'histoire de Joseph (famine de sept ans, songe royal
d'inspiration
divine, levée d'impôt) suggèrent une probable influence de la tradition
biblique
chez les rois d'Egypte de l'époque grecque.
Dater
l'histoire de Joseph
Dans l'hypothèse où la
saga de
Joseph en Egypte peut avoir une place dans l'Histoire, elle est
difficile à
dater et les diverses propositions de dates avancées par les historiens
de la
Bible sont incertaines. L’absence du nom du pharaon dans le texte
laisse planer
le mystère sur le contexte politique.
On
place le plus souvent l'arrivée de Joseph en Egypte vers la fin du
Moyen Empire
égyptien, ou plutôt durant la « deuxième période
intermédiaire », une
époque troublée de l'histoire égyptienne qui sépare le Moyen Empire du
Nouveau,
approximativement entre 1700 et 1550 av. J.-C. C'est le temps où des
populations
asiatiques investirent le delta du Nil et prirent le pouvoir dans cette
région en
s'attribuant le titre de rois. Ces envahisseurs appelées Hyksos (heka khasewet, chefs des pays étrangers)
établirent leur capitale à Avaris, dans l'Est du delta, et
s'efforcèrent d'adopter
la culture et le mode de vie égyptiens. Ils furent finalement chassés
d'Egypte par
les princes thébains qui restaurèrent l'indépendance du pays.
 Scarabée hyksos.
Scarabée hyksos.
(bibleandscience.com)
L'hypothèse de l'arrivée
de Joseph
en Egypte à l'époque des Hyksos trouve plusieurs justifications. La
nomination
d'un ministre sémitique à la cour d'Egypte est moins inconcevable sous
un
régime d'occupation étrangère d'origine proche-orientale. L'absence
d'archives
égyptiennes mentionnant un vice-roi nommé Joseph peut s'expliquer par
le manque
cruel d'informations disponibles sur cette période, censurée par les
successeurs et ennemis des Hyksos.
Un
argument économique avancé est la somme versée pour la vente de Joseph
par ses
frères : cent talents d'or (Gn. 37, 28), un montant qui correspond
effectivement au prix moyen des esclaves lors de la première moitié du
second
millénaire av. J.-C. ; il devait monter à deux cents talents à la
fin du
second millénaire, puis à cinq cents au cours du premier.
Un
indice matériel figure dans l'un des derniers versets de la Genèse, où
il est
précisé que le roi d'Egypte permit à Joseph d'aller enterrer son père
Jacob en
Canaan « avec des chars et des
cavaliers » (Gn. 50, 9). Or l'introduction du char en Egypte
remonte
précisément au temps des Hyksos : cet élément fait de la seconde
période
intermédiaire une limite antérieure pour l'entrée en Egypte de la
famille de
Jacob.
 Char êgyptien du Nouvel Empire
Char êgyptien du Nouvel Empire
(news.discovery.com).
Il serait risqué de tenter d'être
plus précis, et
pourtant on doit citer un témoignage peu connu figurant dans un texte
de
l'Antiquité tardive et attribué au prêtre égyptien Manéthon (IIIe
siècle av.
J.-C.). Cet auteur qui composa la première histoire de l'Egypte avance
le nom
du souverain qui aurait connu Joseph : ce serait Apopi Ier, ou
Apophis, un
roi hyksos de la XVe dynastie qui régna de 1580 à 1540 environ [4][5].
Le document, connu indirectement par
l'historien byzantin Georges le Syncelle, contient les mots
suivants :
« Certains disent que ce roi (Apopi)
était au début appelé Pharaon, et que dans la quatrième année de son
règne
Joseph arriva en esclave en Egypte. Il nomma Joseph seigneur d'Egypte
et de
tout son royaume, dans la dix-septième année de son gouvernement, ayant
appris
de lui l'interprétation des rêves et ayant ainsi prouvé sa sagesse
divine ».
|

Cartouche
du roi
Apopi-Ouserrê
(en.wikipedia.org).
|

Tête
supposée du roi hyksos Apopi
(clfrancisco.com).
|
Le peu de
renseignements dont nous
disposons sur ce roi viennent d'un document littéraire, une sorte de
poème inscrit
sur le papyrus Sallier du British Museum.
On y lit que c'est Apopi qui déclencha la guerre fatale contre les
Egyptiens du
Sud, lors d'une provocation étrange et maladroite : il reprocha
aux
princes thébains de laisser leurs hippopotames faire du bruit la nuit
et l'empêcher
de dormir ! Mal lui en prit, car cette guerre fut perdue par son
successeur
Khamudi et se termina par l'expulsion des Hyksos du territoire
égyptien.
Le
problème est que Manéthon confond ensuite la guerre d'indépendance
égyptienne
contre les Hyksos avec la libération des Hébreux conduits par Moïse,
deux
évènements incontestablement différents et qui rendent de ce fait
l'information
très incertaine.

Cartouche
du roi hyksos Yakub-Her
(en.wikipedia.org).
Des traces substantielles du
royaume hyksos ont été trouvées dans les murs de son ancienne capitale,
la cité d'Avaris, aujourd'hui identifiée à l'actuel site archéologique
de Tell
el-Daba. Implantée sur une branche du Nil dans l'Est du delta, la ville
était
puissamment protégée par une épaisse muraille. Ses fouilles ont livré,
entre plusieurs
niveaux d'occupation, une couche de culture typiquement
syro-palestinienne, contenant
des traces de combats et d'un incendie destructeur : sans doute
signent-elles
la prise de la ville par les Egyptiens du Sud. De nombreux petits
scarabées trouvés
sur place portent les noms de plusieurs rois hyksos, parmi lesquels
figurent ceux
de Yakub-Her et Yakob-Aam [6]. La ressemblance évidente entre
ces
noms et l'anthroponyme Jacob suggère une proximité culturelle ou
ethnique
commune, et confirme l'origine sémitique de ces occupants.
La
possibilité que le patriarche Joseph soit entré
en Egypte à l'époque des Hyksos est toujours débattue. D'autres
solutions ont
été envisagées, notamment une chronologie plus haute situant la vie de
Joseph sous
le Moyen Empire, peut-être durant la XIIe dynastie (v. 1991-1786 av.
J.-C.). Mais
l'hypothèse des Hyksos reste encore la moins floue pour les biblistes
conservateurs. A l'opposé, une majorité d’historiens estime aujourd’hui
que ce
récit est seulement un conte imaginaire ou un texte d’édification
religieuse.
|