Les
derniers versets du livre de la Genèse mentionnent
la mort du patriarche Joseph, en précisant qu'il est embaumé puis
déposé dans
un sarcophage en Egypte. Ensuite commence le livre de l'Exode, qui
laisse un
vide narratif de quatre longs siècles durant lesquels la famille de
Joseph et
de ses frères, désignés sous le terme d’Hébreux, résident en Egypte et
connaissent
une forte croissance démographique. Cette population d'origine
étrangère augmente
au point de susciter l'hostilité des Egyptiens de souche. Un nouveau
roi s'oppose
ouvertement aux descendants de Jacob et les réduit en esclavage, les
soumettant
à de durs travaux architecturaux et agricoles (Gn. 50 ; Ex.
1).
Les Hébreux
soumis aux travaux
forcés
Aucune preuve
archéologique
n'atteste la présence d'une importante communauté israélite en
Egypte aux époques présumées de Joseph et de Moïse ; ce qui conduit
beaucoup
d'égyptologues à considérer ces récits comme dépourvus de fondement
historique.
Pour autant, le livre de l'Exode fournit là aussi quelques détails dont
la
teneur est loin d'être étrangère au paysage égyptien.

Carte
du delta du Nil
aux temps antiques.
(islamic-awareness.org)
Un
verset de l'Exode précise que le peuple d'Israël "bâtit
des villes d'entrepôts pour Pharaon, Pitom et Ramsès"
(Ex. 1, 11). Le type de corvées imposées aux Hébreux d'après le texte
trouve un
écho dans les techniques de constructions pratiquées dans le pays.
Celles-ci figurent
avec quelques détails dans le livre de l'Exode :
"Ce
jour-là même Pharaon donna cet
ordre aux chefs de corvées du peuple et aux scribes : vous ne fournirez
plus au
peuple de la paille pour la fabrication des briques comme précédemment.
Qu'ils
aillent eux-mêmes se ramasser de la paille" (Ex. 5, 6-7).
La brique
était en effet le matériau de base des habitations égyptiennes, alors
que la
pierre était réservée aux temples et aux tombeaux. Il est également
exact que les
briques étaient couramment faites de boue mêlée de paille et séchées au
soleil.
Des vestiges de bâtiments construits avec ces matériaux subsistent,
certaines briques
étant même marquées du sceau du souverain régnant ; quelques-unes
portent le
cartouche du roi Ramsès II [1].
Le fonctionnement
d'un atelier de confection de briques est illustré par une fresque de
la tombe
thébaine de Rekhmiré, ministre du roi Thoutmosis III. Elle représente
les
étapes successives de la fabrication, montrant des ouvriers puisant de
l'eau
dans un bassin, préparant la boue, la transportant dans des récipients,
remplissant les moules et disposant les briques au soleil. Une partie
des
ouvriers ont la peau plus claire que les autres, signe que des éléments
étrangers
étaient employés.

Brique
portant le cartouche du roi Ramsès II.
Thèbes, XIXème dynastie
(britishmuseum.org).
| 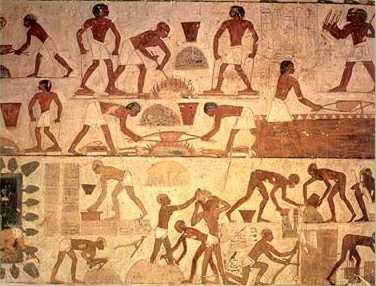
Fresque
représentant la confection de briques.
Tombe de Rekhmiré, XVIIIème dynastie
(touregypt.net).
|
Un autre
document plus significatif, le papyrus de Leyde 348, mentionne la
présence d'une
main-d'oeuvre spécifique sur un chantier de construction. Ce texte
émanant d'un
fonctionnaire de Ramsès II parle des chantiers de construction de la
nouvelle
capitale de Pi-Ramsès. Le scribe demande à ce "qu'on donne des rations
aux
soldats et aux hapirou qui traînent
la pierre de taille pour le grand pylône de Ramsès-Aimé-d'Amon" [2].
La
ressemblance entre les termes "hapirou" et "hébreu" a été
remarquée depuis longtemps. Pourrait-il s'agir des Hébreux de la Bible
? La
possibilité que ces mots aient une racine linguistique commune est
discutée ; le
mot égyptien "hapirou" désignait des groupes de personnes d'origine
étrangère qui vivaient en marge de la société, nomades, brigands ou
travailleurs
immigrés. Mais son sens est générique et il ne signifie pas
spécialement
"israélite" ; cela dit, le terme a pu s'appliquer à des étrangers
soumis à des tâches pénibles dont les Israélites faisaient partie. Rien
n'empêche
d'imaginer que son usage soit ensuite passé dans la langue des fils de
Jacob.
La proximité de l’Egypte avec
l'Asie
occidentale favorisait naturellement la présence d'étrangers sur les
rives du
Nil. En témoignent des documents égyptiens qui attestent de la présence
de
groupes immigrés sur la terre des pharaons, dont certains éléments
portent des
noms à consonance sémitique.
Ainsi
un papyrus conservé au Brooklyn Museum
de New-York, daté du règne de Sébekhotep III (fin du Moyen Empire, vers
1740 av.
J.-C. environ), établit la liste d'une centaine d'esclaves devant être
déplacés. La moitié d'entre eux portent des noms sémitiques, comme par
exemple
Menahem, Asher, Haiimi (qui signifie « où est mon père ? » en
hébreu),
Hiabi-ilu (également traduit par
« où est mon père ? »), Abi (encore pour « mon
père »),
Shepra, Aduna (c'est-à-dire « mon seigneur »), Aqaba (à
rapprocher de
Jacob) et Iun-er-Tan (qui peut signifier « peut-on rentrer au pays
? »). Le statut de ces esclaves étrangers offre quelques points
communs
avec celui de Joseph. Plusieurs esclaves portent le titre de
« serviteurs
sur la maison » (hry-per), qui
correspond au rang de Joseph lorsqu'il est employé par Potiphar.
Souvent les
esclaves étaient également dotés d'un deuxième nom égyptien, comme
Joseph le
sera par Pharaon.
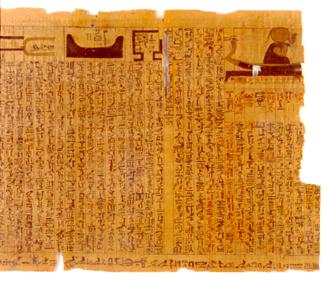
Le papyrus de Brooklyn.
(brooklynmuseum.org)
La
localisation des cités
bibliques
Certaines références
géographiques qui apparaissent dans les Ecritures devraient pouvoir
trouver leur place sur la
carte de l'Egypte ancienne. Un verset de l'Exode précise que le peuple
d'Israël "bâtit des villes d'entrepôts pour
Pharaon, Pitom et Ramsès" (Ex. 1, 11). Ces deux toponymes font
référence à d'anciennes villes égyptiennes bien réelles. En effet le
nom de
Ramsès désigne vraisemblablement la cité de Pi-Ramsès, nouvelle
capitale fondée
par Ramsès II, et celui de Pitom serait une transcription de
"Per-Atoum",
c'est-à-dire "demeure du dieu Atoum".
Les
archéologues ont eu du mal à localiser ces cités sur le terrain. Après
avoir
longtemps confondu Pi-Ramsès avec l'antique Tanis, près de l'extrémité
nord-est
du delta, ils l'identifient désormais à un site appelé Qantir et
implanté plus
au sud [3]. En
fait les ruines de Qantir recouvrent une partie de celles d'Avaris
(Tell
el-Dab'a), l'ancienne capitale des Hyksos. Le site est aujourd'hui
recouvert de
vastes champs agricoles d'où émergent quelques socles de statues
éparses.
Les
fouilles menées par l'équipe autrichienne de Manfred Bietak à partir
des années
1960 ont livré les traces d'un vaste palais, d'un temple dédié à Amon
et d'un
important complexe militaire.

Base
d'une statue géante à Qantir.
(biblearchaeology.org)
Plus
au sud, une large vallée est-ouest appelée le Wadi Toumilat relie le
delta du
Nil au lac Timsah. Les Pharaons y ont creusé un canal navigable qui
reliait le
fleuve à la mer Rouge. C'est dans cette vallée que la ville de Pitom
était vraisembablement
implantée. Pitom devait s'assimiler aux ruines de Tell el Maskhouta ou
à celles
de Tell el-Retabeh [4][5], deux
sites qui comprennent chacun des restes de bâtiments de briques
(peut-être les
entrepôts cités dans la Bible), et les ruines d'un temple dédié au dieu
Atoum. Cependant,
des fouilles récentes ayant établi que Tel el-Maskhouta était désert au
Nouvel
Empire, on identifie plus probablement Pitom à Tell el-Retabeh, seul
site
occupé à l'époque ramesside [6].

Le site de
Tell el Maskhouta (Pithom?)
(cnx.org).
| 
Bas-relief
du temple d'Atoum à tel el Retaba (Pithom?),
figurant Ramsès
II frappant un ennemi asiatique
(flickr.com/photos/menesje).
|
Les éléments
précédents sont insuffisants pour attester de la présence en Egypte des
Israélites de la Bible, mais on rencontre un "fonds culturel" qui
montre que les auteurs du Pentateuque étaient de fins connaisseurs de
la
civilisation égyptienne.
La datation
de l'Exode
Pour
les érudits qui situent l'Exode au temps du Pharaon
Ramsès II, autour de 1250 av. J.-C., la référence à la cité nommée
Ramsès dans
le livre de l'Exode ( 12, 37) est l'un des arguments majeurs en faveur
de cette thèse.
La ville
égyptienne de Pi-Ramsès fut fondée et déclarée capitale de l'Egypte par
le
grand Ramsès II. De ce fait l'Exode peut difficilement être antérieur à
ce roi,
pas plus qu'il ne peut être placé au temps de son successeur Mineptah,
car une
célèbre stèle gravée à son nom précise qu'en son temps le peuple
d'Israël se
trouvait déjà dans la région de Canaan. Selon cet argument, Ramsès II
semble
donc bien placé pour être le roi contemporain de l'Exode.
Son règne
prestigieux dura soixante-six ans (env. 1279-1212 av. J.-C.) au cours
desquels
il mena par une ambitieuse politique de conquêtes militaires, avec de
brillantes campagnes en Syrie contre les Hittites. A l'intérieur,
Ramsès II mit
en oeuvre un programme de constructions très ambitieux, incluant entre
autres un
vaste temple funéraire à Thèbes : le Ramesseum. Détail à noter, ce
sanctuaire
est entouré de longues constructions voûtées en briques crues, sans
doute des
magasins d'entreposage comme ceux qu'ont pu bâtir les Hébreux.

Magasins
de briques jouxtant le Ramesseum à Thèbes.
(egyptology.blogspot.fr)
Les tentatives
visant à préciser la chronologie biblique doivent tenir compte de la
durée du
séjour des Hébreux en Egypte, qui est donnée pour une longueur de
quatre cents
trente ans (Ex. 12, 40). Des Biblistes comme William
Foxwell Albright ont
fait remarquer que l'époque des Ramsès se situait précisément quatre
siècles
après le temps des Hyksos. Le règne du plus célèbre d'entre eux peut
donc s'accorder
avec le contenu narratif de l'Exode.
Cependant d'autres écoles de
pensée
font remonter les évènements bibliques plus loin dans le passé. En
plaçant
l'Exode sous la XVIIIe dynastie, vers 1450 ap. J.-C., certains
présentent le
roi Thoutmosis III (env. 1479-1425 av. J.-C.) comme le candidat favori.
L'argument
principal se trouve dans le premier livre biblique des Rois (1 R. 6, 1)
d'après
lequel le roi d'Israël Salomon aurait vécu quatre siècles après
l'Exode. L'hypothèse
est également soutenue par une autre affirmation de Manéthon, selon
laquelle le
départ des Hébreux serait contemporain du roi « Tethmesis ».
Il
pourrait s'agir de Thoutmosis III, le premier grand conquérant égyptien
qui soumit
une grande partie du Proche-Orient et mena ses troupes jusqu'à
l'Euphrate. C'est
lui qui constitua le plus vaste empire que l'Egypte ait jamais contrôlé.
Aujourd'hui chacune des
deux chronologies trouve encore ses défenseurs, quoique celle qui
remporte le
plus de suffrages soit celle plaçant l'Exode sous Ramsès II. En
définitive, les
deux chronologies concurrentes offrent plus généralement une fourchette
de dates
possibles comprise entre 1500 et 1250 av. J.-C. Peut-être de futures
investigations permettront-elles d'affiner l'histoire biblique et son
déroulement [7].
Références :
[1] - W.-H. Guiton : "Le
cri des pierres". Appendice.
Bons Semeurs, Paris 1939.
[2] - A. Malamat : "Let my people Go
and Go and Go
and Go. Egyptian records support a centuries-long exodus". Biblical
Archaeology Review 24:01, jan/feb. 1998 (cojs.org).
[3] - E. P. Pusch :
"Qantir\Pi-Ramsès". Les Dossiers d'Archéologie n° 213, mai
1996.
[4] - D. Cameron Alexander Moore :
"The Date of the
Exodus. Introduction to the Competing Theories".
(members.tripod.com/Cameron_Moore).
[5] - J.-L. Mouton : "Tell el-Maskhouta, la
Pithôm de l'Exode ?", 25 juin 2006 (labalancedes2terres.free.fr).
[6] - S. Bayfield : "Tell el-Maskhuta", march 2,
2009 (egyptsites.wordpress.com)
[7] - D. Cameron Alexander Moore :
"The Date of the
Exodus. Introduction to the Competing Theories".
(members.tripod.com/Cameron_Moore).
|