La grande figure de Moïse
apparaît
au chapitre 2 de l'Exode, où il est question d'un enfant hébreu déposé
à la
naissance par sa mère dans un panier flottant sur le Nil, pour le
sauver d'un
génocide perpétré contre les nouveaux-nés israélites. En effet le roi
d’Egypte
hostile aux Hébreux a pris cette mesure d’extermination de tous leurs
nouveaux-nés. L'enfant abandonné est toutefois recueilli par la fille
du Pharaon,
qui l'adopte et lui permet de grandir à la cour royale.
Devenu
adulte, son destin change le jour où il intervient en faveur d'un
ouvrier
hébreu maltraité dont il tue le contremaître. Craignant d'être
poursuivi pour ce
meurtre, Moïse s'enfuit dans le désert et se réfugie auprès du peuple
de Madian.
Là, un bédouin nommé Jéthro l'emploie comme berger. Il est alors témoin
d'une
apparition surnaturelle. Dieu se manifeste à travers un buisson
enflammé et lui
confie la mission de délivrer le peuple israélite de l'esclavage et de
le
conduire hors d'Egypte.
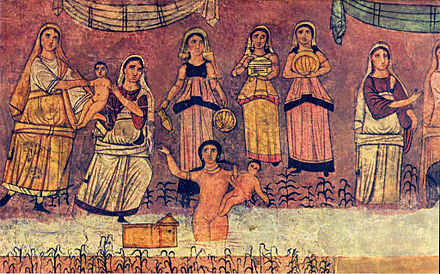
La Moïse
sauvé
des eaux. Fresque de la synagogue
de Doura Europos, Syrie, IIIe siècle
(fr.wikipedia.org).
Moïse
accepte de retourner auprès du Pharaon et négocie la libération du
peuple prisonnier.
Les prodiges divins étant sa force de persuasion, il n'obtient
l'autorisation royale
qu'au prix d'une succession de catastrophes naturelles qui s'abattent
sur tout le
pays : eau changée en sang, grêle, ulcères, peste du bétail,
ténèbres,
invasions de mouches, de moustiques, de grenouilles et de sauterelles,
puis
finalement mort des premiers-nés égyptiens. Seule cette dernière plaie
parvient
à faire plier le roi qui accorde enfin la liberté au peuple d'Israël.
Celui-ci
se prépare à quitter le pays et fête la première Pâque la veille de son
départ.
Alors
que la population affranchie est déjà en route vers la frontière, le
pharaon se
ravise et lance sa cavalerie à la poursuite des fugitifs au moment où
ils
s'apprêtent à traverser la mer Rouge. Par un miracle spectaculaire,
Moïse « ouvre
la mer en deux » pour faire traverser le peuple, puis la referme
en noyant
la cavalerie égyptienne (Ex. 2-15).
Ce récit épique n'a pas
d'équivalent dans la mémoire et les archives égyptiennes. On peut
comprendre que
les Egyptiens n'aient pas voulu garder le souvenir de cet échec
humiliant. La
recherche d'éventuelles traces de cette épopée en est d'autant plus
difficile,
et ses résultats ne tiennent qu’à quelques points de comparaison
culturels.
Moïse et les
dix plaies
d'Egypte
C'est
dans le domaine de la linguistique que l'on trouve les premiers indices
significatifs sur le personnage de Moïse et les plaies d'Egypte. Le nom
de
Moïse provient sans doute du terme égyptien mosé
qui signifie "enfant" ou "engendré", comme chez des personnages
historiques connus tels que Thoutmosé, Kamosé, Ramosé ou Ahmosé.
L'emploi du
radical mosé sans paternité est en
outre cohérent avec le contexte d'une adoption. Ce
prénom
égyptien est d'ailleurs attesté sous le Nouvel Empire.
Le
vocabulaire courant présente également des ressemblances frappantes
entre les
langues hébraïque et égyptienne, certains termes étant même identiques.
Au
début du XXème siècle, l'archéologue américain Melvin Kyle a établi une
liste
de termes employés dans le Pentateuque ayant à n'en pas douter une
origine
égyptienne [2][3] :
|
Désignation
|
Mot commun égyptien / hébreu
|
Désignation
|
Mot commun égyptien / hébreu
| |
|
|
|
| |
Tente de branchages
|
Succoth
|
Rouge
|
Dam
| |
Tente de peaux
|
Ohel
|
Grenouille
|
Tsephardeim
| |
Tour
|
Migdol
|
Pou
|
Kinnim
| |
Maître, seigneur
|
Adon
|
Mouche
|
'Arobh
| |
Vizir
|
Ab
|
Ulcère
|
Shehin
| |
Coffre, berceau
|
Tba (hébreu : têbâh)
|
Grêle
|
Baradh
| |
Jonc
|
Kam (hébreu : gomêh)
|
Sauterelle
|
'Arbeh
| |
Vase
|
Sennu (hébreu : sinsénet)
|
Ténèbres
|
Hoshekh
| |
Grand vase
|
Seri (hébreu : sêr)
|
Roseau
|
Suph
|
Si l'existence de cette terminologie
commune n'est pas le fruit du hasard, elle doit être le fruit
d'importants
emprunts de vocabulaire dus à un contact prolongé entre les deux
cultures. On trouve
également dans cette liste des termes évoquant les fameuses plaies ou
catrastrophes qui frappent l'Egypte d'après le récit de l'Exode. Il est
concevable que ces mots égyptiens soient entrés dans la langue
hébraïque à
l'époque pharaonique.
La quête de
témoignages historiques sur l'Exode fut aussi celle d'évènements
spectaculaires
ou surnaturels. La série de miracles accomplis devant le roi d'Egypte a
été
soumise à une interrogation d'ordre scientifique, qui a occupé bien des
érudits
à la recherche d'explications plus ou moins naturelles à ces
phénomènes. Ainsi
les géologues William Ryan et Gilles Lericolais [4] ont
récemment tenté d'associer les plaies bibliques avec les conséquences
écologiques
d'un évènement historique connu : l'explosion de l'île volcanique du
Santorin.
Cette catastrophe naturelle majeure se produisit au nord de la Crête
vers 1600
av. J.-C. [5], et
affecta tout le pourtour méditerranéen, provoquant des raz-de-marée et
une série
de déséquilibres climatiques et environnementaux. Elle n'épargna pas le
delta du
Nil, où des cendres et des scories de cette époque ont été retrouvés [6].

L'éruption
du volcan du
mont St-Helens en 1980
(nhoem.state.nh.us).
| 
L'archipel
du Santorin
(lettres-histoire.ac-rouen.fr).
|
D'après le
modèle proposé par ces chercheurs, l'éruption aurait formé une haute
colonne de
fumée, que des vents stratosphériques auraient poussée vers l'Egypte.
Les
cendres et les scories acides seraient retombées dans les eaux du Nil
et les auraient
teintées de rouge. Les nuages denses auraient opacifié l'atmosphère,
provoquant
des chutes abondantes de pluie et de grêle. Dans un pays sec, de
soudaines
précipitations favorisent l'éclosion en très grand nombre de toutes
sortes
d'animaux nuisibles. Par suite, l'apparition d'infections et
d'épidémies mortelles
est facilement imaginable. Tous ces phénomènes forment un schéma
évoquant les
plaies décrites dans le livre de l'Exode.
Un document
égyptien, le papyrus médical de Londres, donne une liste de maladies et
de
remèdes connus en Egypte vers 1350 av. J.-C. [7]. Le
biologiste italien Siro Trevisanato y relève une pathologie causée par
des eaux
rouges brûlantes du Nil. Le remède associé étant un composé alcalin,
selon lui
l'agent caustique devait être acide, ce qui est concevable si le Nil
avait reçu
des cendres volcaniques modifiant l'acidité et la couleur de ses eaux.
Le point faible de
cette théorie est d'ordre chronologique : l'explosion du volcan
s'est produite vers 1600 av. J.-C. alors que les dates habituellement
proposées pour l'Exode sont d'au moins un siècle plus tardives.
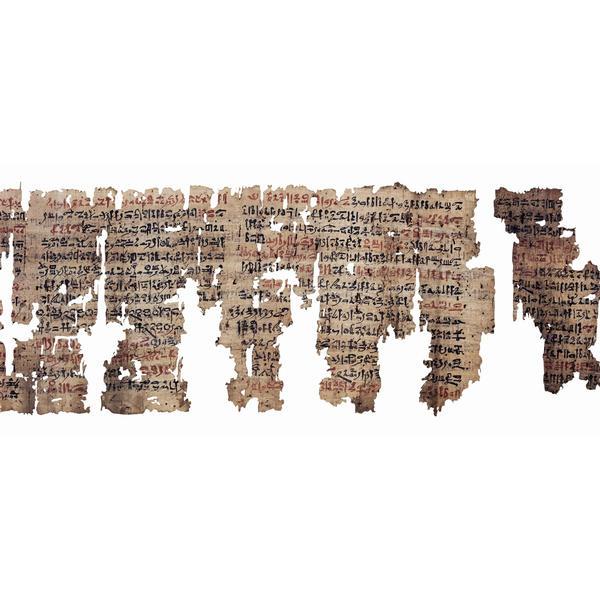
Le papyrus
médical de Londres
(thebritishmuseum.ac.uk).
Le point du
départ
Le
texte biblique cite
précisément le nom de "Ramsès" comme lieu de départ du peuple
d'Israël quittant l'Egypte (Ex. 12, 27) :
"Les enfants
d'Israël partirent de Ramsès pour Socoth, au nombre d'environ six cent
mille
hommes de pieds sans compter les enfants".
La ville de
Pi-Ramsès,
aujourd'hui
identifiée au site de Qantir et anciennement capitale de l'Egypte
sous les
Ramsès, a donné l'occasion à l'équipe de Manfred Bietak [8] de
faire une découverte significative.

Vestiges de
Tanis, première candidate pour être
l'ancienne capitale de l'Egypte sous Ramsès II
(institutoestudiosantiguoegipto.com).
| 
Le site
actuel de Qantir,
nouveau lieu prosposé
pour l'ancienne capitale
(greatcommission.com).
|
Dans
un quartier de la ville anciennement dédié aux
activités militaires, l'équipe autrichienne découvrit une série
d'éléments
forts instructifs quant au fonctionnement de l'armée égyptienne. Il
s'agit d'un vaste complexe comprenant des installations à caractère
militaire
et industriel, incluant les restes d'ateliers de fonderie équipés de
tout le matériel nécessaire : des fours, des creusets, des marteaux,
des
enclumes, des scories, des armes et des outils divers ... Ces ateliers
produisaient
manifestement des armes et des chars de combat. Juste à côté se
trouvaient également
des bâtiments d'anciennes écuries, avec des rangées de chambres munies
d'anneaux
de pierres servant à attacher les bêtes. L'ensemble constituait un
haras royal
pouvant abriter au moins cinq cents chevaux, et l'établissement était
marqué du
nom du roi Ramsès II.
La découverte
de cet ancien complexe a incité Bietak à faire un lien direct avec le
récit
biblique. Il rapprocha le site de l'épisode dans lequel la cavalerie du
Pharaon
est lancée à la poursuite des Hébreux partis en direction de la mer
Rouge (Ex.
14, 6-7) :
"Il (le
roi d'Egypte) fit atteler son
char et emmena son peuple avec lui. Il prit ainsi six cents chars
d'élite et
tous les chars d'Egypte ; sur tous, il y avait une élite de guerriers."
Le
point le plus convaincant est la capacité des écuries de Qantir, qui
correspond
à peu près au nombre de chars égyptiens cités dans l'Ecriture. Si c'est
bien de
là qu'est partie la cavalerie royale dont parle l'Exode, il est permis
de
supposer qu'elle fut perdue en tentant de traverser un bras de mer.

Fouilles de
Qantir montrant les restes
des bâtiments militaires ramessides
(greatcommission.com).
| 
Cartouche
au nom du roi Ramsès II
trouvé à Qantir
(meritneith.de).
|
Les
premières étapes
L'itinéraire que
suivirent les Israélites au départ de Pi-Ramsès est détaillé dans le
livre de
l'Exode, où sont inscrits les noms des premières étapes géographiques
de la sortie d'Egypte. La direction générale est certainement celle de
l'est et
du sud, qu'ils auraient prise avant d'atteindre la mer. Il serait
facile de reconstituer l'itinéraire exact si la topographie et la
toponymie de
la région n'avaient pas changé. Mais l'Ecriture dresse un tableau qui
présente
quelques difficultés d'interprétation :
"Ils
levèrent le camp de Socoth et
vinrent camper à Etham, à l'extrémité du désert" (Ex. 13, 20). "Yahvé parla à Moïse, en disant :
parle aux enfants d'Israël. Qu'ils changent de direction et campent
devant
Phihahiroth, entre Magdalum et la mer, vis-à-vis de Béelséphon."
(Ex.
14, 1-2).

Itinéraire
possible de la sortie d'Egypte
(image réalisée à partir de : aquarius.geomar.de/omc).
Localiser
précisément
ces différentes étapes a posé bien des problèmes aux chercheurs qui ont
tenté
de les identifier. Dès 1885, un travail publié par l'égyptologue suisse
Edouard
Naville s'efforça d'associer chaque étape de l'Exode à un site
géographique connu
dans les documents anciens. Socoth serait Thukot, non du district
égyptien de
la région de Pitom. Etham serait une déformation du mot égyptien hetem (forteresse), dont nous savons que
la frontière égyptienne était jalonnée. Phihahiroth serait la
transcription de
Pi-Kerehet, un temple d'Osiris implanté sur la côte sud-ouest du lac
Timsah.
Magdalum ou Migdol qui signifie "tour" en hébreu et en égyptien,
devait se trouver sur une colline, ce lieu étant cité dans plusieurs
papyrus.
Beel-Séphon serait un temple au nom de Baal, nommé Baal-Zapouna dans un
papyrus
et placé sur l'autre rive du lac Timsah [9][10].
C'est
par ces différents sites, plus ou moins bien localisés
aujourd'hui, que les Hébreux auraient suivi la direction de l'est pour
atteindre
les lacs.
"Quand
Pharaon laissa aller le peuple,
Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins, bien que le
plus
court, de crainte, disait Dieu, que le peuple ne se repentît en voyant
la lutte
et ne retournât en Egypte. Et Dieu fit faire un détour au peuple par le
chemin
du désert vers la mer Rouge" (Ex. 13, 17-18).
Le "chemin
des Philistins" est sans doute celui qui longeait simplement la région
côtière de la Méditerranée, étroitement surveillée par une chaîne de
forts
égyptiens qui constituait un obstacle militaire. Si le pays de Canaan
était à
cette époque sous contrôle égyptien, il est logique que les Hébreux
aient pris
la direction du sud pour s'enfoncer dans le désert du Sinaï sans être
inquiétés.
La traversée
de la "mer
des Roseaux"
Les
traductions occidentales classiques de la Bible appellent "la mer
Rouge" celle franchie miraculeusement par les Hébreux. En fait
l'expression figurant
dans le texte hébreu d'origine est yam-suph,
c'est-à-dire
"la mer des Roseaux" et non pas "la mer Rouge".
Aucune
mer ne porte aujourd'hui le nom de mer des Roseaux. De nos jours la
branche
nord-ouest de la mer Rouge, le golfe de Suez, se prolonge par le canal
contemporain
qui la relie à la zone des lacs Amers, Timsah, Ballah et à la mer
Méditerranée.
Aux temps bibliques, le profil de cette zone était semble-t-il moins
ensablé et
le golfe de Suez s'avançait davantage vers le nord.
On
ignore le point exact du franchissement de la mer. Nous constatons
simplement
qu'aujourd'hui les lacs Timsah et Amers sont effectivement entourés de
roseaux,
alors que les rives du golfe de Suez ne le sont pas.

La zone marécageuse des
lacs amers
(greatcommission.com).
Quant
au miracle de l'ouverture de
la mer
proprement dit,
peut-être est-il simplement dû, comme le dit la Bible elle-même, à un
vent
particulièrement fort qui aurait repoussé les eaux pendant la nuit (Ex.
14,
21-29). Selon Edouard Naville, ce phénomène n'est pas invraisemblable
pour un
bras de mer long et peu profond. Des voyageurs ont parfois observé en
Egypte un
retrait momentané des eaux sous les effets combinés d'un vent puissant
et de la
marée. Le récit spectaculaire perdrait ainsi une part de son caractère
surnaturel.
|