Le débat sur les conditions
d'émergence de la nation israélite est illustré par un ensemble de
découvertes
peu connues, faites par des archéologues de l'Université de Haïfa, qui
montrent de
manière significative les difficultés d'interprétation des anciens
vestiges et
les controverses qu'ils peuvent provoquer.
Un
assemblage de pierres
original
En 1978, l'équipe
d'archéologues du professeur Adam Zertal, de l’Université de Haifa,
prospecta
sur le mont Ebal, proche de Sichem en Samarie, à la recherche
d'éventuels vestiges
antiques. Les chercheurs avançaient à pied en scrutant le sol lorsque
leur attention
fut attirée par un volumineux tas de pierres entouré de quelques
tessons de
poteries. Ils dégagèrent le tumulus et virent apparaître une structure
de forme originale : un assemblage rectangulaire
de pierres brutes muni d'une rampe d’accès en légère pente [1].

Un tas de
pierres qui allait révéler
bien des surprises
(shechem.org).
|

Une
structure inhabituelle
apparaît peu
à peu
(ebal.haifa.ac.il).
|
Autour et à
l'intérieur de la structure furent également mis au jour des murets
secondaires,
ainsi que de nombreux artéfacts tels que des poteries, des ossements
d'animaux brûlés,
de la cendre et des morceaux de plâtre. Le type de terres cuites
trouvées sur
place permit de dater l'occupation du site du début de l'âge du fer,
entre les
XIIIème et XIIème siècles avant notre ère.
On trouva
également
deux petites amulettes égyptiennes en forme de scarabées, qui portaient
des
motifs gravés représentant une sorte de rosace et deux cobras. Ce type
d'amulette déjà connu existe en cinq exemplaires, qui remontent aux
règnes de
Ramsès II et de Ramsès III ; ces âges sont en accord avec ceux des
autres
poteries du mont Ebal.

Poterie reconstituée
du mont Ebal
(shechem.org).
|

Scarabée égyptien
du mont Ebal
(shechem.org).
|
Les ossements
d'animaux
calcinés furent envoyés en laboratoire pour être soumis à une étude
détaillée. C'étaient
ceux de jeunes mammifères âgés de moins d'un an et appartenant à quatre
espèces
uniquement : chèvres, bovins, moutons et daims.
La disposition
du site ne ressemblant à rien de connu, les archéologues en cherchèrent
vainement
une interprétation satisfaisante. Deux hypothèses furent formulées,
celle d’une
tour de guet et celle d’une ferme, propositions toutefois peu
convaincantes selon
les chercheurs qui l'avaient dégagé [2].

Le
sous-sol contient une strate inférieure
légèrement plus ancienne
(ebal.haifa.ac.il).
Une toute
autre explication vint en 1983 lorsqu'un jeune archéologue de passage,
David Eitam,
suggéra que la clef de l'interprétation du site devait se trouver dans
les
ossements brûlés. Zertal pensa alors à un autel à sacrifices, et se
documenta
sur les pratiques hébraïques en matière de sacrifices d'animaux. Se
référant à
l’Ancien Testament, il trouva alors deux passages des livres du
Deutéronome et
de Josué qui relataient précisément l’édification d’un autel israélite
sur le
mont Ebal en Samarie.
Ces brefs
passages de l'Ecriture rapportent en effet la construction d'un autel
sur cette
colline peu après l'entrée en Terre promise, juste après la prise de
Jéricho et
celle de Aï (Dt. 27, 1-13 ; Js. 8, 30-35). Une cérémonie religieuse y
aurait été
célébrée par Josué en présence du peuple hébreu rassemblé. L'Arche
d'Alliance aurait
été exposée sur le mont et le peuple aurait renouvelé son alliance, une
moitié
des Hébreux se tenant d'un côté sur le mont Ebal et l'autre sur le mont
Garizim
voisin.

La
structure de pierres
après restauration
(shechem.org).
|
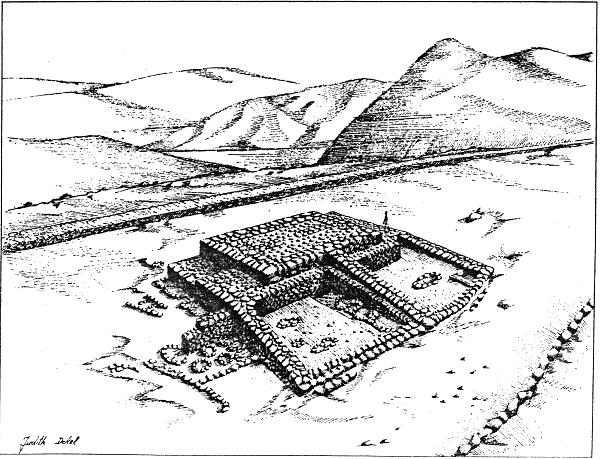
L'ensemble
constituait vraisemblablement
un autel de
plein air
(shechem.org).
|
A la lumière
de ces deux textes, les éléments archéologiques mis au jour trouvèrent
désormais
un sens. Les ossements brûlés étaient ceux des animaux sacrifiés sur
l’autel ; ils appartenaient précisément à des espèces cachères
décrites
dans la Bible. La date du XIIIème siècle av. J.-C. donnée par les
poteries et les
scarabées pour l'occupation du site pouvait correspondre à l'époque de
l‘entrée
des Israélites en Canaan.
Un éclairage
supplémentaire
se révéla lorsque les chercheurs esquissèrent sur le papier une
reconstitution probable
de l'autel dans son état d’origine. Ils réalisèrent à leur grand
étonnement que
sa forme était quasiment identique à celle d'un autre autel élevé près
du
Temple de Jérusalem et décrit dans la littérature rabbinique du Talmud.
On
retrouvait exactement la même disposition rectangulaire surélevée et
munie
d'une rampe d'accès [3]. Quoique
plus de mille ans séparaient les deux constructions, leur
similarité
dénotait la conservation d'une même tradition dans la manière de
construire les
autels.
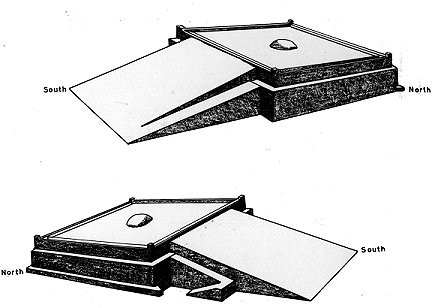
Autel
du Temple de
Jérusalem. Reconstitution
(ebal.haifa.ac.il).
La découverte
faite
sur le mont Ebal apporta des éléments d'un intérêt crucial, car elle
concernait
l'époque présumée de la conquête de la Terre promise assez mal
documentée en
dehors de la Bible. Bien que ce site archéologique soit encore peu
connu du
public, il constitue l'un des témoignages qui s'accordent le mieux avec
un
épisode biblique de l'établissement des Hébreux en Canaan [4][5].
Cependant la
publication de ces résultats provoqua de vives protestations dans le
monde
universitaire, car les conclusions exprimées allaient à l'encontre de
l'idée répandue
selon laquelle la conquête biblique de la Terre promise relevait du
mythe
plutôt que de l'Histoire.
Des enclos
en forme de pieds
Mais
les surprenantes découvertes du professeur Zertal ne s'arrêtèrent pas
là. Dans
les années 1990, son équipe mit au jour dans les collines situées à
l'ouest de
la vallée du Jourdain une série de curieux enclos formés par des
murets, dont
la particularité résidait dans leur plan qui ressemblait à d'immenses
traces de
pas humains.
Les fouilles
que
Zertal effectua dans et autour de ces enclos précisèrent les
caractéristiques de
ces "pieds géants". Les murs assemblés en pierres sèches ne
dépassaient pas un mètre de haut, et deux d'entre eux étaient entourés
d'un
chemin pavé qui encerclait leur clôture. Des restes de vaisselle et
d'ossements
d'animaux furent trouvés et permirent de dater leur occupation au tout
début de
l'âge du fer, c'est-à-dire autour du XIIème siècle avant notre ère. Les
assemblages de pierres de cette forme sont au nombre de cinq, disposés
sur une
ligne de plusieurs kilomètres longeant la vallée du Jourdain puis
s'infléchissant vers l'ouest jusqu'au mont Ebal.

Vue aérienne de l'un
des
enclos en forme de pied
(Pr. A. Zertal)
|
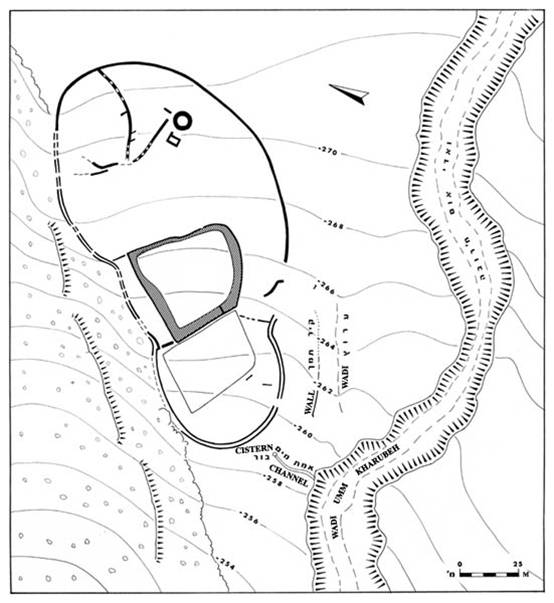
Relevé topographique de
la structure
(Pr. A. Zertal)
|
Qui étaient
les bâtisseurs de ces enclos et quelle était leur raison d'être ? Là
aussi, Adam
Zertal chercha une interprétation dans l'Ancien Testament. Comme
l'entrée du
peuple hébreu en Canaan peut être placée chronologiquement au début de
l'âge du
fer, il proposa d'assimiler ces sites à des campements militaires
utilisés par
le peuple d'Israël sous Josué. Il fit un lien avec le site de Guilgal
mentionné
dans la Bible comme étant le ou les camps de base des expéditions
guerrières
dirigées par Josué.
Quelle
autre
explication suggérer ? La disposition des enclos suit un tracé
conduisant de la
région de Jéricho au mont Ebal. L'image des pieds pourrait matérialiser
l'entrée
et la prise de possession d'un territoire, un symbole que l'on retrouve
également
dans la culture égyptienne. Le chemin pavé qui ceinture chaque mur a
peut-être
servi à des processions rituelles. La disposition des enclos, leur
situation et
leur datation, en font les premières traces possibles de campements
hébreux du
temps de Josué [6][7].

L'extrémité d'un des
enclos en forme de pieds
(freerepublic.com).
Références :
|