L'exécution
de Jésus, telle qu'elle est rapportée dans les évangiles, est précédée
du récit des épreuves qui lui furent infligées. Dès la sentence
prononcée Jésus fut maltraité, flagellé, coiffé par dérision d'une
couronne tressée
d'épines, puis dirigé vers le lieu d'exécution. Il fut contraint
de
porter sa croix et fit plusieurs chutes en subissant les coups des
soldats. Un passant nommé Simon de Cyrène fut réquisitionné
pour l'aider à porter son fardeau.
Les
Ecritures désignent le lieu de la mise à mort par le mot "Golgotha",
qui signifie "crâne" en hébreu et qui se trouvait à l'extérieur du
rempart. On peut croire que l'itinéraire suivi correspond à l'actuelle Via dolorosa,
une ruelle qui traverse d'Est
en Ouest le
centre ancien de Jérusalem, à
partir
du couvent de l'Ecce homo et jusqu'à la
Basilique du Saint-Sépulcre.
Jésus
fut cloué sur la croix en
même temps que deux autres condamnés. Un écriteau
portant la mention : "Jésus le Nazaréen, roi
des Juifs" fut fixé au-dessus de
sa tête. Une foule de
témoins hostiles assista à l'affreuse agonie en l'insultant.
Quelques-uns de ses proches
étaient également présents, dont sa mère, l'apôtre Jean et Marie de
Magdala. Les
soldats récupérèrent même ses vêtements en se les partageant par tirage
au sort. On lui
tendit à boire une éponge imbibée de vinaigre qu'il refusa de prendre.
Vers la sixième heure (environ midi)¸ le ciel s'assombrit et demeura
obscur jusqu'à la neuvième heure (trois heures de l'après-midi),
moment où il mourut à l'issue de douleurs extrêmes.

La
crucifixion, fresque du VIIIème siècle.
Eglise de Santa Maria Antiqua, Rome
(archeoroma.beniculturali.it).
Si l'on en croit les Ecritures, l'instant de sa mort
s'accompagna de phénomènes extraordinaires
: séisme, fissuration du sol, déchirement du rideau du Temple
et résurrection des
morts dans les cimetières. Le centurion s'en émut et reconnut Jésus
comme le "fils de Dieu", tandis qu'un autre soldat
lui perçait la poitrine d'où sortirent du sang et de l'eau. Entretemps
on avait brisé
les jambes
des autres crucifiés pour hâter leur mort, mesure épargnée à Jésus qui
avait déjà expiré (Mt.
27, Mc. 15, Lc. 23, Jn. 19).
Le
récit de cet évènement
fondateur contient des faits dont la
crédibilité relève de la foi. Cependant les informations figurant dans ces textes nous
ont
permis de retrouver quelques éléments concrets relatifs au martyre.
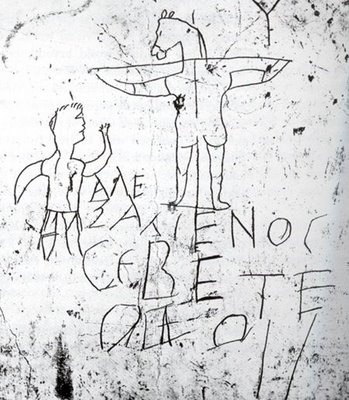
Graffiti
romain du IIIe
siècle représentant
par dérision
le Christ crucifié avec la tête d'un âne
(timothypauljones.com).
Les témoignages
historiques
Les plus anciens échos de la
crucifixion de Jésus de Nazareth apparaissent
dans la littérature antique des Ier et IIe siècles. Ce sont des écrits
émanant
d'historiens non chrétiens qui évoquent l'existence de Jésus-Christ et
sa
condamnation à mort. Le plus important d'entre eux est sans doute celui
de
Flavius Josèphe (37-97), qui écrivit vers 93 dans ses Antiquités
judaïques
:
"En ce temps-là
paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme,
car
c'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevaient avec
joie la
vérité. Il entraîna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup de Grecs ;
Celui-là était le Christ. Et quand Pilate, sur la dénonciation des
premiers
parmi nous le condamna à la croix, ceux qui l'avaient aimé précédemment
ne
cessèrent pas".
Au début
du IIe siècle, l'historien romain Tacite (v. 55-120 ap.
J.-C.) déclare dans ses Annales (15, 44) à propos d'un incendie
ayant
ravagé la ville de Rome : "Néron
accusa ceux que leurs abominations faisait détester et que la foule
appelait
chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui fut condamné sous le
principat de
Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée sur le moment, cette
détestable superstition perçait de nouveau, non pas seulement en Judée
mais
encore à Rome".

Portrait de Tacite,
réalisé
d'après
un supposé buste antique
(fr.wikipedia.org).
| 
Page des
Annales de Tacite (15, 44)
où sont mentionnés le Christ et les chrétiens
(en.wikipedia.org).
|
Un orateur syrien du
IIe siècle, Lucien de Samosate (125-192),
affirme également que le fondateur du christianisme a été crucifié : "Celui qui est honoré en Palestine, où
il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les
hommes ...
Le premier législateur [des chrétiens] les a encore persuadés qu'ils
sont tous
frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent aux
dieux des
Grecs et adorent le sophiste crucifié dont ils suivent les lois".
Citons
enfin un
document judaïque, le Talmud de Babylone (Sanhédrin 43a), compilé à
partir du
IIIe siècle et qui indique : "La
veille de Pâques, on a pendu Yéshu (Jésus). Pendant les 40 jours qui
précédèrent l’exécution, un héraut allait en criant : 'Il sera lapidé
parce
qu'il a pratiqué la magie, trompé et égaré Israël. Si quiconque a
quelque chose
à dire en sa faveur, qu’il s’avance en son nom.' Mais on ne trouva
personne qui
témoignât en sa faveur et on le pendit la veille de Pâques" [1][2].
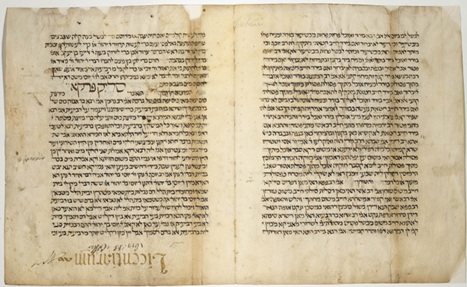
Exemplaire
du Talmud babylonien
(cdisys.com).
La crucifixion
dans l’Antiquité
En-dehors de
son application au personnage de Jésus, la pratique
de la crucifixion à l’époque romaine est attestée par d’autres textes
anciens. Cette
méthode d'exécution qui consistait à suspendre ou clouer les condamnés
sur des
planches de bois pour provoquer leur mort par asphyxie fut d'abord
pratiquée
chez les Celtes, les Perses et les Phéniciens avant d'être introduite
chez les
Romains. Ceux-ci l'utilisèrent parfois en masse, comme en 71 av. J.-C.
lorsque
six mille partisans de l'insurrection spartakiste furent crucifiés sur
la Via
Appia, ou lors de la révolte juive de 70 ap. J.-C. quand le général
Titus
fit crucifier des milliers de Juifs à Jérusalem. Considéré comme la
plus
cruelle des formes de mise à mort, ce supplice fut finalement interdit
au IVe
siècle par l'empereur Constantin.
Pendant longtemps on ne
disposa pas de trace matérielle de cette pratique barbare, jusqu'à ce
qu'en
1968 l'archéologue israélien Vassilios Tzaferis découvre dans une tombe
de
Givat ha-Mivtar, près de Jérusalem, le squelette d'un homme qui avait
été
crucifié [3]. Le corps trouvé dans un
sarcophage avait les chevilles traversées de part en part par un clou
long de
17 centimètres. L'état des poignets montrait qu'ils avaient également
été
percés de clous. Le tibia gauche présentait une fracture, indiquant
qu'il avait
reçu le coup de grâce comme le notent les évangiles. Le talon avait
éclaté,
témoignant de la violence des coups portés par le bourreau.
Le nom gravé sur le
cercueil précise l'identité du condamné : Yohan, fils de Hagakol. Son
exécution
date probablement de l'an 70, moment où Titus ordonna la crucifixion de
plusieurs milliers de Juifs. Cette découverte est l’unique preuve
archéologique
connue de la réalité de la crucifixion en Israël.

Talon
de l'homme crucifié de Jérusalem
(timesofisrael.com).
La date de la
crucifixion de Jésus
Ceux qui
reconnaissent la réalité historique de la Passion de Jésus-Christ
ont cependant encore à résoudre le problème de sa chronologie. En deux
millénaires de chrétienté, de nombreux savants ont tenté de retrouver
par le
calcul la date précise de l'évènement, sans pour autant parvenir à un
véritable consensus.
Les calculs se
fondent d'abord sur les indices temporels fournis
par les textes bibliques. Des évangiles il ressort que l'exécution a eu
lieu
une veille de sabbat, donc un vendredi, et que la Pâque juive tombait
cette
année-là un samedi. Or d'après l'Ancien Testament (Ex. 12,18), la Pâque
juive
se place le 14 ou le 15 du mois de Nisan (mars-avril). Par ailleurs,
nous
savons par des sources historiques que le gouverneur Ponce Pilate fut
préfet de
Judée de 26 à 36. Durant cette décennie, il se trouve seulement cinq
années
pour lesquelles le 14 ou le 15 de Nisan tombe un samedi. Par
recoupements, les
historiens retiennent fréquemment les deux dates les plus plausibles
pour la
crucifixion, celles du vendredi 26 mars 30 et du 3 avril 33.

Le calendrier hébreu
(johnpratt.com).
Un moyen de départager
ces deux possibilités se trouve peut-être
dans le récit de la Passion lui-même, qui décrit la survenue de
phénomènes
surnaturels et spectaculaires perçus par les témoins de la scène.
Le
premier élément de comparaison concerne les
ténèbres qui auraient accompagné la crucifixion de Jésus. A ce propos,
l'auteur
chrétien Jules l’Africain (v. 160-240) cite un historien mal connu du
Ier
siècle, un certain Thallus : "Thallus,
au troisième livre de son Histoire, explique cette obscurité par une
éclipse,
ce qui me parait inacceptable !" [4].
Il est certes tentant
d'attribuer à une éclipse l'obscurité signalée dans le récit. En fait
une
éclipse de Soleil (le Soleil masqué par la Lune) n'est pas
envisageable, car la
Pâque juive a toujours lieu en période de pleine Lune et les éclipses
de Soleil
sont alors impossibles. Seule une éclipse de Lune (la Lune dans l'ombre
de la
Terre) peut se produire pendant cette période, mais en aucun cas elle
ne peut
expliquer une telle obscurité, et certainement pas pendant trois heures.
Jules
l’Africain cite
également l'historien Phlégon de Tralles, qui aurait mentionné
l'observation
d'une éclipse anormale à cette époque : "Phlégon
rapporte qu'au temps de César Tibère, pendant la pleine Lune, il y eut
une
éclipse totale de Soleil de la sixième à la neuvième heure" [5].
Ce
passage paraît concorder de manière surprenante
avec les évangiles. Un texte comparable du même Phlégon et cité par
saint Jérôme
(347-420) en dit davantage : "La
quatrième année de la 202ème Olympiade, une éclipse de soleil se
produisit,
plus importante et plus extraordinaire que toutes les précédentes. A la
sixième
heure, le jour se transforma en nuit noire de sorte que les étoiles
furent
visibles dans le ciel. Un tremblement de terre ébranla en Bithynie de
nombreuses
constructions dans la ville de Nicée" [6].
Ces affirmations
reprises par des auteurs chrétiens ont certes
pu être influencées par le contexte religieux de leur époque ; quoi
qu’il en soit, cet extrait donne un
élément
chronologique, car la 202ème olympiade correspond à l'an 32 ou 33 de
notre ère.
Ce qui n'explique pas l'origine de l'obscurité, à moins de croire à un
véritable miracle
au sens strict.

La
Lune prend parfois une
couleur rougeâtre
pendant une éclipse de Lune
(zenit-photo.com).
Une étude publiée en
1983 dans la revue Nature par deux physiciens de l'université
d'Oxford,
Colin J. Humphreys et W. Graeme Waddington, reprenait la piste de
l'éclipse de
Lune en supposant que la Lune ait pris ce jour-là une couleur
rougeâtre, comme
pourrait le suggérer l'interprétation de certains textes [7]. Ces
chercheurs constataient avec surprise qu'une
telle éclipse avait effectivement eu lieu le 3 avril 33, l'une des deux
dates déjà
pressenties par ailleurs. Cette date emportait donc leur adhésion pour
s'apparenter
à celle de la mort du Christ. Quant à l'origine de l'obscurité, elle
serait due
à un phénomène de vent des sables. Cette conclusion est-elle
satisfaisante ? A défaut
d'un scénario plus convaincant ou plus complet, le mystère demeure.
Références :
[1] - "Jésus
a-t-il réellement existé ? Y a-t-il des
preuves historiques de son existence ?" (gotquestions.org).
[2] - P. et
D. Oddon : "Jésus Christ : preuves de
son existence historique" (info-bible.org).
[3] - V. Tzaferis :
"Crucifixion - The archaeological Evidence". Biblical Archaeology
Review, Jan/Fev. 1985, 44-53 (biblicalarchaeology.org).
[4] - G.W. Bromiley : “Jésus
Christ”, International Standard
Bible Encyclopedia, Vol. 2, E-J, p. 1034 (books.google.fr).
[5] - Ben C. Smith : "Phlegon
of Tralles on the passion phenomena" (textexcavation.com).
[6] - Ibid.
[7] - C. J. Humphreys et W.G. Waddington :
"Dating for the crucifixion". Nature, volume 306, 22-29
décembre 1983.
|