|
Le lieu précis où Jésus de Nazareth
aurait été exécuté, appelé "Golgotha" par les
évangiles, c'est-à-dire
"lieu du crâne" ou "Calvaire", était d'après ces
sources
situé tout près de Jérusalem. Deux millénaires se sont écoulés depuis,
et
l'emplacement supposé du martyre du Christ attire toujours la piété des
pélerins. Aujourd'hui, la recherche de sa localisation exacte relève de
l'enquête
archéologique.
De
timides indices descriptifs figurent dans le textes eux-mêmes. Le soir
de la
mort de Jésus, ses proches détachèrent son corps de la croix et le
déposèrent
dans une tombe implantée à proximité immédiate qu'un prêtre du Temple
et
sympathisant, Joseph d'Arimathie, mit à sa disposition. Le Nouveau
Testament
précise que cette tombe était située dans un jardin, taillée dans le
rocher,
que c'était un tombeau neuf et qu'après l'inhumation on la referma en
roulant
devant son entrée une grande pierre ronde sur laquelle on pouvait
s'asseoir
(Mt. 27-28 ; Mc 15-16 ; Lc 23-24 ; Jn. 19 ; Hb. 13).
La
basilique du Saint-Sépulcre
La plus ancienne tradition
chrétienne place le tombeau de Jésus dans l'actuelle basilique du
Saint-Sépulcre,
construite au l'intérieur de la cité historique de Jérusalem et à
l'Ouest du
mont du Temple. A l'époque de l'évènement, le site se trouvait
en-dehors de
l'enceinte fortifiée de la ville, mais celle-ci fut agrandie en vers
l'an 44,
intégrant désormais le lieu saint dans le périmètre du rempart.
Le
souvenir de l'emplacement de la tombe fut perdu au IIème
siècle, lorsqu'à
la suite de la révolte juive de 132 l'empereur romain Hadrien fit raser
tous
les lieux saints de Jérusalem. Dans le secteur de la future basilique,
il fit
élever une grande esplanade et bâtir un temple dédié à Jupiter.
En
323, l'empereur Constantin se convertit au
christianisme et s'intéressa aux lieux saints chrétiens de Jérusalem.
Il fit
démolir le temple d'Hadrien et creuser sous l'esplanade. Selon l'évêque
Eusèbe
de Césarée, c'est là que la tombe de Jésus fut retrouvée, quoiqu'il ne
précise
pas comment elle fut identifiée. Selon d'autres sources, c'est à sainte
Hélène,
la mère de Constantin, que l'on doit la découverte du Sépulcre à la
suite d'un
rêve qui lui en révéla l'emplacement.

La cour d'entrée de la basilique
du Saint-Sépulcre
(biblewalks.com).
Constantin
fit construire au-dessus de cette
tombe une immense coupole, complétée par une vaste basilique. Le caveau
fut
entièrement dégagé de la masse de calcaire qui l'entourait, et devint
un
volumineux bloc rocheux isolé que l'on appela "édicule" et qui trôna
prestigieusement sous la coupole.
L'histoire
de la basilique de Constantin est
mouvementée. En 1009, le calife arabe Al-Hakim fit entièrement démolir
le
monument, ainsi que le caveau lui-même qui fut littéralement pulvérisé
... Au
point qu'aujourd'hui il n'en reste que quelques fragments épars. La
nouvelle de
ce geste heurta les chrétiens d'Occident et contribua sans doute à
motiver le
mouvement des croisades. En 1099, les chevaliers français s'emparèrent
de
Jérusalem après cinq semaines de siège. Ils rebâtirent la basilique sur
un plan
plus modeste, celui que nous lui connaissons, et taillèrent un nouvel
édicule
pour remplacer le premier.

Edicule
de la tombe de Jésus
(biblewalks.com).
|

Plan schématique du sanctuaire
(planetware.com).
|
Aujourd'hui, l'un des lieux les
plus saints de la Terre aux yeux des chrétiens est un monument bâti
comme une
sorte de labyrinthe truffé de passages dérobés et de curiosités
historiques ;
il mérite de ce fait une brève visite virtuelle.
Vu de l'extérieur, ses
deux grandes coupoles et son clocher rapprochés lui donnent une allure
compacte, enserré au milieu des constructions annexes. L'organisation
de
l'espace intérieur, décoré à profusion, se répartit entre plusieurs
confessions
chrétiennes. La nef est occupée en son centre par un vaste choeur au
sol de
marbre entouré d'un mur, où siègent les patriarches ortodoxes. Face à
celui-ci
et sur la gauche se tient un imposant cube de pierre, qui n'est autre
que le
massif édicule du tombeau de Jésus-Christ.

Chapelle jacobite en attente de
restauration
(biblewalks.com).
| 
Tombe dite de Joseph d'Arimathie,
derrière l'église
jacobite
(christusrex.org).
|
Autour
du volume central de la basilique se
greffent plusieurs salles annexes non dépourvues d'intérêt. L'une des
chapelles
latérales qui entourent l'édicule communique avec un ancien tombeau
aménagé
dans une antique carrière et appelé sans certitude "la tombe de Joseph
d'Arimathie". Face à l'entrée principale s'ouvre un double oratoire
franciscain, ainsi qu'un long couloir en angle conduisant à une
magnifique
chapelle romane dite des Croisés.
Percé
à l'extrémité est du monument, un large
escalier descend vers une vaste salle souterraine, la chapelle
Sainte-Hélène,
qui possède elle-même encore deux ouvertures discrètes. L'une descend
vers la
citerne où la croix du Christ aurait été retrouvée, et l'autre vers une
seconde
cavité dénommée la chapelle Saint-Vartan.
A
droite de l'entrée principale, deux escaliers
étroits montent vers une double chapelle abondamment ornée d'or et
d'argent et
qui n'est autre que le traditionnel Calvaire. Un rocher protégé par une
vitrine
matérialise le point où aurait été plantée la croix.

L'autel
du
Calvaire
(biblewalks.com).
Lorsqu'on
retourne sur le parvis extérieur, on ne
manquera pas d'aller explorer une autre curiosité souterraine. En
traversant deux
pauvres chapelles copte et éthiopienne, on atteindra une petite église
copte dédiée
à sainte Hélène, qui donne accès via
un escalier rupestre à deux plans d'eau souterrains ; l'histoire admet
qu'ils
servirent de citernes au chantier de construction du premier sanctuaire.
L'importance
que les pélerins accordent au
Saint-Sépulcre ne prouve pas l'authenticité du lieu saint. Quels
éléments
pourraient l'attester ? Pour le savoir, une importante campagne de
fouilles a
été menée sur place à partir des années 1960, dans le cadre d'un
programme
interconfessionnel coordonné par le père Virgilio Corbo, du Studium Biblicum Franciscanum de
Jérusalem. Après avoir retiré le dallage du sol, les fouilleurs
trouvèrent des
vestiges qui confirmaient l'existence d'une vaste carrière durant l'ère
préchrétienne et d'un cimetière au temps de Jésus. Les tombes qui
datent
du Ier siècle accréditent le lien avec les évangiles de la Passion,
quoique
l'identification de celle de Jésus demeure incertaine.

L'église copte Sainte-Hélène
(biblewalks.com). |

L'une
des citernes souterraines
(biblewalks.com).
|
Des
recherches effectuées dans la
chapelle Saint-Vartan ont cependant donné des résultats déterminants :
d'autres
traces de carrières, un pan de mur et surtout un antique graffiti qui représente un élégant
navire marchand accompagné d'une inscription latine signifiant :
"Seigneur, nous devons partir" (Domine
ivimus). Or
cette œuvre, datée à peu près du IIème siècle, est
antérieure à l'époque byzantine ; elle prouve donc que la vénération du
site est plus
ancienne. Le site du Saint-Sépulcre semble dès lors compatible avec
l'antique tradition.

Dessin d'un navire
datant des tout premiers
siècles
(sacred-destinations.com). |

Chapelle de l'Invention de la Croix
(biblewalks.com). |
La
Tombe du Jardin
La
solution précédente paraît donc solidement établie, et pourtant
elle n'est pas la seule proposée. A partir du XVIIIème siècle en effet,
des doutes furent émis quant à l’identification du Saint-Sépulcre au
tombeau de
Jésus-Christ. Les
esprits sceptiques soulevaient
le fait que la tombe traditionnelle se trouvait à l’intérieur du
rempart de
Jérusalem, alors que la crucifixion avait eu lieu en-dehors des murs.
Partant
de cette idée, le général britannique Charles Gordon se mit à la
recherche d'un
site alternatif, et prospecta en 1883 à l'extérieur du rempart. Il
remarqua au
Nord de la ville un escarpement rocheux percé de deux grandes cavités
qui
ressemblaient étrangement aux orbites d'un crâne humain. Faisant alors
le
rapprochement avec l'expression de "lieu du crâne" citée dans
l'Ecriture, il pensa que c'était là le lieu historique de la
crucifixion.
L'hypothèse
de Gordon fit son chemin dans la
société britannique. Un rapport de fouilles de 1867 émanant de
l'archéologue
suisse Conrad Schick avait d'ailleurs déjà décrit une ancienne tombe
rupestre
découverte à quelques mètres du rocher de Gordon. La façade de cette
tombe
toujours accessible portait des traces évoquant la forme d'une grande
pierre
circulaire, ainsi qu'une rainure dans le sol, et l'intérieur consistait
en deux
petites pièces rectangulaires. Ces détails paraissant compatibles avec
les
écritures, un nombre croissant de pélerins se rangèrent à l'avis de
Gordon.
Aujourd'hui intégré à un jardin magnifique, le site est tenu par des
pélerins
protestants qui le considèrent comme la sépulture possible de Jésus de
Nazareth.

La tombe dite du Jardin
(anchorstone.com).
Cependant
les résultats des investigations ultérieures
n'allèrent pas dans ce sens. Des fouilles menées sur place par Karl
Beckholt en
1904 mirent au jour divers objets, parmi lesquels des figurines de
terre cuite
typiques de l'âge du fer. Le professeur israélien Gabriel Barkay, de
l'Université hébraïque de Jérusalem, étudia à son tour le site en 1974
et en
conclut que la disposition de la tombe du jardin indiquait également le
VIIème
siècle av. J.-C., d'autant plus qu'elle était entourée d'un immense
cimetière
lui aussi daté de l'âge du fer.
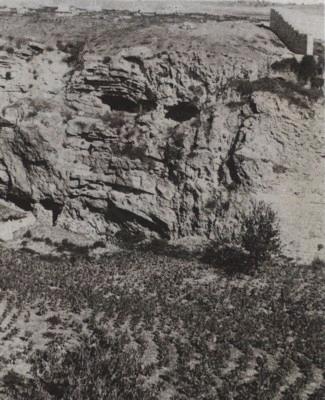
Ancienne vue de la colline
du Golgotha
selon Charles
Gordon
(users.netconnect.com.au/~leedas).
|

Le même site aujourd'hui
(wyattmuseum.com).
|
Dès lors que Jésus avait
été enterré dans un tombeau neuf, la tombe du jardin ne pouvait plus
prétendre être
la sienne. Par suite, la tombe du jardin bénéficia de moins de crédit
que celle
du Saint-Sépulcre.
Au-delà du problème de
l'authenticité de cette sépulture, les visiteurs apprécient néanmoins
son intérêt
pédagogique et le fait qu'elle est restée pratiquement dans son état
d'origine.
Le
caveau de Talpiot
En
2007, la diffusion télévisée d'un film
documentaire intitulé "Le tombeau de Jésus" fit la "une"
de la presse mondiale. Il décrivait une nécropole souterraine antique
découverte en 1980 dans le quartier de Talpiot, dans la banlieue sud de
Jérusalem. Elle contenait une dizaine d'ossuaires datant du premier
siècle,
dont six portaient des noms gravés parmi lesquels on pouvait lire des
expressions à consonance biblique : "Jésus fils de Joseph",
"Maria", "Yosé", "Matthieu", "Mariamene e
Mara" et "Juda fils de Jésus". Le cinéaste James Cameron
affirmait qu'il s'agissait sans doute là de Jésus de Nazareth et de sa
famille,
suggérant que Mariamene n'était autre que Marie-Madeleine son épouse,
et Juda
leur fils. Maria devait être sa mère, et Matthieu et Yosé ses frères.
Cette
thèse défendue par l'archéologue israélien
Simcha Jacobovichi s'appuyait essentiellement sur des calculs
statistiques
d’occurrence des prénoms et sur des analyses de l'ADN trouvé sur des
fragments
d'ossements.

L'entrée du caveau de Talpiot
(dsc.discovery.com).
La
diffusion de ce reportage souleva une controverse
passionnée et surtout beaucoup de scepticisme. Le rapprochement avec le
Jésus
des évangiles paraissait un peu forcé pour plusieurs raisons. En
premier lieu,
les prénoms trouvés sur ces ossuaires étaient très courants à l'époque,
et même
l'expression "Jésus fils de Joseph" a été retrouvée dans deux ou
trois autres tombes. Ensuite, aucun texte biblique ne présentait
Jésus-Christ
comme marié et père de famille. De même, le prénom de Marie-Madeleine
n'exisait
pas au Ier siècle, et il n'avait rien à voir avec celui de Mariamene.
Enfin,
l'absence de parenté entre Mariamene et Jésus, indiquée par l'ADN, ne
prouvait pas
qu'ils étaient mari et femme.
En
résumé, cette enquête pêchait par un manque de
rigueur et ne remporta pas beaucoup de suffrages dans le milieu
universitaire.
Conclusion
Entre
les trois sites précédemment décrits,
l'identification du véritable tombeau de Jésus de Nazareth n'est plus
guère
discutée. Une longue tradition soutient le Saint-Sépulcre, et les
résultats des
fouilles semblent le confirmer. La tombe du jardin paraît trop ancienne
pour
être celle du Christ, et le caveau de Talpiot souffre d'un lien
difficile à
établir avec les évangiles. Cela dit, le choix d'une conclusion dépend
également du regard que l'on porte sur le récit de la mort et de la
résurrection de Jésus-Christ.
Références :
[1] - J. Abela : "Le
lieu de la Résurrection".
Franciscan Cyberspot, sept. 2005.
[2] - R.H. Smith : "The
Tomb of Jesus". The Biblical
Archaeologist Vol.
XXX, 1967, 3, pp. 74-90.
[3] - J. Abela : "D'une
carrière de pierre jusqu'au jardin (VIII sec. ac - 135 dc)".
Franciscan Cyberspot, sept. 2005.
[4] - R. Hofman : "Church
of Holy Sepulchre" (BibleWalks.com).
[5] - D. Bahat : "Does
the Holy Sepulchre Church Mark the Burial of Jesus ?" Biblical
Archaeology Review,
Online
Exclusives (bib-arch.org).
[6] - "Jérusalem
: la basilique du Saint-Sépulcre". Israel Ministry of Foreign
Affairs, 2 mars 2000 (mfa.gov.il).
[7] - G. Couturier : "Un
pélerin chrétien au Saint-Sépulcre". Interbible, Le Saint-Sépulcre
7/8 (interbible.org).
[8] - S. Davies
:”Thomas : The Fourth
Synoptic Gospel”. The Biblical Archaeologist, Vol. 16,
No
1 (Winter 1983), pp. 6-1.
[9] - "La
Tombe du Jardin".
Brochure
distribuée à l'entrée du lieu-dit "la
Tombe du Jardin" (idumea.org).
[10] - H.
Hayes : "Garden
Tomb, Jerusalem".
Sacred
Destinations, Feb. 11, 2010 (sacred-destinations.com).
[11] - G.
Barkay : "The Garden
Tomb – Was
Jesus buried Here ? " Biblical
Archaeology Review, March/April 1986, pp. 40-55 et 56-57.
[12] - G.
de Lansalut , S. Amar : "A-t-on
retrouvé le tombeau de Jésus ?". Le
Monde des Religions n°
24, 1er juillet 2007 (lemondedesreligions.fr).
[13]
- G. Franz : "The
So-Called Jesus
Family
Tomb “Rediscovered” in Jerusalem”. Associates
for Biblical Research, 17 mars 2007
(biblearchaeology.org).
[14] -
S. Pfann : "The Improper
Application of Statistics in "The Lost Tomb of Jesus" ".
University
of the Holy Land, 2007 (uhl.ac).
|