|
La
relique la plus célèbre du monde, pieusement conservée
dans la cathédrale de Turin, est un drap de lin de plus de quatre
mètres de
long sur un de large, et dont la surface présente l'image floue d'un
homme
portant des traces de coups et de blessures. De nombreux chrétiens le
considèrent comme le tissu qui aurait enveloppé le corps de Jésus de
Nazareth après
sa mort, alors que d'autres y voient un simple toile ou œuvre d'art.
Cet objet
a été soumis à des études scientifiques très poussées, et la question
de son
authenticité suscite toujours de vives controverses.
Le Linceul dans l'Histoire
Le Nouveau
Testament évoque brièvement un "linceul
blanc" acheté par Joseph d’Arimathie pour envelopper le corps de
Jésus lors de son inhumation. Les récits des trois premiers évangiles
en font état,
tandis que celui de Jean parle de bandelettes ayant entouré le corps
(Mt. 27,
59 ; Mc. 15, 46 ; Lc. 23, 53 ; Jn. 19, 40 ; 20, 7).
Le destin de ce tissu n'est plus
évoqué après
la Résurrection de Jésus. Un objet considéré comme tel est bien
conservé
aujourd’hui à Turin, mais son existence n’est attestée historiquement
qu’à
partir du XIVème siècle. Quel a pu être son itinéraire avant cette
date ?
Pour tenter de combler ce vide, une
hypothèse a été émise en 1978 par l'écrivain anglais Ian Wilson, qui
proposait
d'assimiler le Linceul de Turin à une autre relique aujourd’hui
disparue, le
"Mandylion d'Edesse". Il s’agissait d’une toile qui circulait entre
le Ier et le XIIème siècles de notre ère, et qui portait, dit-on,
l'image du
visage de Jésus. Selon la théorie de Wilson, le Mandylion ne serait
autre que
notre Linceul, mais replié de manière à ne montrer que sa face.

Une
représentation supposée du Mandylion
d'Edesse : la Sainte Face de Gênes
(fr.wikipedia.org). | 
Une image
médiévale
du Saint Suaire sur une médaille de pélerinage
(shroud.info - Copyright Holger Kersten).
|
L'enquête rapporte
une curieuse chronique attribuée à l'évêque Eusèbe de Césarée, d'après
laquelle
c’est Jésus ressuscité lui-même qui aurait offert le Mandylion au roi
d’Edesse,
Abgar, en réponse à une lettre du monarque ! C’est en tout cas dans
cette ville
de l‘Est de la Turquie que le Mandylion semble avoir été conservé à
partir du
Ier siècle. En 943, il fut cédé aux Byzantins qui assiégeaient la
ville. Ceux-ci
le transférèrent à Byzance, où il demeura jusqu’à la prise de la ville
par les
Croisés en 1203. Le Mandylion disparaît alors des annales de l’Histoire.
La relique appelée le "Saint
Suaire" apparaît quant à elle en 1353 à Lirey, près de Troyes, dans le
domaine de la famille de Charny où les pèlerins affluaient pour
l'admirer. En
1453, l'objet fut offert aux ducs de Savoie, qui l'installèrent d'abord
à
Chambéry, puis en 1578 à Turin où il demeura jusqu'à nos jours.

Le roi Abgar recevant le Mandylion.
Peinture
médiévale
(fr.academic.ru).
Les
premières études scientifiques
En 1898, le
photographe italien Secondo Pia prit le tout premier cliché du Linceul.
Il ne
s’attendait pas à ce que l'épreuve négative montre une image en positif
beaucoup
plus nette qu'en lumière naturelle. D'innombrables détails jusque-là
invisibles
se révélèrent sur la silhouette humaine.
Le monde scientifique commença
alors à s'intéresser à la relique. Une série d'examens fut entreprise,
notamment
par le docteur Pierre Barbet, chirurgien à l’hôpital Saint-Joseph de
Paris. Son
étude anatomique, publiée en 1950, menait à la conclusion que "l'homme
du
Linceul" portait tous les signes apparents d’une crucifixion. Plus
précisément, l'examen de l'image révélait de
nombreuses traces évoquant le martyre de Jésus-Christ : coups de fouet,
cicatrices, taches de sang, blessures sur l'épaule, plaie sur la
poitrine,
marques d'épines autour du crâne ...
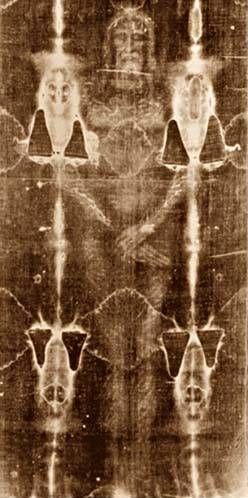
Le linceul de Turin vu
en image négative
(1000questions.net).
Ce
n'était que le début des investigations
scientifiques qui seraient faites sur le Linceul. En 1973, le
criminologue
suisse Max Frei décela sur le tissu plusieurs variétés de pollens, dont
l'examen
montra qu’ils appartenaient à des essences végétales connues au
Proche-Orient, en
particulier en Judée.
Une
commission scientifique internationale se
constitua en 1978 sous le nom de Shroud
of Turin Research Project (STURP), et réunissait des spécialistes
de
disciplines variées. Sous la supervision de Raymond Rogers, chimiste au
Laboratoire National de Los Alamos en Californie, des analyses
approfondies
furent réalisées à l’aide de techniques de pointe. Pour l’occasion,
sept tonnes
de matériel furent déplacées des Etats-Unis ! Les analyses
portèrent
essentiellement sur l’image et sa composition, et permirent de conclure
que
l’image était formée par l'oxydation de certaines fibres du tissu. Mais
personne ne pouvait expliquer comment elle
avait été produite.

Réunion de
chercheurs du
STURP
préparant l'étude du suaire en 1978 à
Turin
(metalog.org).
| 
Echantillonnage
réalisé par le
médecin-légiste
Max Frei, en vue d'une étude pollinique
(shroud2000.com).
|
La datation au carbone 14
Il
parut alors opportun, pour vérifier l'ancienneté
de l'objet, de le soumettre aux méthodes modernes de datation par
radiochronologie, en l'occurence celle du carbone 14. En 1988, trois
échantillons du Linceul furent donc confiés pour analyse à trois
laboratoires équipés
de spectromètres de masse par accélérateur : l’Université d’Oxford,
l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Zurich et l’Université de Tucson. Les
résultats de leurs
travaux furent annoncés six mois plus tard : le Linceul de Turin
remontait au
Moyen Age, et avait été confectionné entre 1260 et 1390.
La diffusion de ce
résultat dans les médias produisit l’effet d’une bombe. Tandis que
l'Eglise
catholique acceptait le verdict avec résignation, la nouvelle ne manqua
pas
d'entraîner un déchaînement de passions entre les adversaires et les
partisans
de l’authenticité de l'objet.
Ce résultat était surprenant
parce qu’il entrait en totale contradiction avec ceux des études
précédentes. Pour
expliquer cet âge inattendu, de nombreuses explications plus ou moins
fantaisistes furent invoquées par les tenants de l'authenticité. Le
professeur
Thomas Phillips, physicien à l'Université de Harvard au Massachusets,
imagina par
exemple que l'instant de la Résurrection s'était accompagné d'un
rayonnement
radioactif de neutrons issu du corps ...

Le
Docteur Tite annonçant les résultats
de la datation au radiocarbone en 1988
(spqr7.wordpress.com).
D'autres mécanismes moins "exotiques"
furent également proposés. Une contamination du tissu en carbone plus
récent pouvait
avoir faussé les mesures. Ainsi, le microbiologiste Stephen Mattingly,
de
l’Université de San Antonio au Texas, soupçonna une formation de
matière
organique dans les fibres d'avoir "rajeuni" le support. D'autres
attribuèrent le mauvais résultat à des
dépôts de poussières ou de suie qui se seraient formés au cours des
siècles. Le
nettoyage préliminaire des échantillons avait pourtant été effectué par
les
laboratoires selon des méthodes de dépollution éprouvées.
L'étude la plus pertinente paraît être un travail
de Raymond Rogers, qui constata lors d'examens réalisés par
fluorescence, que
la zone prélevée pour les analyses possédait une composition chimique
différente de celle du reste du Linceul. La présence dans le tissu de
fibres
plus jeunes, probablement due à des raccomodages, impliquait que les
échantillons datés n'étaient pas représentatifs du tissu d'origine.
Autres
travaux sur le Linceul
La
bibliothèque nationale de Budapest, en Hongrie,
possède un vieux manuscrit enluminé qui contient un indice
chronologique
important. Le précieux ouvrage appelé le codex de Pray est daté d'entre
1150 et
1165, et il contient des illustrations peintes de la Passion qui
présentent manifestement
des points communs avec la relique de Turin : le Christ mort est figuré
dans la
même position que l'homme du Linceul, le maillage du tissu est
identique et il
comporte quatre points disposés en L qui correspondent à quatre trous
de
brûlure réels. Si ces détails ne sont pas le fruit du hasard, ils
suggèrent que
l’objet existait déjà au XIIème siècle, en contradiction avec les
résultats du radiocarbone.

Une
représentation supposée
du "Saint Suaire", illustrant le Codex de Pray
(fr.wikipedia.org).
D'autres études faisant appel à des disciplines
scientifiques variées ont encore été menées. Ainsi une photo agrandie
du
Linceul a-t-elle un jour permis au père jésuite Francis Filas, de
l'Université
Loyola de Chicago, de reconnaître sur l’œil droit la forme probable de
quatre
lettres : UCAI. Un examen plus
attentif lui permit également de déceler la forme imperceptible d'une
pièce de
monnaie, qu'une expertise permit d'identifier à un type de pièce
romaine connue
: le dilepton lituus.
Dans la
Jérusalem du Ier siècle,
les Juifs déposaient parfois des pièces de monnaie sur les paupières
des
personnes décédées afin d'empêcher les yeux de se rouvir. Le dilepton lituus porte l'effigie de l'empereur
Tibère et fut émis par Ponce Pilate. Les lettres UCAI appartiennent à
l'expression grecque TIBEPIOU CAICAPOC (de Tibère César) et sont
accompagnées d'une
date d'émission : LIS, soit l'an 30 de notre ère.
En 1996, ce fut au tour de l'œil gauche de révéler
l'image d'une piécette. Les professeurs Pierluigi Baima Bollone et
Nello
Balossino, de l’Université de Turin, découvrirent la trace d'un lepton simpulum tel que ceux qui étaient
frappés en 29 de notre ère.

Découverte des
images
de
pièces de monnaie
(treasureexpeditions.com).
| 
Images de pièces
de monnaie
émises
par Ponce Pilate
(empereurs-romains.net).
|
L'image
du Linceul réservait encore bien des
surprises aux chercheurs. Le physicien français André Marion, de
l’Institut
d’Optique Théorique et Appliquée d’Orsay, découvrit une série de
lettres
majuscules inscrites autour de la silhouette. Ce
résultat fut obtenu par des méthodes de traitement
d'images numériques, et permit de lire les mots suivants : HSOU
("Jésus"), NAZARENOS ("Nazaréen"), JC, INNECE
("Conduit à la mort"), REZW ("sacrifice") et YSKIA
("Ombre de visage"). La raison d'être de ces caractères fut peut-être
le souci de marquer la nature de l'objet dans une période d'incertitude.
L'analyse minéralogique a également apporté sa
contribution. Sous les pieds de l'homme du Linceul, des restes de boue
séchée furent
découverts en 1982 par Joseph Kohlbeck, cristallographe au Hercules
Aerospace Center de l’Utah. Leur étude révéla un type
particulier de calcite, l'aragonite de travertin, spécifique des sols
de Judée
et de Jérusalem.
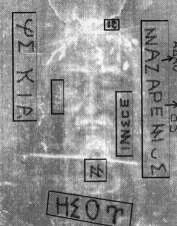
Inscriptions trouvées sur le tissu
(perso.wanadoo.fr/gira.cadouarn).
Mais c'est
peut-être en biochimie que la relique a suscité le plus de travaux.
D’après les
analyses de Raymond Rogers, les fibres du Linceul ne comportent aucune
trace de
vanilline, une substance végétale présente dans tous les tissus et qui
se
dégrade peu à peu. Si le Linceul ne datait que du Moyen Age, il devrait
encore
contenir de la vanilline.
Les taches de sang présentes sur
le Linceul ont bien sûr été soigneusement étudiées. Ce sang est humain
et
appartient au groupe AB. Détail particulier, il contient les indices
d'une
sécrétion de bilirubine typique d'une hématidrose, une pathologie
connue pour ses douleurs insupportables.
L'origine
de l’image
A ce jour, le
mécanisme qui a fait naître la silhouette humaine visible sur le drap
de Turin
n’est toujours pas identifié. Des nombreuses tentatives d'explication
proposées, aucune ne satisfait pleinement les propriétés du Linceul.
L'observation
au microscope montre que l'image est due non pas à un colorant mais à
l'oxydation de certaines fibres, et seulement en surface du tissu. En
outre,
l'image ne s'est pas formée par contact direct avec le corps, mais
plutôt par
projection spatiale.
L’une des
études les plus
approfondies, publiée en 2003 par Rogers et Arnoldi, fait appel à un
type de réaction
chimique dite "de Maillard" qui se serait produite entre certaines
molécules du corps et des composés présents sur le drap. Mais ce
processus
n’explique que partiellement le résultat attendu. D'autres mécanismes
ont
encore été proposés, sans qu’aucun ne satisfasse l’ensemble des
particularités
du Linceul.

Etude du linceul par fluorescence
(avantes.com).
L’hypothèse
d’une contrefaçon
Dans
l’alternative, l’hypothèse d’une œuvre d’artiste pose des difficultés
encore
plus grandes. Si le tissu est de fabrication médiévale, les
connaissances scientifiques
disponibles à cette époque auraient-elles permis de réaliser un tel
objet ? Quelles motivations pourraient avoir poussé un
faussaire du
Moyen-Age à produire une pièce aussi savamment élaborée ? Les tenants
de
l’authenticité considèrent que cette hypothèse implique trop
d’anachronismes
pour pouvoir être sérieusement envisagée.
On n’en finirait pas de
répertorier tous les travaux scientifiques déjà effectués sur le
Linceul. En résumé,
deux grands problèmes persistent. D'une part, la datation au
radiocarbone
contredit les autres observations, et d'autre part le mécanisme de la
formation
de l’image résiste à toutes les théories. Le Linceul de Turin n'a pas
fini de
nous surprendre.
Références
:
[1] - D. Raffard de Brienne :
"L'Histoire du saint Suaire". Dossiers d'Archéologie,
Jésus dans l'Histoire, n° 249, déc. 1999-janv. 2000.
[2] - P. Barbet : "La
Passion
de N.S. Jésus-Christ selon le chirurgien". Ed.
Mediaspaul, 1986.
[3] - R. Rogers, A. Arnoldi :
"Scientific Method
Applied to the Shroud of Turin. A
Review".
[4] -
P.E. Damon, D.J. Donahue, B.H. Gore, A.L. Hatheway,
A.J.T. Jull, T.W. Linick, P.J. Sercel, L.J. Toolin, C.R. Bronk, E.T.
Hall,
R.E.M. Hedges, R. Housley, I.A. Law, C. Perry, G. Bonani, S. Trumbore,
W.
Woefli, J.C. Ambers, S.G.E. Bowman, M.N. Leese, M.S. Tite :
"Radiocarbon
dating of the Shroud of Turin". Nature
vol 1337, february 1989.
[5] - R. N. Rogers : "Studies on the
radiocarbon
sample from the shroud of Turin". Thermochimica Acta
425 (2005) 189-194.
[6] - P. de Riedmatten : "20
ans après le test au carbone 14". Bulletin
du MNTV, mars 2009.
[7] - H.E. Gove, S.J. Mattingly,
A.R. David, L.A.
Garza-Valdes : "A problematic source of organic contamination of
linen". Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research B 123 (1997), 504-507.
[8] - A.J.T. Jull , D.J. Donahue
and P.E. Damon :
"Factors affecting the apparent radiocarbon age of textiles : a comment
on
"Effects of fires and biofractionation of carbon isotopes on results of
radiocarbondating of old textiles : the Shroud of Turin", by D.A.
Kouznetsov et al". Journal of Archaeological Science
(1996)
23,
157-160.
[9] - M. Alonso :
"Travaux scientifiques
récents effectués sur le suaire de Turin". Montre-Nous Ton Visage No 35, pp.
19-33.
[10] -
A.E. Albini : "Missing
link coin of Pontius Pilate proves authenticity,
place of origin, and approximate dating of the shroud of Turin".
Loyola
University of Chicago, september 1, 1981.
[11] - A. Marion : "Discovery of
Inscriptions on the Shroud of Turin by Digital Image Processing". Optical
Engineering, Vol. 37, 2308
(1998) (résumé).
[12] - D. Daguet : "Linceul de
Turin : qui trahit la science ?" France Catholique n° 2985,
15
juillet 2005, pp. 24-27.
[13] - D.R. Porter : "Travertine
Aragonite found on the Shroud of Turin - Implications in the Quest for
the Historical Jesus".
[14] - R. Rogers, A. Arnoldi :
"Scientific Method
Applied to the Shroud of Turin. A
Review", 2002.
[15] - R. N. Rogers : "Studies on the
radiocarbon sample from the shroud of Turin". Thermochimica
Acta
425 (2005) 189-194.
[16] - D. Daguet : "Linceul de
Turin : qui trahit la science ?" France Catholique n° 2985,
15
juillet 2005, pp. 24-27.
[17] - G. Govier : "The
shroud's second image". Christianity Today, December 2004, Vol. 48, No. 12.
[18] - M. Alonso : "Travaux
scientifiques récents effectués sur le suaire de Turin". Montre-Nous Ton Visage No 35, pp.
19-33.
[19] - R. Rogers, A. Arnoldi : "The
Shroud of Turin : an amino-carbonyl Reaction (Maillard Reaction)
may
explain the Image Formation". Melanoidins
Vol. 4, Ames J.M. Ed., Office for Official Publications of
the European Communities,
Luxembourg 2003, pp. 106-113.
|