Le jeune berger
nommé David,
devenu chef de guerre, fut couronné roi à la place de Saül par le
prophète
Samuel. Se montrant plus fidèle aux commandements divins que son
prédécesseur, le
nouveau monarque s’installa d'abord à Hébron, puis il s'empara de
Jérusalem alors
occupée par le peuple jébuséen. David fit de Jérusalem sa capitale, la
déclara
ville sainte et y fit entrer l'Arche d'Alliance.
Le règne de
David est connu pour sa renommée de gloire politique et militaire,
associée à
une piété sans faille envers le dieu Yahweh. Il commit cependant une
grave faute
en s'appropriant une femme, Bethsabée, dont il fit périr le mari. Dieu
ne laissa
pas ce forfait impuni et suscita au roi des ennemis étrangers, ce qui
provoqua
des guerres répétées. Cependant Israël fut chaque fois vainqueur et
David en profita
pour étendre son territoire. Ainsi le roi d'Israël soumit-il une grande
partie
de Canaan et battit également les Philistins, les Syriens, les
Edomites, les
Moabites, les Ammonites et les Amalécites. David noua une alliance avec
un roi
phénicien, Hiram de Tyr, avec qui il entretint d'étroites relations
diplomatiques
et commerciales.
Sa politique intérieure
est marquée notamment par une révolte fomentée par l'un de ses fils, le
rebelle
Absalom, qui tenta un coup d'Etat mais échoua. L'héritage spirituel de
David compte
une contribution personnelle au contenu littéraire de la Bible,
puisqu'on lui attribue
la rédaction d'une grande partie du livre des psaumes, recueil de
prières poétiques
qu'il prononçait accompagné de sa harpe (2 Sm.).
Données
archéologiques
Les
historiens de la Bible placent traditionnellement le règne de David au
début du Xème siècle
avant notre ère, entre 1010 et 970 environ.
Des
recherches récentes ont pourtant remis en question l'importance du
premier Etat hébreu. Beaucoup
d'archéologues pensent aujourd'hui que le royaume israélite, pour
autant qu'il
ait existé, devait se limiter à un domaine beaucoup moins étendu et
puissant
que la description qu'en font les Ecritures.
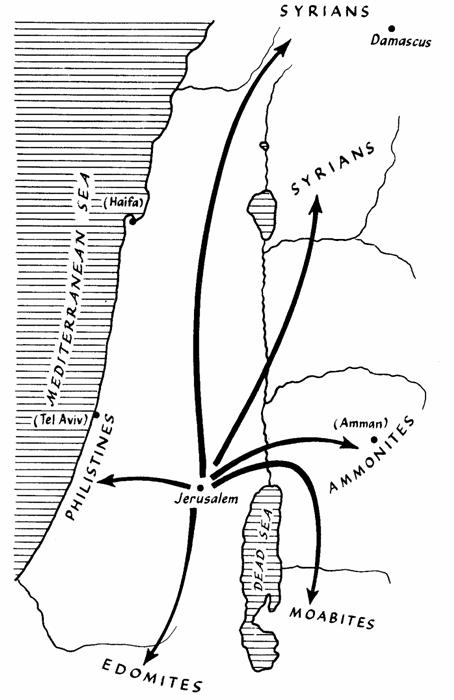
Les guerres de David
(yahwehsword.org).
Plusieurs
raisons expliquent cette prise de distance actuelle des érudits à
l'égard du
texte biblique. D'abord l'existence du royaume d'Israël manque de
citations
dans les archives étrangères. De plus, la répartition des traces de la
présence
israélite sur le territoire hébreu de l'époque montre une habitat épars
et très
réduit qui signe une population peu nombreuse. Enfin, la ville de
Jérusalem avait
sans doute peu d'importance et se limitait à un modeste village
fortifié.
La
démographie de la population israélite au Xème siècle a été évaluée à
partir de
la répartition des restes d'habitations. Le plan caractéristique de
leurs
maisons comprend souvent quatre pièces et une cour intérieure
délimitées par
des piliers. Elles sont parfois accolées entre elles pour former un
enclos,
comme dans un campement pastoral. Au Xème siècle, la répartition de
leurs ruines
dans la partie sud d'Israël qui entourait la capitale montre que la
population
ne dépassait pas cinq mille habitants, contrairement aux Etats voisins
nettement plus peuplés.

Maison à quatre
pièces israélite
(hadashot-esi.org.il).
Ces
résultats ont semé le doute auprès d'une majorité de chercheurs quant à
l'existence du royaume de David tel qu'il est rapporté dans la Bible,
et ce
sujet fait désormais l'objet de discussions passionnées au sein du
monde universitaire.
Nous évoquerons quelques éléments du dossier dont certains sont parfois
oubliés
ou rarement pris en compte dans le débat.
Depuis 1993, une
inscription témoigne incontestablement de l'existence dans l'Antiquité
d'un monarque
israélite nommé David. Il s'agit d'une stèle de basalte découverte à
Tel Dan, dans
le nord du pays, par Avraham Biran, archéologue au Hebrew
union College de Jérusalem. Le bloc était inséré en réemploi
dans ce qui reste d'un mur de l'ancienne ville. De forme initialement
carrée mais
retrouvé brisé en plusieurs morceaux, il comporte un court texte de
treize
lignes gravé en araméen. L'inscription a été traduite par le professeur
français André Lemaire, épigraphiste à l'Ecole des Hautes Etudes de
Paris, et signifie
: "... j'ai tué Achaz-Yahu, fils de Joram, roi de la maison de David".
L'auteur de l'inscription est apparemment le roi Hazaël de Damas, un
monarque qui
vécut postérieurement à David au IXème ou du VIIIème siècle avant notre
ère [1][2].
L'expression "maison
de David" qu'expriment les lettres BYTDWD (Beyt David)
peut se comprendre par "dynastie royale dont David
est le premier roi", comme c'est le cas pour d'autres inscriptions de
l'époque. De plus, les autres monarques mentionnés sur la stèle de Tel
Dan figurent
bien dans la généalogie biblique. Ce document constitue la plus
ancienne
référence extra-biblique au roi David. Depuis cette découverte, la
réalité d'un
ancien royaume de David est désormais généralement admise, bien que son
étendue
géographique et son importance politique demeurent discutées.

La
stèle de Tel Dan
(interbible.org).
La prise de
Jérusalem - le puits
de Warren
Au
tournant du premier millénaire avant notre ère, Jérusalem était une
simple
bourgade implantée sur l'une des collines arides de la longue chaîne
montagneuse nord-sud qui sépare la grande plaine côtière
méditerranéenne de la
vallée du Jourdain. L'agglomération primitive se concentrait sur la
pente sud
de l'actuel mont du Temple, limitée à l'est par la vallée du Cédron et
au
sud-ouest par celle du Tyropéon. La première ville que l'on nomme
aujourd'hui
"Cité de David" ne présentait pas un intérêt stratégique particulier.
Un
épisode de la mise en place du royaume de David semble avoir trouvé une
illustration sur le terrain. Le second livre de Samuel évoque la prise
de
Jérusalem par le roi d'Israël alors que la ville était occupée par le
peuple
jébuséen, évènement évoqué brièvement par un seul verset au contenu peu
explicite
(2 Sm. 5, 7-8) :
"David
s'empara de la forteresse de
Sion, qui est la cité de David. Et David dit en ce jour-là : Quiconque
veut
frapper le Jébuséen, qu'il atteigne le canal".
Le sens de ce
texte, incompréhensible à première vue, fut élucidé par le capitaine
britannique Charles Warren en 1867. Le "canal", ou "tunnel"
(tsinnor en hébreu), est un passage
souterrain qui relie l'intérieur de la ville à une source d'eau
extérieure, et
qui servit probablement aux Israélites pour pénétrer à l'intérieur des
murs et
soumettre la ville forte. Sa redécouverte fut le résultat d'une
aventure périlleuse.
Warren
découvrit le passage en visitant la source du Gihon, ou fontaine de la
Vierge, un
point d'eau qui coule dans la vallée du Cédron en contrebas de la
ville. On y
accède par un court escalier abrité sous une vieille voûte, et
descendant vers
une grotte qui recueille les infiltrations d'eau de pluie. Lorsque
Warren la
visita, son attention fut attirée par un trou sombre qui s'ouvrait dans
le
plafond de cette cave. N'ayant obtenu aucun information à ce sujet, il
y revint
muni d'une échelle et d'une corde, et se hissa dans la cheminée
verticale. Il
gravit quinze mètres d'un conduit abrupt, à l'extrémité duquel le
passage se
poursuivait par une galerie inclinée. Il la suivit jusqu'à atteindre un
escalier qui remontait vers l'intérieur d'une longue salle voûtée dont
le sol
était jonché de poteries. Cette salle était située en plein coeur du
quartier
le plus ancien de la ville, appelé au jourd'hui la cité de David.
Warren sortit
facilement à l'air libre par une discrète fissure [3].

Le puits de Warren
(larryavisbrown.homestead.com).
| 
Coupe du
puits de Warren
(bible.gen.nz).
|
On
pensait encore récemment que le puits de Warren ne datait que des
environs de
l'an 1000 av. J.-C.. En fait il s'avéra qu'il était même beaucoup plus
ancien,
car des prélèvements de la croûte calcaire faits dans la paroi du puits
et
analysés par le géologue Dan Gill, de la Commission Geologique
d'Israël, donnèrent
une composition isotopique exempte de carbone 14, ce qui implique un
âge de
plus de 40 000 ans [4]. Autrement
dit, la partie
verticale du conduit est probablement le résultat d'une longue érosion
naturelle.
En 1995, des travaux
d'aménagements effectués dans la galerie de Warren afin de la rendre
plus facilement
accessible, révélèrent par hasard un nouveau passage inconnu. Les
chrecheurs Ronny
Reich et Eli Shukron, du Service des Antiquités d'Israël, explorèrent
ce boyau
qui reliait directement la partie inclinée de la galerie à un bassin
extérieur plus
proche de la source du Gihon, en évitant le puits vertical. Son accès
extérieur
était jadis protégé par une tour de défense dont les vestiges furent
découverts
à cette occasion. Les céramiques trouvées dans ce tunnel ont également
donné un
âge très ancien, remontant au moins au XVIIIème siècle av. J.-C.. Ce
système de
galeries était sans doute déjà en place lorsque les hommes de David
pénétrèrent
dans la cité [5].
Le palais de
David
Le débat sur
l'existence
et l'importance historique du royaume de David a été alimenté en 2005
par une
découverte architecturale majeure effectuée à Jérusalem. Il s'agit rien
de moins
que des vestiges supposés de sa résidence principale, dont la mise au
jour fut
le fruit d'un patient travail de détective qui mérite d'être relaté en
détail.
Dans le deuxième
livre de Samuel, il est écrit que lorsque David s'installa dans
Jérusalem, il se
fit construire une résidence royale :
"David
s'établit dans la forteresse,
qui fut appelée "cité de David", et David bâtit alentour, depuis
Mello, et à l'intérieur. Et David allait toujours grandissant, et
Yahweh, Dieu
des armées, était avec lui. Hiram, roi
de Tyr, envoya à David des messagers, avec des bois de cèdre, des
charpentiers
et des tailleurs de pierre d'appareil, qui bâtirent une maison à David"
(2 Sm. 5, 9-11).
La maison bâtie
pour David selon ce verset devait être sans doute une somptueuse
demeure, qui
fut l'objectif de nombreuses recherches archéologiques longtemps
restées infructueuses.
Le bâtiment devait a priori se
trouver dans la partie de Jérusalem correspondant à ce qu'elle était au
temps des
Jébuséens, et appelée aujourd'hui cité de David. Les fouilles conduites
à
l'intérieur de ce périmètre par le professeur israélien Yigal Shiloh,
l'Université
hébraïque de Jérusalem, ne révélèrent pourtant aucun vestige
susceptible de
s'apparenter à un palais royal antique. Le prestige du grand monarque
ne semblait
décidément pas devoir sortir du domaine de la légende.
C'était sans
compter avec la perspicacité d'une jeune archéologue israélienne, Eilat
Mazar,
qui rêvait depuis longtemps de mettre au jour les restes de
l'hypothétique
palais. Née d’une famille d’archéologues, elle avait étudié
l'architecture phénicienne
avant de se recentrer sur les fouilles de l'ancienne Jérusalem.
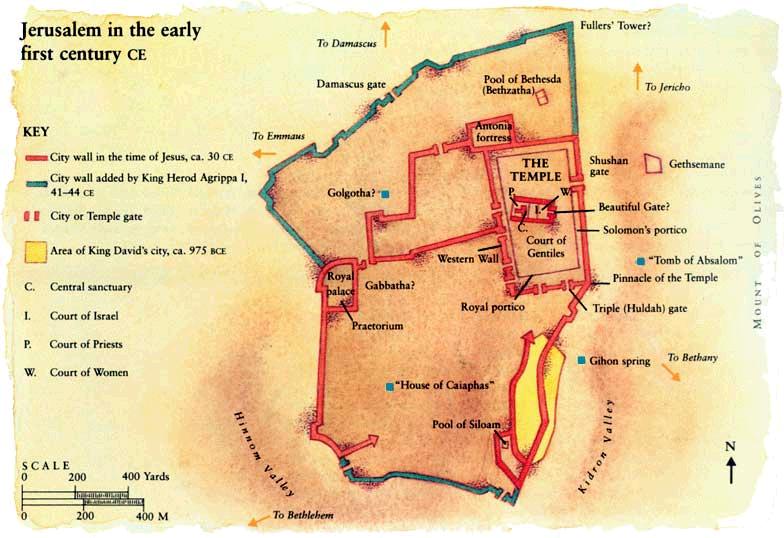
Plan de
Jérusalem
(bible-history.com).
| 
Situation
du palais sur une hauteur de la ville
(leaderu.com ;
© Leadership U.).
|
Eilat Mazar
avait participé aux recherches effectuées à l'intérieur de la cité de
David. Elle
se persuada pourtant qu'on n’avait pas fouillé au bon endroit, car
plusieurs
indices suggéraient selon elle qu’il fallait chercher le bâtiment non
pas dans
le périmètre de la cité de David, mais plutôt à l’extérieur et au nord
de
celle-ci [6].
Pourquoi le
palais devait-il se trouver en-dehors de l'enceinte ? D’abord à cause
d’un
détail topographique fourni par le second livre de Samuel. Lorsque le
roi David
s'installa à Jérusalem, il fut menacé par une attaque philistine et
alla se
mettre à l'abri en "descendant vers
la forteresse" (2 Sm. 5, 17). S'il descendait vers la cité
fortifiée, le verset pouvait sous-entendre que la résidence royale
était bâtie à
l'extérieur et en hauteur par rapport à l'enceinte.
Un autre indice
fut fourni par d'anciennes fouilles qui avaient été conduites dans les
années
1960 par l’archéologue britannique Kathleen Kenyon. Sur le flanc
nord-est de la
colline où la cité jébuséenne était bâtie, elle avait dégagé un
important mur de
soutènement curieusement assemblé en forme d'escalier. Cette structure
particulière
devait logiquement soutenir un monument important ayant justifié sa
construction. Elle datait selon toute apparence du Xème siècle av.
J.-C., précisément
de l’époque supposée de David.
Mais l'élément
le plus déterminant pour Eilat Mazar fut la dernière conversation
qu’elle eut
en 1995 avec son grand-père, l’archéologue Benjamin Mazar. Il lui
révéla que
Kathleen Kenyon avait également trouvé au pied du mur en escalier
plusieurs
grosses pierres de taille, et notamment un volumineux chapiteau de
colonne d'un
mètre cinquante de long sculpté avec des motifs d'ornements enroulés en
spirale. Mazar alla consulter les archives de Kenyon et reconnut dans
ce bloc le
style "proto-éolique", ou "proto-ionique", caractéristique
des constructions de l'ancienne Phénicie.

Sommet de colonne de style
phénicien
(bib-arch.org).
Dès lors les
éléments du puzzle prirent tout leur sens. L'indice d'une origine
phénicienne permettait
de faire le lien avec l'Ancien Testament, du fait que le palais
biblique de
David aurait précisément été l'œuvre du Phénicien Hiram de Tyr. La
résidence davidique
porterait ainsi la marque de ses bâtisseurs. Les pierres trouvées en
bas de
l'escarpement avaient dû tomber d'un édifice construit au sommet et au
nord de la
cité de David. Il parut désormais clair qu’il fallait mener les
fouilles de ce côté-là.
La jeune
archéologue,
décidée à ouvrir un nouveau chantier de fouilles à cet emplacement, se
mit en
quête d'un financement auprès de divers organismes. Après dix ans de
démarches infructueuses,
elle reçut enfin le soutien financier d'un institut de recherches sur
la
culture juive appelé le Centre Shalem et installé à Jérusalem. Le
nouveau chantier
archéologique fut ouvert en 2005 au nord de l’ancienne cité de David.

Plan de Jérusalem et de
la cité de David
(womeninthebible.net).
Les résultats
ne se firent pas attendre. Quelques centimètres sous la surface du sol
on découvrit
les restes d'une luxueuse construction d’époque byzantine qui intégrait
un splendide
sol en mosaïque. Sous ce niveau se révéla une résidence de la fin du
premier
siècle comprenant plusieurs bassins rituels. Enfin apparut une
structure assemblée
en plus gros appareil.
Les fouilleurs
dégagèrent des murs d’une épaisseur impressionnante (jusqu’à cinq
mètres) qui
se prolongeaient dans plusieurs directions. L'ensemble devait occuper
une vaste
surface et constituer un édifice de très grande taille, que des tessons
de
poterie permirent de dater des alentours de l’an 1000 av. J-C. [7][8][9]. D'autres
objets furent également exhumés, notamment des sceaux d'argile, et la
période
d'occupation du bâtiment se prolongeait même longtemps après le Xème
siècle. Les
objets exhumés témoignaient clairement d'un contexte hébreu, dont des
sceaux qui
portaient les noms et titres de deux serviteurs du roi de Juda Sédécias
cités
dans le livre de Jérémie (37, 3).

Sceau de terre cuite
(leaderu.com).
La fonction de
l'édifice dégagé restait encore à confirmer. De toute évidence, sa
construction avait dû nécessiter de très gros moyens que seul un Etat
puissant
permettait d'envisager. Dans ce contexte, le palais biblique du roi
David
apparaissait donc comme le candidat idéal dans l'identification du
monument.
La
découverte de ce bâtiment a rendu une certaine crédibilité aux récits
des premiers temps de la monarchie israélite. Même si rien ne prouve
que ces
murs sont effectivement ceux du palais royal évoqué dans la Bible,
leurs
dimensions imposantes démentent l'idée selon laquelle Jérusalem n'était
qu'un
village insignifiant au Xème siècle. Les premiers rois d'Israël ont
ainsi
retrouvé un monument à la dimension de leur renommée.
Références :
[1] -
"David found at Dan. Inscription crowns
27 years of exciting discoveries". Biblical Archaeology Review
20:02, Mar/Apr. 1994 (cojs.org).
[2] - D. Danzig
:
"Tel Dan Stele, c. 840 BCE" (cojs.org).
[3] - W. Keller : "La
Bible arrachée aux sables". Famot, Genève 1975.
[4] - "Jérusalem aux
temps bibliques, que révèle l'archéologie ?"
(pensees.bibliques.over-blog.org).
[5] - R.Reich, E. Shukron : "Light at the End of the
Tunnel". Biblical Archaeology Review,
Jan/Feb 1999.
[6] - E. Mazar :
"Excavate King David’s Palace". Biblical Archaeology Review,
January/February 1997, pp.
50-57, 74.
[7] - E. Mazar :
"Did I find David’s Palace ? " Biblical
Archaeology Review, January/February 2006, pp. 16-27, 70.
[8] - R. Ginsberg :
"Jérusalem est-elle vraiment juive ?" (lamed.fr).
[9] - H. Moore Sarah : "Is It the Palace of King David ?". Jerusalem
Christian Review, Volume 9, Internet Edition, Issue 6 (leaderu.com).
|