|
La
date exacte de la naissance de
Jésus-Christ n'est pas connue. Une incertitude subsiste depuis les tout
premiers siècles de l'ère chrétienne, d'où il ressort que l'an 1 n'est
probablement pas celui de la naissance de Jésus-Christ. La plupart des
historiens actuels pensent que la Nativité a eu lieu quelques années
avant l'an
1, mais le problème de sa détermination précise n'est pas résolu.
De
la même façon, le jour du 25
décembre ne coïncide peut-être pas avec l'anniversaire de la naissance
de
Jésus. L'époque de l'année étant inconnue, la fête chrétienne de Noël
ne fait
que célébrer cette naissance, en remplacement d'une ancienne fête
païenne
hivernale. En fait, ces incertitudes fort répandues ne sont pas si
imprécises
que l'on croit.
La période de l'année
Le jour de la Nativité fut fixé
officiellement au 25 décembre par le pape Liberus, en l'an 354 de notre
ère.
Cette date aurait été volontairement choisie pour remplacer une fête
païenne du
solstice d'hiver, Natalis Invicti
(nativité du soleil invincible). Quant au mot Noël, il proviendrait des
termes
celtes noio et hel qui signifient
"renaissance du soleil". Dans l'empire
romain polythéiste, cette période était celle des fêtes du dieu
Saturne, les
"Saturnales". Une autre divinité d'origine iranienne, Mithra, dieu de
la lumière, bénéficiait aussi d'un culte répandu dans l'empire romain
en
concurrence avec le monothéisme chrétien.
Plusieurs auteurs contemporains estiment peu probable
le fait
que Jésus soit né en décembre, si l'on prend comme critère un verset du
récit
d'après lequel les bergers faisaient paître leurs troupeaux la nuit
(Lc. 2,8),
ce qui devait se faire plutôt en période chaude. D'autre part, on peut
douter
du fait que les Romains aient engagé leur recensement en plein hiver,
obligeant
les foules à se déplacer dans le froid vers leur région d'origine. Cela
dit,
aucune autre période de l'année ne semble faire consensus chez les
historiens.
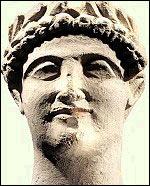
Tête
d'une statue antique d'Hérode le
Grand
(crimelibrary.com).
|

Fresque
de Giotto représentant l'Adoration
des Mages
(members.aol.com/antoninus1). |
Noël
en décembre ?
Toutefois, les
doutes précédents sur la date traditionnelle de Noël semblent pouvoir
être
nuancés. Dans son ouvrage "Histoire de la religion romaine" paru en
1957, le latiniste français Jean Bayet contesta ces idées reçues. Il
précisa qu'en fait ce furent au contraire les empereurs romains
Aurélien et
Julien l'Apostat, qui en 274 et 362 fixèrent au 25 décembre la fête
iranienne
du soleil invaincu pour remplacer la fête chrétienne, dans un objectif
de
persécution du christianisme. Cette mesure était un prétexte pour
traquer les
adeptes du monothéisme qui refusaient de participer au culte païen. Le
choix du
25 décembre ne serait donc pas une décision de l'Eglise prise a posteriori pour remplacer une fête
païenne, mais plutôt l'inverse, une mesure politique visant à effacer
une
tradition chrétienne déjà ancienne.
Par ailleurs, la possibilité que Jésus soit réellement né en décembre
vient de
trouver un nouvel appui. En 1999, le professeur israélien Shemaryahou
Talmon
publia une étude proposant une solution découlant des manuscrits de la
mer
Morte. Les
fragments du calendrier de Qumrân nous apprennent en effet que le
service
liturgique de la classe des prêtres d'Abia devait assurer son tour de
garde
deux fois par an, du 8 au 14 du troisième mois et du 24 au 30 du
huitième mois.
Cette deuxième période correspond à la fin de notre mois de septembre.
Or, l'évangile
de Luc dit que le prêtre Zacharie, père de Jean-Baptiste, appartenait à
cette
classe sacerdotale. Il officiait dans le Temple, donc peut-être un jour
de septembre,
lorsque l'ange Gabriel lui apparut et lui annonça la future naissance
de Jean.
Le texte précise à deux reprises que six mois plus tard, l'ange Gabriel
apparaissait à son tour à Marie et l'informait qu'elle aurait un fils.
Six mois
après septembre, cela donne mars. Ajoutons neuf mois de grossesse de
Marie, et
on est en plein mois de décembre pour que Jésus naisse. Entretemps son
cousin
Jean-Baptiste sera né au mois de juin, neuf mois après l'apparition à
Zacharie.
Cet élément trouvé dans les précieux manuscrits impliquerait donc que
Jésus-Christ soit bien né en plein hiver, et permet ainsi à la fête de
Noël de
retrouver son caractère d'anniversaire véritable.
L'année
de la naissance
Est-il possible aujourd'hui de déterminer
l'année réelle de la Nativité ? Les évangiles nous donnent quelques
repères
temporels. Jésus serait né sous le règne du roi Hérode le Grand (Mt.
1-2) ;
l'empereur romain Auguste prescrivit un recensement de population alors
que le
gouverneur de Syrie s'appelait Quirinius (Lc. 2, 1-7) ; Jean le
Baptiste
commença sa prédication la quinzième année de Tibère, alors que Jésus
avait
environ trente ans (Lc. 3, 1-23).
Les premiers historiens du
christianisme
comme Clément d'Alexandrie, ont calculé que la naissance de
Jésus-Christ avait
dû se produire en l'an 752 de la fondation de Rome. Au
VIème siècle, le moine Denys le Petit introduisit la notion d'ère
chrétienne,
proposant de compter les années à partir de celle de la naissance de
Jésus.
Cependant il introduisit par erreur un décalage de deux ans, d'une part
en
faisant une confusion due à une coïncidence astronomique, et d'autre
part à
cause de l'absence du zéro dans le système décimal romain !
Le problème se complique du fait que la majorité des
historiens pensent que le roi Hérode décéda en l'an - 4 du calendrier
actuel. C'est
du moins ce qui découle des écrits de
l'historien Flavius Josèphe, d'après lesquels Hérode est mort 37 ans
après sa
désignation comme roi par le Sénat romain, et quelques jours après une
éclipse de
Lune. Or le début de son règne étant daté de - 40, et l'éclipse de Lune
la plus
proche de cette date étant celle du 13 mars - 4, la mort du roi de
Judée se
placerait en - 4. Par
suite, comme il est précisé dans les évangiles
que Jésus est né avant la mort d'Hérode, la Nativité serait antérieure
à l'an 4 avant notre ère
[5].
Ce calcul est aujourd'hui discuté, car une autre
éclipse de Lune s'est produite le 9 janvier - 1 : on peut également
l'associer
à la mort d'Hérode, auquel cas la naissance de Jésus pourrait être
moins ancienne. L'hypothèse
est toutefois peu suivie car elle
invalide les dates de règne des fils d'Hérode le Grand.
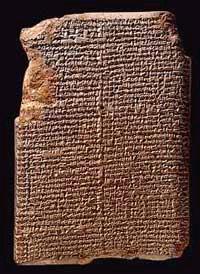
Calendrier
babylonien.
(astrologer.com)
|
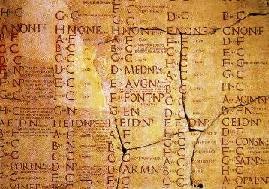
Calendrier
romain, daté du règne
d'Auguste.
(histoiredechiffres.neuf.fr)
|
Le recensement cité par saint Luc pourrait bien être
un fait
historique, car on en trouve plusieurs traces. A Ankara en Turquie, un
temple
dédié à César Auguste porte inscrite sur l'un de ses murs une
déclaration de
l'empereur, sous le titre de Res Gestae
Divi Augusti, sorte de compte-rendu des actes accomplis sous son
règne. Le
texte gravé parle de trois recensements qu'il a ordonnés : le premier
en 726 de
l'ère de Rome (28 av. J.-C.), le second en 746 (8 av. J.-C.), le
troisième en
767 (14 ap. J.-C.):
"Et pendant mon
sixième consulat, j’ai mené le recensement des citoyens romains avec
mon
collègue M. Agrippa ( 28 av. J.-C. ). J’ai procédé à ce
lustre pour
la première fois depuis quarante et un ans. Lors de ce lustre, on a
recensé
quatre millions soixante-trois mille citoyens romains. Ensuite, une
deuxième
fois, disposant des pleins pouvoirs proconsulaires, j’ai procédé au
lustre sans
collègue, sous le consulat de C. Censorinus et de C. Asinius
( 8 av.
J.-C. ). Lors de ce lustre, on a recensé quatre millions deux cent
trente-trois mille citoyens romains. Enfin, une troisième fois,
disposant des
pleins pouvoirs proconsulaires, j’ai procédé au lustre avec pour
collègue mon
fils Tibère César, sous le consulat de Sex. Pompeius et de Sex.
Appuleius
( 14 ap. J.-C. ). Lors de ce lustre, on a recensé quatre
millions
neuf cent trente-sept mille citoyens romains".

Le
temple d'Auguste à Ankara
(en.wikipedia.org).
|
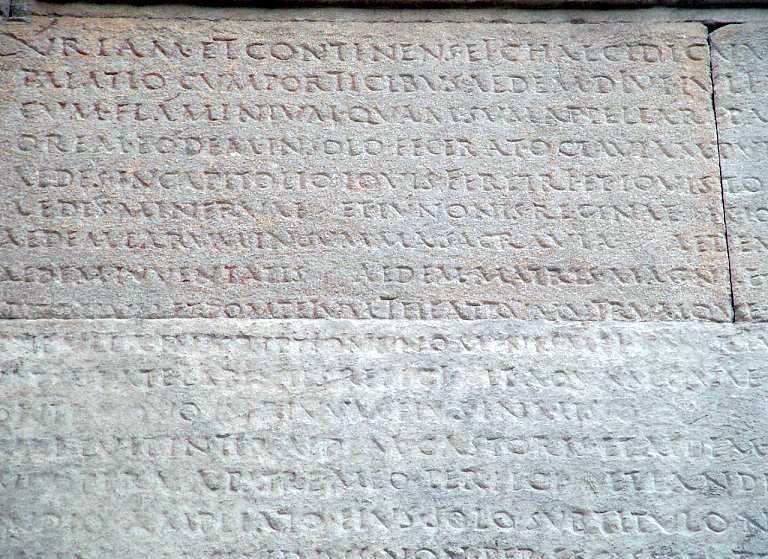
Le
texte de César Auguste Res gestae
Divi Augusti
(en.wikipedia.org).
|
Si l'un de ces recensements doit correspondre à
celui dont
parle l'évangile, ce ne peut être que celui de l'an 8 av. J.-C.,
quoique Luc
précise que c'était le premier. Cette opération est évoquée également
par
Tertullien (155-222), qui détaille la procédure étalée sur plusieurs
années
avec des interruptions. On
peut donc supposer que Marie et Joseph se sont rendus à Jérusalem
autour de
l'an 8 av. J.-C..
L'apport de l'astronomie
Trouver une coïncidence entre la naissance
de Jésus et un évènement astronomique particulier est un défi qu'ont
tenté
nombre d'érudits versés dans les calculs de calendrier ou de mécanique
céleste.
Les mages venus d'Orient pour voir le nouveau-né étaient originaires de
Mésopotamie ou d'Iran où l'astrologie était très pratiquée. Des études
récentes
ont cherché à relier la position des étoiles à l'époque de la Nativité,
avec la
pratique de l'astrologie en Perse.
Si l'étoile des
rois mages doit correspondre à un fait astronomique réel, quelle a pu
être sa
véritable nature ? L'iconographie traditionnelle représente souvent
l'étoile de
Noël comme une comète. Les comètes sont des blocs de glace et de
poussières
suivis d'une traînée lumineuse, ayant une trajectoire elliptique autour
du
soleil et se rapprochant périodiquement de la Terre. Il n'a pas été
possible de
documenter le passage d'une comète particulière visible à cette époque.
D'autres phénomènes célestes ont été envisagés, tels les supernovae
ou étoiles lointaines qui explosent en fin de vie en émettant
une très grande luminosité. Là non plus, aucun texte ancien connu ne
semble
faire référence à un tel phénomène au moment opportun.
La possibilité d'un alignement de planètes est un domaine qui s'est
révélé plus
prometteur. C'est l'astronome allemand Johannes Kepler qui y songea le
premier,
en observant en 1603 une conjonction très lumineuse entre Jupiter et
Saturne
dans la constellation des Poissons. Il fit alors un rapprochement avec
l'étoile
des mages grâce à un texte hébreu du rabbin Abravanel : "Pour
les astrologues juifs, le Messie viendrait d'une conjonction
de Saturne et de Jupiter dans la constellation des Poissons".
Kepler calcula
alors qu'en l'an 7 av. J.-C., la même conjonction s'était produite
trois fois
dans la même année : le 29 mai, le 3 octobre et le 4 décembre. La
répétition de
cet alignement étant extrêmement rare, il en conclut que des
obervateurs
attentifs du ciel comme les mages avaient pu la remarquer ; il
l'assimila à
l'étoile de Bethléem, et plaça donc la Nativité en l'an 7 av. J.-C..
Ses
résultats furent aussitôt publiés, mais ils passèrent inaperçus parce
que tout
le monde croyait à l'époque que Jésus était né en l'an 1.
En 1925, l'orientaliste allemand Paul Schnabel déchiffra les anciennes
tablettes cunéiformes de l'école d'astronomie de Sippar. Celles-ci
confirmaient
qu'une "grande étoile" formée par la réunion des planètes Jupiter et
Saturne, avait été observée en Poissons pendant plus de cinq mois en
l'an 7 av.
J.-C..
En outre, une
quatrième conjonction se produisit à la fin du mois de janvier de l'an
6 av.
J.-C., cette fois dans la constellation du Bélier. Or selon l'astronome
grec
Claude Ptolémée, la Judée était placée sous le signe du Bélier.

La
comète de Halley,
photographiée en 1986
(nssdc.gsfc.nasa.gov).
|

Les
restes de l'explosion
d'une supernova:
la nébuleuse du Crabe
(antwrp.gsfc.nasa.gov).
|
La
pratique de l'astrologie ancienne utilisait un langage interprétatif
qui donnait une
clef de lecture à la coïncidence des astres. En effet, la conjonction
des deux
planètes peut signifier que le nouveau roi (Jupiter) remplace l'ancien
(Saturne), ou que la planète royale (Jupiter) rencontre la planète
protectrice
d'Israël (Saturne). Les Poissons quant à eux représenteraient le signe
du
Messie et d'Israël. Autrement dit, les mages auraient déduit de leurs
observations qu'un nouveau roi puissant ou un Messie était né en
Israël. Cette
interprétation symbolique peut aider à comprendre pourquoi les mages se
seraient déplacés.
L' "étoile
de Bethléem" correspondrait donc à la réunion très lumineuse de Jupiter
et de Saturne à quatre
reprises dans la même année. Cette théorie donnerait par conséquent les
alentours de l'an 7 av. J.-C. comme étant la période la plus
vraisemblable pour
la Nativité.
|