Si la
religion fondée par Jésus-Christ connut un
développement très important, ce n'est
paradoxalement pas en Terre sainte qu'elle
eut le plus de succès. Le
contexte de son émergence peut être approché par
l'étude de ses textes fondateurs, au premier rang desquels figurent
bien sûr
les quatre évangiles. Préciser l'identité de leurs auteurs, mieux
cerner
l'époque et les lieux de leur rédaction aidera à mieux appréhender
l'essor du
phénomène chrétien.
Les
évangiles canoniques
Le Nouveau
Testament fournit peu d'informations sur l'identité des auteurs des
quatre
évangiles dont les noms sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, que ce soit
sur leurs
vies ou sur les circonstances du travail de rédaction.
L'essentiel de
ce nous savons sur la personnalité des évangélistes vient de ces textes
eux-mêmes et d'autres sources littéraires anciennes. Matthieu était
l'un des
douze apôtres, percepteur d'impôts de profession ; Marc est le surnom
d'un
personnage qui s'appelait Jean et qui accompagna Pierre et Paul lors de
leurs
voyages ; Luc était un médecin originaire d'Antioche en Syrie, et Jean
un
apôtre et un frère de Jacques, aussi désigné dans l'Ecriture comme "celui que Jésus aimait".
Le contexte
précis de la composition des évangiles étant assez mal connu, les
spécialistes
de l'étude des anciens textes s'attachent aujourd'hui à tirer le
maximum
d'informations de cette littérature elle-même. En présence de ces
documents
écrits, l'exégèse classique aborde leur étude de plusieurs manières. On
peut
examiner leur forme linguistique et littéraire, ou bien les indices
historiques
qui apparaissent dans leur contenu, ou bien encore leur support
physique.
L'étude
littéraire a d'abord consisté à comparer entre eux les quatre textes
évangéliques. Cette démarche a permis de faire des constats importants,
par
exemple le fait que certains passages sont quasiment identiques dans
deux
évangiles, et même parfois trois. D'ailleurs la similitude est telle
qu’on est
à peu près certain qu'ils ont une origine commune : ce sont les trois
évangiles
"synoptiques" (Matthieu, Marc et Luc), c'est-à-dire qui sont
associés, par opposition à celui de Jean qui se distingue des trois
autres.

Un très vieux document
:
le papyrus Magdalen Greek P64
(members.aol.com).
| 
Un fragment ancien de l'évangile de Jean
:
le
papyrus Rylands P52
(rylibweb.man.ac.uk).
|
Les chercheurs
ont même poussé le raisonnement plus loin, en supposant que l'évangile
synoptique le plus ancien devait être celui qui avait le plus de
passages en
commun avec les deux autres. Il s'agit en l'occurrence du texte de
Marc, qui
serait donc une source documentaire possible pour Luc et Matthieu.
Certains
biblistes ont aussi imaginé l’existence possible d’une seconde source
textuelle, qui serait inconnue mais qui se justifie par de nombreux
versets
communs aux évangiles de Matthieu et de Luc, quoique absents chez Marc.
On l'a
appelée l'énigmatique "source Q" (pour Quelle,
"source" en allemand).
C'est la théorie dite des deux sources, qui n’est pas réellement
prouvée mais
qui constitue une hypothèse de travail.
Les plus
anciens fragments d'évangiles en notre possession sont écrits en grec,
la
langue internationale du Proche-Orient à l'époque. L'une des questions
aujourd'hui débattues est de savoir si les textes originaux furent
composés
directement en grec, ou d'abord en hébreu, la langue religieuse du
pays.
Certains linguistes comme l'abbé Jean Carmignac ou Claude Tresmontant
ont
affirmé avoir reconnu de nombreuses expressions typiquement hébraïques
derrière
le texte grec, ce qui indiquerait l'existence d'une première version en
langue
sémitique.
La deuxième
approche, celle de la recherche des indices historiques présents dans
les
textes, peut avoir des implications sur la date de leur rédaction. Dans
cette
démarche, une date-clé est celle de l'an 70, à laquelle l'armée romaine
détruisit Jérusalem à l'issue de la première révolte juive. Selon si la
composition des évangiles est antérieure ou postérieure à cette date,
le
contexte historique est différent. Ainsi les évangiles de Luc et
Matthieu
semblent faire allusion à cet évènement, dans un parallèle envisageable
entre
une prophétie annoncée par Jésus et la prise de la ville par les
légions
romaines (Lc. 21, 20 ; Mt. 22, 1-14). La majorité des spécialistes
penchent
plutôt pour une composition des quatre textes postérieure à 70.
Enfin, le
support physique des livres fait aussi l'objet d'examens très poussés.
Les
livres de cette époque se présentent comme de longues bandes de
papyrus, que le
lecteur déroulait d'un côté et enroulait de l'autre à mesure de la
lecture. A
partir du IIème siècle, la présentation du support commença à changer
et on
réalisa des livres en feuilles reliées comme de nos jours, plus faciles
à
manipuler : les codex. Dans le même
temps le matériau lui-même changea, le papyrus étant progressivement
remplacé
par le parchemin.
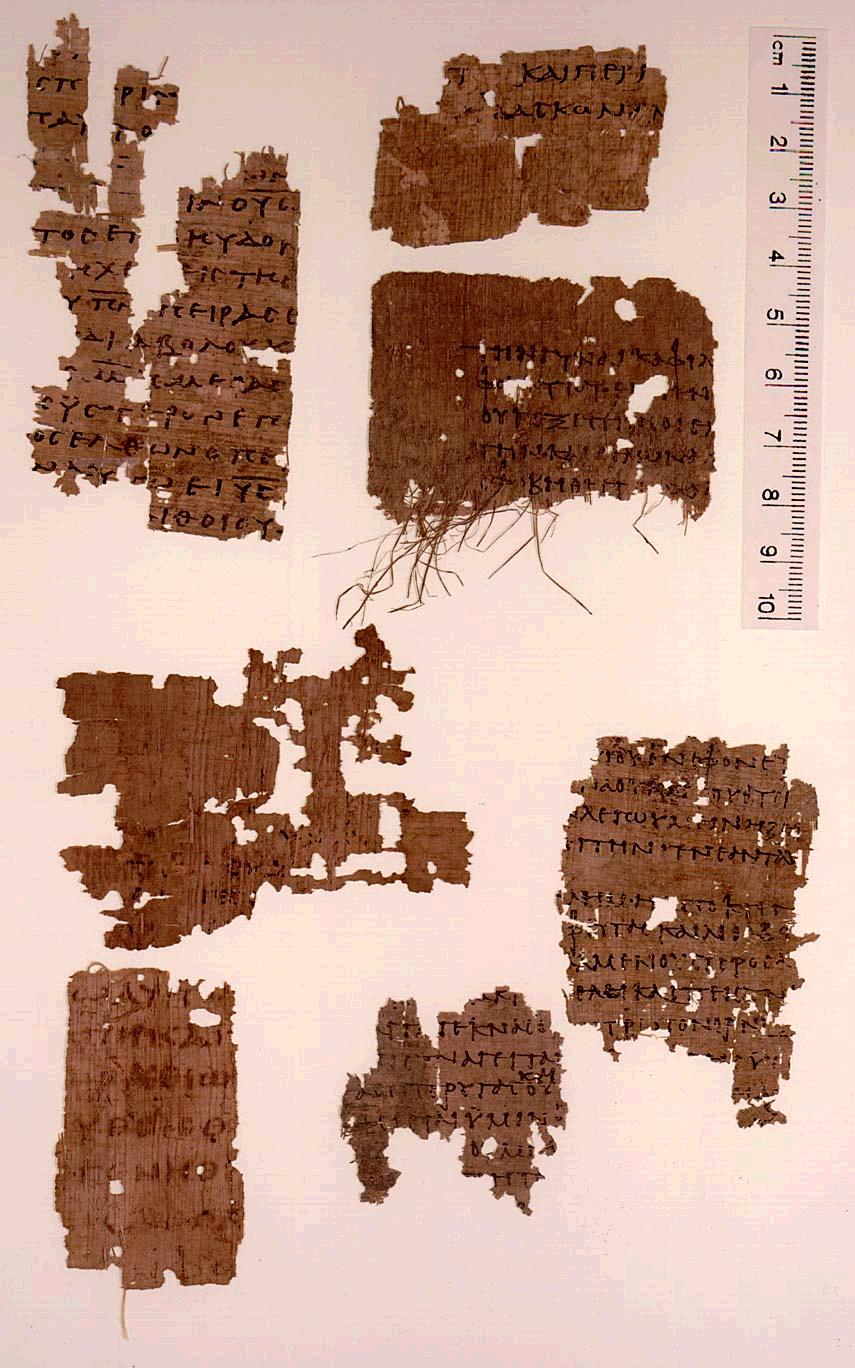
Fragments de l'évangile de Matthieu,
trouvés à Oxyrhynque
(csad.ox.ac.uk - © the
Egypt Exploration Society).
| 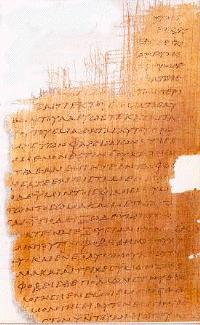
Page de l'évangile de Luc
(law.umkc.edu/faculty).
|
Les plus
anciens exemplaires connus des évangiles sont des fragments de papyrus
isolés
qui remontent aux tout premiers siècles de notre ère. Le record
d'ancienneté
est peut-être détenu par une relique appelée le papyrus Rylands P52, un
court
extrait de l'évangile selon saint Jean conservé à la John
Rylands Library de Manchester. Il fut découvert au début du
XXème siècle en Egypte, probablement à Oxyrhynque, et daterait des
environs de
l'an 125.
Une étude
récente tend à détrôner ce précieux specimen au profit d'un autre
candidat qui
lui serait antérieur : le papyrus Magdalen P64. Il s'agit d'un ensemble
de
trois fragments portant un extrait de l'évangile de Matthieu, et
conservés au Magdalen College d'Oxford. Achetés à
l'origine à Louxor en Egypte en 1901, ils furent longtemps considérés
comme
datant de la seconde moitié du second siècle. Or d'après une nouvelle
étude du
paléographe allemand Carsten Peter Thiede, ils remonteraient plutôt aux
années
30 à 70.
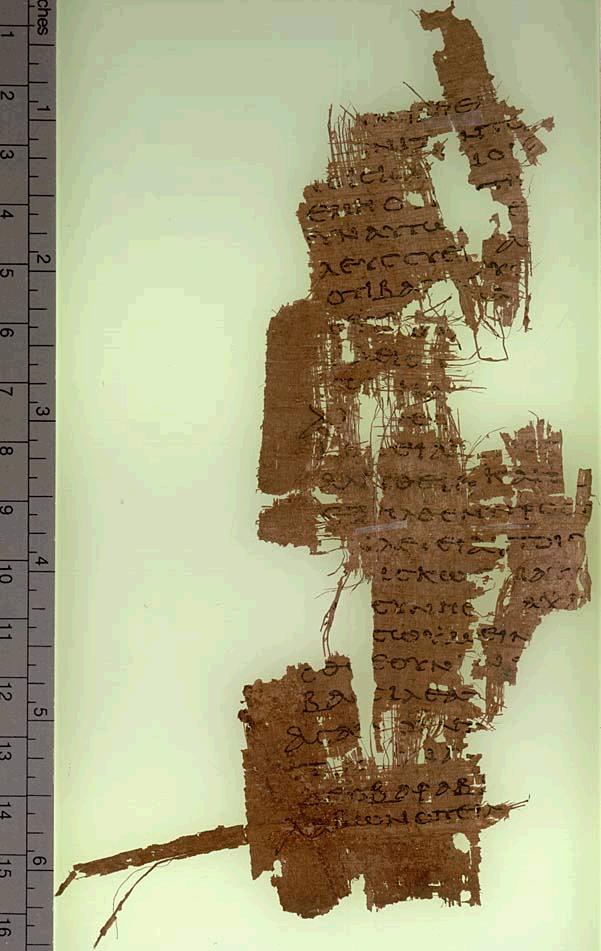
Le plus vieux fragment connu
de l'évangile de Jean, répertorié P90
(csad.ox.ac.uk - ©
the Egypt Exploration Society).
| 
Le plus ancien extrait connu de l'évangile
de Luc :
le P69 qui remonte au milieu du IIe s.
(storialibera.it).
|
Cependant
l'examen et l'estimation des âges des papyrus bibliques provoquent
parfois de
vifs débats. Ainsi, un minuscule fragment de papyrus provenant des
grottes de
Qumrân, répertorié 7Q5 et portant neuf lettres grecques, a été
soupçonné en
1972 par le père jésuite espagnol José O'Callaghan de porter un court
passage
de l'évangile de Marc (Mc. 6, 52-53). Pourtant la prudence est de
rigueur, car
si tel est le cas cela implique d'abord que le christianisme ait été
reconnu à
Qumrân, ce qui est loin d'être attesté, et que d'autre part l'évangile
de Marc
ait été composé avant l'an 68, date de la fermeture des grottes de
Qumrân.
C'est pourquoi cette identification est rejetée par la majorité des
spécialistes.
A côté de ces
fragments isolés très anciens, on possède d'autres exemplaires
d'évangiles plus
récents, et en même temps plus complets. Quelques-uns ont été trouvés
en
Egypte, comme les papyrus Chester Beatty (IIIème siècle) et les papyrus
Bodmer
(IIIème siècle).
D'autres exemplaires légèrement moins anciens sont à notre disposition
: le codex sinaiticus, trouvé au monastère
Sainte-Catherine du Sinaï et remontant au IVème siècle ; le codex
vaticanus, du IVème siècle,
conservé au Vatican ; le codex bezae,
écrit au Vème siècle et provenant d'un ancien monastère Saint-Irénée à
Lyon ;
le codex alexandrinus, offert à
l'Angleterre en 1627 par le patriarche de Constantinople et rédigé
vraisemblablement
à Alexandrie au Vème siècle.

Le papyrus Bodmer P66,
daté d'entre 125 et 200
(markdroberts.com).
| 
Le papyrus 7Q5 de Qumrân
(mc-rall.de/histnt.htm).
|
Il convient
également de s'interroger sur le processus qui a présidé à la
composition de la
Bible chrétienne. Sa forme quasi-définitive s'est fixée au cours des
premiers
siècles, mais nous savons pourtant qu'il existait à l'origine un
corpus de textes plus nombreux qui ont fait l'objet d'une sélection.
Les quatre
évangiles retenus sont devenus les évangiles officiels, ou
"canoniques", le mot grec canon
signifiant "règle".
Le
moment où ce choix a été fait nous est révélé par de vieux documents
qui
dressent la liste à peu près définitive des vingt-sept livres composant
le
Nouveau Testament. La plus ancienne de ces listes est le canon de
Muratori,
retrouvé en 1740 dans une bibliothèque de Milan et qui date des
environs de
l'an 170. Il existe d'autres
listes de ce type, dressées ultérieurement par des théologiens et pères
de
l'Eglise et qui lui sont presque identiques. Au IVème siècle, le canon
des
vingt-sept livres du Nouveau Testament était pratiquement arrêté, et
lorsqu'en
397 sa composition fut officialisée par le concile de Carthage, elle
était déjà
reconnue depuis longtemps par la plupart des communautés chrétiennes.
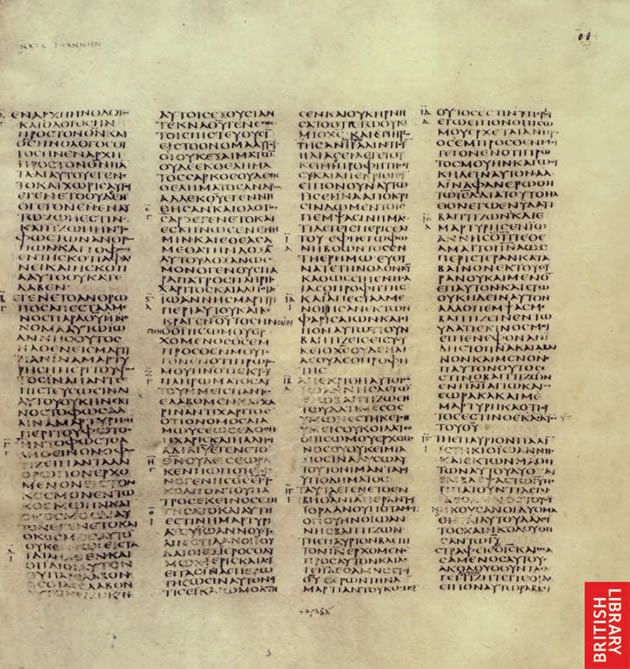
Un feuillet de l'évangile de Jean
du codex
sinaïticus
(bl.uk - Copyright The British
Library ©).