|
Que le mythe biblique du Paradis
terrestre ait ses origines en Basse Mésopotamie, l’idée n’est pas nouvelle, et elle
doit être mise à l’épreuve des données archéologiques. Dans les pays du Proche
et du Moyen-Orient, le matériel archéologique ne manque pas, car de multiples campagnes
de fouilles conduites dans cette région du monde ont livré des quantités incalculables
de vestiges, témoins de la grandeur d’une civilisation disparue depuis des
millénaires.
Les premières fouilles réalisées
en Irak furent dirigées en 1842 par Paul-Emile Botta, consul de France à
Mossoul, et en 1845 par l’archéologue Austen Henry Layard. Les résultats furent
tout de suite spectaculaires, et suscitèrent bien d’autres expéditions ultérieures.
On creusa dans de nombreux tells, ces
collines du désert constituées de ruines ensablées, et des milliers d’habitations
et de monuments apparurent, révélant ainsi l’existence passée de véritables
villes.
Palais, temples, fortifications, grandes tours à étages en terrasses,
aménagements urbains, statues et bas-reliefs sortirent peu à peu des sables. Ces
ouvrages de brique et de pierre témoignaient de la splendeur d’une puissante civilisation
totalement oubliée. A mesure que ces richesses étaient mises au jour, la masse
gigantesque des informations qui en furent tirées permit de reconstituer les
grands traits de la culture de ce monde disparu.

Statue
sumérienne
représentant un homme priant
(en.wikipedia.org).
|

Tablette
d'écriture primitive
datant d'environ 3000 av. J.-C.
(en.wikipedia.org).
|
Les
temps protohistoriques
Il
est ainsi apparu que la Mésopotamie, ou Chaldée, était le véritable berceau de
la civilisation humaine, en tant que société organisée à l’échelle d’une ville
ou d’une région. A la fin de la Préhistoire, dans les derniers millénaires
avant notre ère, cette révolution sociétale s’est faite au sein d’un ensemble
de peuples qui occupaient les rives du Tigre et de l’Euphrate.
Mais qui étaient
ces habitants qui furent à l’origine de cette transformation ? Aussi loin
que l’on puisse remonter dans le passé, il semble que les communautés humaines de
Mésopotamie n’aient pas toutes la même origine ethno-géographique. L’extrémité
sud-est de la plaine alluviale, entre Nippur et le golfe Persique, était habitée
par les Sumériens, un peuple dont les origines premières sont inconnues. En
effet, l’étude de leur culture et de leur langue montre qu’ils n’étaient apparentés
à aucun autre groupe connu. Un peu plus en amont, entre Bagdad et Nippur, vivait
le peuple d’Akkad, que l’on peut affilier à la grande famille des Sémites car
nous savons qu’il parlait une langue sémitique. Enfin, toute la partie haute de
la vallée, jusqu’à la Syrie orientale, était occupée par diverses ethnies également
assimilées à des Sémites.
L’émergence progressive
de la première civilisation urbaine commence durant ce que les archéologues appellent la
« période prédynastique », ou « proto-historique », définie
entre 6500 et 3100 environ avant notre ère [1]. Durant
cette période, il ne serait pas tellement exagéré de dire que les Chaldéens ont
tout inventé. Dans cette plaine très fertile, la pratique de l’élevage et de la
culture des céréales s’étend, tandis que la vie citadine se met progressivement
en place. La population issue des collines et des villages se concentre dans d’immenses
cités. Les huttes font place aux maisons en dur, lesquelles se dotent de cours
et d’étages. Les rues se tracent à angles droits et des temples imposants sont
élevés. La vaisselle de terre cuite remplace celle de pierre, et la statuaire
se développe. La roue, l’araire, la navigation et la voile apparaissent
également à Sumer. A la fin de la période prédynastique, de véritables petits Etats
sont constitués et organisés autour des grandes villes.
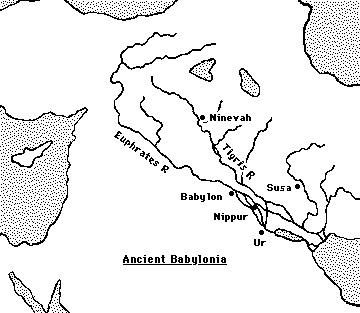
Carte de la Mésopotamie antique
(history.mcs.st-and.ac.uk).
L’apparition
de l’écriture et l’aube de l’Histoire
Vers 3300 av. J.-C.,
les habitants de Sumer opèrent l’une des plus grandes révolutions techniques
jamais réalisées par l’homme : l’invention de l’écriture. Selon toute vraisembance,
c’est dans la cité d’Uruk, en basse vallée de l’Euphrate, que la première forme
d’écriture a vu le jour. L’idée d’écrire semble née d’un besoin de
comptabiliser des biens d’agriculture ou d’élevage. Les premiers scribes traçaient
des dessins dans des plaques de boue au moyen d’un outil, le calame, qu’ils
enfonçaient dans l’argile fraîche. Les tablettes étaient ensuites séchées et cuites
au soleil.
La disposition des signes constituait une première forme de
communication écrite, rudimentaire certes, mais qui ne tarda pas à évoluer. De
figurative, elle devint de plus en plus abstraite afin d’exprimer des idées plus
complexes, comme le fait une langue parlée. Autre changement, les traits
prirent la forme de petits triangles, l’extrémité du calame devenant
triangulaire, inaugurant la fameuse écriture dite « cunéiforme »,
c’est-à-dire en forme de coins ou de clous. La pratique de l’écriture
cunéiforme se diffusa rapidement dans tout l’Orient ancien, de l’Indus à la
Turquie, et allait perdurer jusqu’au début de notre ère.

Tablette
cunéiforme
(freestockphotos.com).
|

Tablette cunéiforme
(sumerianshakespeare.com).
|
A
ce jour, des centaines de milliers de tablettes cunéiformes sont sorties
du sol sous la pioche des archéologues. Lorsque les premières inscriptions
furent découvertes, personne ne savait les lire, et ces documents auraient peu
d’intérêt si des savants perspicaces n’avaient percé le secret de leur déchiffrement.
L’écriture
cunéiforme a été déchiffrée au cours du XIXe siècle, grâce aux efforts conjugués
de plusieurs linguistes dont l’un des pionniers fut l’orientaliste britannique
Henry Creswicke Rawlinson. C’est essentiellement grâce à une inscription
monumentale trilingue, gravée en cunéiforme sur une haute paroi rocheuse de
l’Ouest de l’Iran, l’inscription de Béhistoun, que le mystère de l’écriture
cunéiforme a été percé. En 1835, Rawlinson y grimpa à l’aide de cordes et de
planches pour l’examiner de près, suspendu au-dessus du vide ... C’est dans ces
conditions acrobatiques que l’inscription fut patiemment recopiée pour être
ensuite étudiée en laboratoire.

Bas-relief
et inscription de Behistoun
(fr.wikipedia.org).
Se
fondant alors sur des recherches antérieures menées par le philologue allemand George
Grotefend, Rawlinson réussit à lire les noms de deux rois perses : Darius
et Xerxès. De fil en aiguille, comprenant que cette partie du texte était écrite
en vieux perse, il parvint à la déchiffrer intégralement. Le principe de la
lecture était syllabique, c’est-à-dire que chaque signe ou groupe de signes
correspondait à une syllabe qui entrait dans la composition d’un langage
structuré. Fort de ce succès, il déchiffra également les deux autres versions du
texte, qui s’avérèrent être gravées en langues élamite et akkadienne. La clef de
lecture était désormais acquise pour trois langues anciennes.
En réalité, l’écriture
cunéiforme avait servi à transcrire bien d’autres langues antiques, comme le
sumérien, le hittite, l’ougaritique et l’ourartéen, qui furent durant les décennies
suivantes déchiffrées les unes après les autres [2]. Ces progrès rendirent
possible la traduction des innombrables tablettes d’argile exhumées sur les
chantiers archéologiques. A mesure que ces documents parvenaient dans les
musées, leur traduction était entreprise par des spécialistes formés à cette
nouvelle discipline qu’était l’assyriologie. Ce travail, toujours en cours
aujourd’hui, a permis de dévoiler progressivement l'histoire et la culture de
cette civilisation oubliée.
La
période dynastique archaïque
Au
IVe millénaire avant notre ère, les premiers écrits sur tablettes
étaient essentiellement des documents comptables et administratifs. Les
archives narratives et descriptives sont plus rares et présentent
souvent des
récits à caractère mythologique. L’un des documents les plus
intéressants de
cette catégorie est la « liste royale sumérienne », un
ensemble de tablettes
et de pierres inscrites qui énumèrent les noms des rois censés avoir
régné sur le
pays de Sumer depuis ses origines. L’exemplaire le plus complet de
cette liste
est le prisme de Weld-Blundell, une colonne de section carrée couverte
de centaines
de noms de rois sur ses quatre faces.
« Après être descendue du ciel, la
royauté s’établit à Eridu. A Eridu, Alulim devint roi et régna pendant vingt-huit
mille huit cents ans.
Alalĝar régna pendant trente-six mille
ans. Ces deux rois ont régné pendant soixante-quatre mille huit cents ans.
Alors Eridu tomba et la royauté fut
prise à Bad-tibira. À Bad-tibira, En-men-lu-ana régna pendant quarante-trois
mille deux cents ans ... » [3]
Ainsi commence la liste royale
sumérienne, qui nomme les tout premiers rois de Sumer en leur attribuant des
longueurs de règnes totalement surréalistes. Le plus long de tous est celui
d’En-men-lu-ana, qui aurait duré quarante-trois mille deux cents ans ! Ces
documents, évidemment idéalisés, ne nous apprennent rien d’autre, sinon que pendant
les règnes des neuf premiers rois, le pouvoir aurait changé cinq fois de
capitale et qu’il se serait perpétué sur une durée de deux cent quarante et un
mille deux cents ans ...
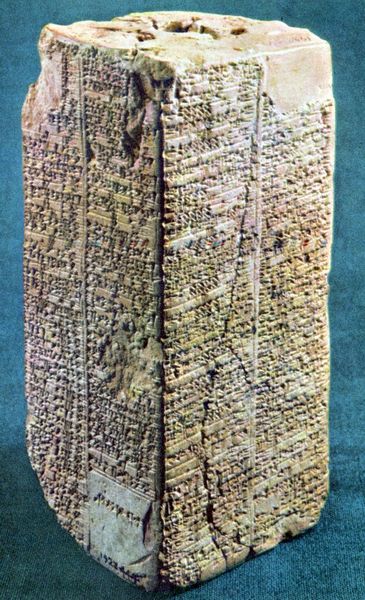
Liste royale sumérienne
(earth-history.com).
Dans le souci d’établir une
chronologie un tant soit peu réaliste, les assyriologues considèrent les
premiers rois de Sumer comme plus ou moins légendaires, mais ils se servent de
la liste comme fil conducteur narratif. La datation des vestiges archéologiques
les a par ailleurs conduits à désigner les premiers temps de l’histoire mésopotamienne
sous le nom de « période dynastique archaïque », qui dure à peu près de
2900 à 2340 av. J.-C. [4]. Celle-ci
voit s’établir plusieurs petits royaumes politiquement indépendants, appellés
des « cités-Etats » et dont les capitales ont pour noms Eridu, Kish, Uruk,
Ur, Lagash, Nippur, Mari, Ebla ... Durant cette période, les structures
administratives se renforcent et la culture sumérienne rayonne sur tout l’Orient.
L’agriculture se développe grâce aux canaux d’irrigation, bénéficiant aux plantations
d’orge et de palmier, et devenant la plus productive du monde ancien. La
société est riche et très urbanisée.
Eridu est l’une des plus
anciennes villes sumériennes. Ses vestiges furent retrouvés à quelques
kilomètres à l’Ouest de l’embouchure commune du Tigre et de l’Euphrate [5]. Fouillée
essentiellement en 1949 par l'archéologue irakien Fuad Safar, la cité aurait eu
très tôt une importance politique et religieuse de premier plan. Au milieu de
la plaine alluviale, elle occupait sept collines et a livré pas moins de
dix-neuf niveaux d'occupation, la couche archéologique la plus ancienne
remontant au Ve millénaire avant notre ère. La cité possédait un temple
monumental qui fut reconstruit treize fois, et dont le niveau le plus bas révéla
la base d'un petit bâtiment rectangulaire entourant une simple table d’autel.
Eridu a montré l’une des premières traces connues d’un culte religieux en Mésopotamie.

Le temple d'Eridu reconstitué
(goldenageproject.org.uk).
C’est
dans le Sud-Est que l’économie est la plus florissante. Les milliers de
tablettes exhumées dans la plaine de Sumer ont révélé des structures étatiques
puissantes. A côté des documents comptables, administratifs et commerciaux, quelques
textes diplomatiques, littéraires, mythologiques et religieux nous renseignent
sur la culture et la civilisation sumériennes.
Pour avoir une idée du
niveau de raffinement culturel atteint, il faut évoquer un site archéologique assez
exceptionnel connu sous le nom de « tombes royales sumériennes ». Il
fut découvert sur le lieu-dit de Tell el-Mukayyar, en Basse-Mésopotamie, et fouillé
entre 1926 et 1932 par l’archéologue britannique Leonard Woolley. Au sein des
vestiges d’une cité disparue sous les sables, et assimilée à la ville antique
de Ur, un cimetière a livré un trésor dont le niveau de raffinement n’a rien à
envier à celui de la tombe de Toutankhamon [6].

Entrée d'une
tombe royale sumérienne
(geocaching.com).
Seize
tombes constituées de petits bâtiments enterrés abritaient des personnage de
haut rang, dont les dépouilles était parées de bijoux de grand luxe. Autour de
l’une des tombes enfouies au fond d’un puits furent trouvés les corps de
plusieurs dizaines d’autres personnes, manifestement sacrifiées et inhumées en
même temps que leurs maîtres. Elles aussi avaient été parées et accompagnées d’objets
d’une grande richesse.

Eléments de parure trouvés
dans une tombe royale sumérienne
(sumerianshakespeare.com).
En plus de milliers de bijoux faits de diverses matières
précieuses, on trouva des oeuvres d’art somptueuses, telles que de belles lyres en
bois polychrome munies de têtes de taureaux en or, deux magnifiques statues de
chèvres en or s’appuyant sur un buisson, ou un splendide coffre aux faces
couvertes de mosaïques représentant des cortèges de personnages. Sur les
huit noms de personnes trouvés sur place, seulement deux portent des titres royaux
mais sont inconnus par ailleurs. Ces tombes fabuleuses, datées de la fin de la
période dynastique archaïque, nous surprennent par le niveau de vie et les
moeurs de cette époque ancestrale.

Chèvre
d'or trouvée
dans une tombe royale sumérienne
(wikipedia.org).
|

Lyre
trouvée
dans une tombe royale sumérienne
(wikipedia.org). |
Coffre en mosaïque
(wikipedia.org).
Résonances
bibliques
Les
tablettes sumériennes nous parlent également des croyances et des pratiques religieuses
de ce peuple. Chaque ville avait ses propres divinités, à côté de l’existence
de dieux communs dont les plus importants se nommaient An (le Ciel, le dieu
suprême), Enlil (l’air) et Enki ou Ea (le monde souterrain). Plusieurs mythes
de création décrivent la conception que les Chaldéens avaient de l’Univers, vu
comme une terre plate et circulaire entourée d’eau et posée sous une
demi-sphère céleste [7].
Les
documents mésopotamiens présentent des analogies occasionnelles avec
les textes
de nos Bibles. Ainsi lit-on sur une tablette que le sage Adapa, prêtre
du dieu Enki
à Eridu, est dissuadé par son dieu de prendre une nourriture rendant
immortel [8]. Ou
bien qu’un jardinier nommé Tagtug, proche du dieu Enki, est maudit pour
avoir
consommé un fruit du seul arbre défendu d’un jardin [9]. D’autre
part, des ressemblances linguistiques s’observent aussi avec les noms
bibliques.
Le mot « Eden » existe en langue sumérienne (e-din) et
signifie « plaine » ou « steppe » [10], tandis que
le nom « Adam » peut se traduire par « homme »
en ougaritique (adm) [11].
En réalité, ces liens avec
la Bible constituent des détails isolés au milieu de longs récits sumériens, et
sont plutôt distendus et anecdotiques. Ces points de ressemblance laissent néanmoins
envisager des emprunts entre les littératures religieuses sumérienne et
hébraïque. Quoi qu’il en soit, il existe un cas précis où le rapprochement avec
la Bible ne peut pas être contesté. Dans la liste royale sumérienne en effet,
après les noms des neuf premiers rois de Sumer, une mention tout à fait insolite est
insérée :
« Et le Déluge nivela tout ».
Cette phrase pour le
moins inattendue nous renvoie inévitablement au coeur du contenu du livre de la
Genèse.
Références :
[1] - G. Roux : « La Mésopotamie ». Seuil,
Paris 1995, p. 71-107.
[2] - L.-J. Calvet : "Histoire de l'écriture". Hachette Littératures, Paris 2008, p. 70.
[3] - The
Sumerian King List. The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.2.1.1
[4] - G. Roux : « La Mésopotamie ». Seuil,
Paris 1995, pp. 149-170.
[5] - C. Asensio, "Eridu", 30/1/2008. http://www.ezida.com/web/eridu.htm
[6] - L. Woolley : “Ur
Excavations, Volume II : The Royal Cemetery – Text and Plates”. The Joint
Expedition of the British Museum, 1934. A Report on the Predynastic and
Sargonid Graves Excavated between 1926 and 1931.
[7] - G. Roux : « La Mésopotamie ». Seuil,
Paris 1995, pp. 117-122.
[8] - P. Talon : “Le mythe d’Adapa”. Studi Epigrafici e
Linguistici 7, 1990, pp. 43-57. http://www.sel.cchs.csic.es/sites/default/files/04talon_25b2fc7d.pdf
[9] - S. Langdon : “Sumerian
epic of paradise, the flood and the fall of man”. University Museum,
Philadelphia 1915, pp. 1-98.
[10] - A. Millard : “The
Etymology of Eden”, Vetus Testamentum
34, 1984, pp. 103-106. Cité par : F. Mirguet : “La représentation du divin
dans les récits du Pentateuque”. Brill,
Boston 2009.
[11] - M.S. Smith : “The ‘Son of Man’ in
Ugaritic,” CBQ 45, 1983, 59-60. Cité par : K. Pope : "Who Is This
Son of Man?" Biblical Insights 12.6, June 2012, 12.
http://ancientroadpublications.com/Studies/BiblicalStudies/WhoIsThisSonofMan.html.
|

