|
Visiter un pays chargé
d'Histoire en suivant les traces du fondateur d'une religion aurait peu
de sens si l'on ne connaissait pas sa vie et sa spiritualité.
Replongeons-nous un instant dans les évangiles.
Jésus de
Nazareth quitte le foyer familial vers trente ans afin de mener sa vie
publique à travers la terre d'Israël. Il se rend d'abord sur les rives
du
Jourdain, où il est baptisé par Jean, puis il se retire dans le désert
en solitaire pour se préparer à sa mission. De
retour
en Galilée après quarante jours, il entreprend un ministère itinérant
auprès des
populations
rurales. Accompagné de douze apôtres qu'il a choisis, il s'adresse aux
habitants avec éloquence, et opère de spectaculaires guérisons
miraculeuses
auprès des personnes malades et handicapées. Sa renommée d'orateur et
de thaumaturge se diffuse
dans tout le pays et l'on vient en foule pour le rencontrer.

La plus ancienne image connue
de Jésus,
peinte dans une catacombe romaine. IVème
s.
(interrobangtribune.blogspot.fr).
La théologie de Jésus s'exprime à travers des
paraboles inspirées de la vie ordinaire et dotées d'un sens moral et
spirituel. Il décrit la
relation avec un Dieu totalement bienveillant, qui invite chaque être
humain à construire sa vie sur un
altruisme
pacifique, l'invitant à se mettre au service de ses semblables au point
de
s'effacer lui-même. Aimer son prochain à l'exemple de Jésus, soutenir
les
personnes en difficulté, ne pas thésauriser, éviter de juger,
pardonner
en toutes circonstances, être confiant dans la prière : tous les
efforts consentis ne seront rien devant le bénéfice réel attendu
d'En-haut.

Le lac de Tibériade vu du mont Arbel
(generationword.com).
| 
Le cours actuel du fleuve Jourdain
(generationword.com).
|
Une importance première est accordée au souci
des
personnes défavorisées, que Jésus délivre de leurs maux tout
en leur
transmettant la "bonne nouvelle", un message d'espoir pour l'Au-delà.
Pourtant il ne cache pas qu'après la mort une sélection est faite entre
les
âmes en fonction des actes accomplis sur Terre. Le
royaume
céleste est promis à ceux qui font preuve d'une grande humanité.
Pour cela
Jésus veut sauver toutes les consciences égarées, préconisant la
conversion
des pécheurs par la patience et la prière plutôt que leur condamnation.
Toute
prière peut être exaucée avec une foi profonde, et même les miracles
sont à la
portée de chacun.
Jésus
se réclame du judaïsme auquel il veut cependant donner une
dimension nouvelle. Tout en respectant la loi hébraïque, il la
libère de
la rigidité d'une pratique trop littérale. La conception d'un Dieu
juste et autoritaire fait place à celle d'un Dieu d'amour et de
compassion. Pourtant son interprétation
de la Loi dérange les habitudes des prêtres et des docteurs, dont il
fustige l'hypocrisie. Il entre peu à peu en conflit avec le pouvoir
religieux du Temple, celui-ci considérant qu'il blasphème lorsqu'il
déclare être le fils de Dieu.
Son
enseignement se transmet oralement lors des déplacements en Terre
sainte à travers la Galilée,
la Judée, la Samarie et occasionnellement dans les pays
limitrophes.
Bien
qu'il soit impossible de
reconstituer l'itinéraire exact qu'il suivit, un grand nombre de lieux
qu'il
traversa sont aujourd'hui assez bien identifiés. Quelques-uns sont
marqués par
la tradition locale ou sont sortis de terre à la suite de fouilles
archéologiques.

Carte de la Palestine au temps de Jésus
(réalisée avec http://aquarius.geomar.de/omc).
Capharnaüm
Les écritures
font en quelque sorte de Capharnaüm la seconde patrie de Jésus après
Nazareth.
Elles rapportent en effet que Jésus s'y rendit plusieurs fois et qu'il
y résida
: "Puis, quittant Nazareth, il
habita Capharnaüm aux bords de la mer". Il y accomplit plusieurs
miracles, notamment les guérisons du serviteur d'un centurion, de la
belle-mère
de l'apôtre Pierre et d'un paralytique. Il enseigna dans la
synagogue de
cette ville, où il guérit également un possédé.
La ville fut identifié en 1838 par l'archéologue
américain
Edouard Robinson au site désolé de Tel Hun, sur la rive nord-ouest du
lac de
Tibériade. Le terrain fut acheté par l'ordre des franciscains en 1894,
qui y
mena plusieurs campagnes de fouilles dont la plus importante fut
conduite entre
1968 et 1986 par les pères Virgilio Corbo et Stanislao Loffreda.
L'occupation du
site est attestée à partir du IIème siècle avant notre ère. Ce village
de
pêcheurs était également un poste-frontière avec la Transjordanie et
comprenait
un bureau de douane. La présence d'une garnison romaine est évoquée
dans les
évangiles, qui précisent que le centurion dont Jésus guérit le
serviteur avait
fait construire la synagogue de cette cité.
Une ancienne
borne militaire trouvée en 1975 près des ruines de Capharnaüm porte les
noms de
plusieurs citoyens romains. Bien qu'en partie illisible, cette pierre
atteste
d'une présence romaine en ce point qui contrôlait la route principale
vers
Damas.

Les
ruines de
la
synagogue de Capharnaum. Datant du IVe
s.
(thirdsermon.blogspot.com).
| 
Vestiges
de l'église recouvrant
la maison supposée de
l'apôtre Pierre
à Capharnaum
(greatcommission.com).
|
Les restes d'un
antique bâtiment prestigieux se dressent encore dans la plaine,
constitué de
hautes colonnes de calcaire blanc et d'un seul pan de mur, qui tiennent
sur une
vaste terrasse dallée. Les parois et les chapiteaux des piliers sont
ornés de
nombreux motifs sculptés évoquant la liturgie hébraïque : un chandelier
à sept
branches, l'Arche d'Alliance et plusieurs espèces d'animaux. Il s'agit
visiblement des restes d'une synagogue dont la construction remonte au
IVème
siècle de notre ère.
La structure
repose sur un soubassement de basalte noir, qui contraste avec la
clarté du
dallage en calcaire. Sa position surélevée suggéra aux fouilleurs
qu'elle
pouvait dissimuler un monument plus ancien construit en-dessous. C'est
ce que
l'équipe du père Corbo tenta de révéler à partir de 1969, en retirant
une partie
du dallage de la terrasse. On exhuma en effet de vieux murs
d'habitations et
une seconde cour qui semblait appartenir à un monument public. Il
s'agissait
vraisemblablement d'une autre synagogue plus ancienne. Celle-ci fut
datée du
Ier siècle de l'ère chrétienne, ce qui permit de l'identifier à celle
que Jésus
devait fréquenter lorsqu'il séjournait à Capharnaüm.

Graffiti
trouvés dans la
maison
de l'apôtre Pierre,
sur des restes
d'un ancien revêtement de murs
(198.62.75.1/www1/terras).
| 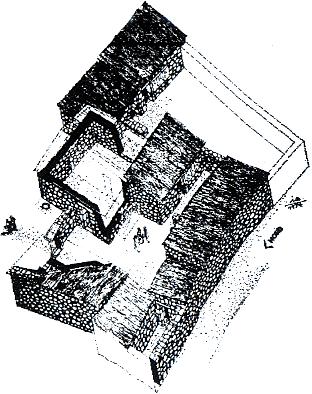
Reconstitution
de la maison
de Pierre
à Capharnaum
(christiananswers.net).
|
Une autre
découverte d'importance majeure a été faite à une trentaine mètres au
sud de la
synagogue. Au milieu des ruines d'anciennes habitations, la base d'une
petite
église byzantine du IVème siècle furent mise au jour, curieusement
disposée
selon un plan en deux octogones concentriques. Sous cette structure se
trouvaient
les restes d'une simple habitation, qui portait les traces explicites
d'un
christianisme primitif. Plusieurs graffiti inscrits sur les restes des
murs
portent en effet les noms de Jésus et de Pierre, ainsi que les mots "Messie", "Seigneur", "Dieu",
de même que des dessins de croix, de navires et de poissons.
Les moines qui
ont examiné ces précieuses inscriptions ont fait un rapprochement avec
le
contenu d'un document littéraire susceptible de se rapporter à ce site.
C'est
le récit de voyage de la pèlerine Egérie (IVème siècle), qui nous
apprend que : "A Capharnaüm, la maison du prince
des apôtres (Pierre) est devenue une église. Les murs sont restés
jusqu'aujourd'hui tels qu'ils étaient". Il est possible que ce
texte
concerne la maison aux graffiti, puisqu'une église paléochrétienne de
l'époque
d'Egérie lui est superposée. Ces éléments menèrent à la conclusion que
cette
maison n'était autre que la demeure de saint Pierre, et que
Jésus-Christ
lui-même avait vécu dans cette habitation.
Depuis
la découverte de la "maison de Pierre", les vestiges de Capharnaüm
sont redevenus un lieu de pèlerinage. Juste au-dessus des fouilles a
été
récemment construit un bâtiment contemporain surélevé, dont le plancher
partiellement vitré offre de l'intérieur une vue sur les anciens murs.
Tibériade
Sur les rives du lac auquel
elle a donné son nom, la ville de Tibériade fut fondée vers l'an 26 de
notre
ère par le tétrarque Hérode Antipas, pour honorer l'empereur romain
alors en
place. Elle est citée une fois dans l'évangile de Jean (6, 23) alors
que Jésus
parcourt la Galilée et la région du lac. Il n'est pas précisé si Jésus
s'est
rendu à Tibériade. Cependant, les ruines de cette cité ont réservé aux
archéologues de belles surprises.
Bien identifiée
sur la rive occidentale du lac (appelé également lac de Génésareth, ou
mer de
Galilée), elle est entourée d'une muraille du VIème siècle d'une
longueur
exceptionnelle, qui escalade les pentes escarpées du mont Bérénice en
inclant
le sommet dans son périmètre. Ce point culminant a été fouillé en 1990
par
Yizhar Hischfeld, du Département des Antiquités d'Israël, qui cherchait
alors
le palais de la reine Bérénice de Judée. Au
lieu d'un palais, c'est en fait un important complexe ecclésiastique et
une
superbe basilique qui l'attendaient. L'église byzantine du VIème siècle
qu'il
dégagea était entourée d'une vaste cour et de nombreuses salles aux
sols
couverts de mosaïques. Les splendides sols multicolores représentaient
des
oiseaux, des plantes et des motifs géométriques. Les fouilleurs se
demandaient
ce qui avait pu justifier la construction d'un tel complexe en un tel
lieu,
lorsqu'ils constatèrent qu'il dissimulait un objet inhabituel.

Ancre de pierre trouvée
sous un autel byzantin
à Tibériade
(mfa.gov.il).
Sous la base de
l'autel principal de la basilique, une plaque de marbre attira
l'attention des
chercheurs. En la soulevant, ils virent apparaître une fosse contenant
une
grande pierre taillée d'une manière particulière. Longue de un mètre,
sa base
était grossièrement taillée en pointe et son centre était percé d'un
trou
biconique. A quel usage cet objet était-il destiné ? De toute évidence,
cette
pierre était une ancre de navire. C'est son emplacement qui est le plus
surprenant. Pourquoi une ancre était-elle enterrée sous l'autel de
cette église
? Si l'on sait que les chrétiens placent parfois des reliques sous
leurs
autels, on peut supposer que cette ancre en était une. La proximité du
lac de
Tibériade permet d'envisager un lien avec une barque qui servit à Jésus
ou à
ses proches. Cependant, si cette ancre a la forme de celles des barques
du Ier
siècle, sa taille est en revanche nettement supérieure ; elle
correspondrait
plutôt à une ancre plus ancienne de quelques siècles. L' "église à
l'ancre" n'a pas fourni davantage d'explications.
Gennésareth
Une belle opération d'archéologie de
sauvetage fut réalisée à la faveur d'une forte sécheresse, qui marqua
l'année
1986 et qui provoqua une baisse exceptionnelle du niveau du lac de
Tibériade.
Ce fut pour deux pêcheurs israéliens l'occasion de réaliser un vieux
rêve.
Les frères
Yuval et Moshe Lufan habitaient le village de Kibboutz Ginosar, un port
de
pêche implanté sur la rive nord-ouest du lac. Ils pratiquaient
occasionnellement l'archéologie en amateurs dans l'espoir de découvrir
quelque
vestige ou épave antique. Ils arpentaient les berges semi-asséchées du
lac,
lorsqu'ils distinguèrent les contours d'un objet ovale ayant la forme
d'une
barque qui affleurait dans la boue. En grattant le sable ils virent que
l'objet
était fait de bois vermoulu. Petite coïncidence, l'instant de la
découverte
s'accompagna d'un phénomène naturel extrêmement rare : un arc-en-ciel
lunaire
...
L'existence de
l'épave fut signalée au professeur Shelley Wachsmann, spécialiste
d'archéologie
sous-marine au Département des Antiquités d'Israël. L'expert l'examina
et
confirma qu'elle semblait très ancienne et qu'elle justifiait un
sauvetage. On
décida d'extraire l'objet de la boue, entreprise à la fois délicate et
urgente
avant la remontée des eaux. Une méthode adaptée à la situation fut
définie, et
l'opération fut menée promptement durant onze jours et onze nuits avec
la
participation active des villageois.
La méthode
consista à créer d'abord une digue d'assèchement, qui permit d'évacuer
manuellement la glaise entourant le navire. Puis l'épave fut
conditionnée dans
une enveloppe de mousse polyuréthane, remise à l'eau ainsi empaquetée
et
remorquée jusqu'au port de Gennésareth. Arrivé à bon port, le vieux
navire fut
délivré de sa mousse et plongé dans un bain chimique soigneusement
contrôlé. Le
traitement avait pour but de remplacer progressivement l'eau imprégnant
le bois
par de la cire synthétique. L'épave demeura ainsi immergée pendant une
durée de
sept ans. Ce processus terminé, l'objet fut empaqueté de nouveau et
emporté par
une grue jusqu'à son lieu de conservation définitif, c'est-à-dire dans
le musée
Ygal Allon de Kibboutz Ginosar créé pour l'occasion.

Une barque datant du premier siècle
trouvée
près de Gennésareth
(fourquestions.us).
L'examen
détaillé du navire révéla que c'était un voilier de pêche d'époque
romaine.
Mesurant plus de huit mètres, il fut construit avec des matériaux de
réemploi
fixés avec des tenons et des mortaises, et avait subi plusieurs
réparations
avec des bois d'essences différentes. Le lieu de sa découverte était
jonché de
clous et d'attaches métalliques, et la coque contenait une petite lampe
à
huile. Le professeur Richard Steffy, de l'Université du Texas, estima
son âge,
d'après les techniques employées, à une période comprise entre le Ier
siècle
avant et le second siècle après J.-C.. Des analyses au carbone 14
complétèrent
la datation en donnant une fourchette de 50 avant à 75 après J.-C.
Le navire est
désormais l'une des épaves les mieux conservées de cette époque. C'est
probablement un navire de ce type qu'utilisèrent Jésus et ses apôtres,
ce qui a
rendu cet objet célèbre sous le nom de "barque de Jésus".
Le puits de Jacob - la Samaritaine
Tout voyageur qui se rend par
voie terrestre de Judée en Galilée est obligé de traverser la région de
Samarie. Si l'on remonte à l'Ancien Testament, les habitants de la
Samarie
étaient les héritiers de l'ancien royaume du Nord qui avait fait
sécession à la
mort du roi Salomon. Cette séparation avait laissé dans les esprits une
forte
animosité. Les Samaritains construisirent même leur propre Temple sur
le mont
Garizim, ce qui fut une source supplémentaire de différend. Bien que
majoritairement déplacée sous la domination assyrienne, la petite
communauté
des Samaritains subsiste encore aujourd'hui, et a conservé sur place
ses rites
propres issus de leurs origines hébraïques, toujours pratiqués après
trois
millénaires.
Jésus
traversa la Samarie à plusieurs reprises pour se rendre en Galilée. Le
regard
qu'il portait sur ses habitants était différent de celui des autres
Juifs,
comme le montre l'évangile de la femme samaritaine avec laquelle Jésus
entra en
conversation au bord d'un puits (Jn. 3). Celle-ci s'étonna d'abord
qu'il daigne
lui parler, puis réalisa sa qualité de prophète lorsqu'il devina sa vie
privée.
Lorsqu'elle lui demande de quelle montagne le culte devait être rendu,
Jésus
répondit de manière sibylline : "En
esprit et en vérité". Entendant qu'il était le messie, elle
retourna
hâtivement en informer les habitants de la ville.
L'évangile
précise en outre que ce puits avait jadis appartenu au patriarche
Jacob, et que
son fils Joseph y avait été enterré au retour d'Egypte (Gn. 34 ; Js.
24, 32).

Le
puits de Jacob vers 1900
(godrules.net).
|

Le puits de Jacob
aujourd'hui
(atlastours.net).
|
Non loin de
Sichem en Samarie, il existe un "puits de Jacob" que la tradition
locale rattache aux récits des deux Testaments. Les premières fouilles
furent
effectuées en 1893 sur le site du puits. Il est permis de rapprocher ce
puits
de celui de l'évangile, si l'on tient compte de plusieurs éléments. Le
point
d'eau semble d'abord très ancien et daterait de plusieurs siècles avant
l'ère
chrétienne. De plus, dans sa conversation avec Jésus la Samaritaine
désigne une
montagne sacrée toute proche ; or le puits de Jacob traditionnel se
trouve
précisément au pied du mont Garizim. La Samaritaine précise également
que le
puits est profond, ce qui est le cas de celui-ci qui descend à 46
mètres. Ces
caractéristiques correspondent bien aux indications des textes
bibliques.
L'histoire du
puits de Jacob durant les siècles suivants est assez bien documentée.
Au IVème
siècle de notre ère, les Byzantins élevèrent au-dessus du puits une
petite
église grecque en forme de croix. Elle fut rasée au IXème, puis
remplacée par
une autre en 1150, qui se dégrada. Les moines orthodoxes grecs firent
l'acquisition du site en 1860, et entamèrent une nouvelle construction
qui
resta inachevée. Ce n'est qu'en 2007 que fut menée à son terme la
construction
d'une église moderne de grandes dimensions. Si l'on descend aujourd'hui
dans la
crypte de ce vaste sanctuaire, on peut encore s'asseoir comme le fit le
Christ
sur la margelle du vénérable puits.
La montagne de la Multiplication des pains
L'un
des miracles les plus célèbres semble s'être déroulé en un lieu
aujourd'hui
marqué par une pierre désignant l'endroit exact où il se produisit.
Jésus
acompagné par la foule s'était éloigné de toute habitation, et la
journée était
bien avancée lorsque les apôtres soulevèrent le problème du
ravitaillement. La
foule qui avait suivi Jésus était innombrable, au moins cinq mille
personnes
est-il écrit. Il prit alors les seuls cinq pains et deux poissons qu'on
avait
trouvés et les fit distribuer au peuple, qui en reçut en quantité plus
que
suffisante.
Les indications géographiques données quant au lieu
du
miracle sont assez floues. La multiplication des pains se serait
déroulée "de l'autre côté de la mer de Galilée,
de Tibériade". Il est également précisé qu' "Il les
prit alors avec lui en direction d'une ville appelée Bethsaïde",
qu' "Ils partirent donc en barque
pour gagner un lieu solitaire, isolé" et qu' "Il y
avait en cet endroit beaucoup d'herbe". Le souvenir
du lieu a été perdu au VIIème siècle, lorsque le pays fut dévasté par
l'invasion perse. Sa redécouverte fut possible des siècles plus tard
grâce aux
écrits de la pèlerine Egérie, une voyageuse espagnole du IVème siècle.
Son
témoignage décrit le lieu du miracle comme un lieu verdoyant placé en
bordure
du lac :
"Dans ces lieux-mêmes
(non loin de
Capharnaüm), face à la mer de Galilée, est une terre où l'eau abonde,
où pousse
une végétation luxuriante, aux nombreux arbres et palmiers. A proximité
se
trouvent sept sources qui fournissent de l'eau en abondance. Dans ce
jardin
fertile Jésus nourrit cinq mille personnes avec cinq pains et deux
poissons. La
pierre sur laquelle le Seigneur déposa le pain devint un autel. Les
nombreux
pèlerins venus sur le site la brisèrent en pièces pour soigner leurs
maux."
Cette
description pourrait correspondre à un lieu-dit appelé Tabgha, une
vallée
fertile située sur la rive nord-ouest du lac entre Capharnaüm et
Magdala, et
arrosée par plusieurs sources. Le nom de Tabgha est peut-être une
déformation
arabe du mot grec Heptapegon qui
signifie "sept sources".

Le site de Tabgha. Vue aérienne
(fectio.org.uk).
Le terrain de
Tabgha fut acquis en 1888 par la Deutsche
Katholische Palestinamission, qui avait l'intention d'y
entreprendre des
fouilles. En 1932, ce furent les archéologues allemands Mader et
Schneider qui s'attelèrent à
cette tâche. Ils ne furent pas déçus, car les bases d'une splendide
église
byzantine du Vème siècle se révélèrent à eux. Le monument intégrait une
magnifique mosaïque qui recouvrait tout le
sol de la nef. Cette oeuvre exceptionnelle représentait un
environnement fluvial
et marécageux plein de bonheur, avec diverses espèces d'oiseaux et de
plantes
aquatiques.
Juste devant
l'autel, une image devenue célèbre montre une corbeille contenant cinq
pains et
entourée de deux poissons. Elle a permis d'identifier le lieu : c'est
l'église
des pains et des poissons, que l'on a reliée au récit biblique du
miracle. Sous la
table du même autel se trouve l'élément le plus important, un bloc de
calcaire
non taillé qui émerge au milieu de la mosaïque. Si la description
d'Egérie est
juste, il s'agit alors de la pierre sur laquelle Jésus aurait déposé le
pain au
moment de sa multiplication ...

Sous l'autel de
l'église de
Tabgha,
le rocher où Jésus aurait déposé le pain
multiplié
(atpm.com).
Les fouilles de Tabgha révélèrent également que
l'église byzantine du Vème siècle était construite sur les fondations
d'un
autre sanctuaire encore plus ancien, qui fut identifié comme une
chapelle du
IVème siècle. L'ensemble du site a été patiemment restauré, et son
architecture
antique même respectée, puisqu'en 1982 une église a été rebâtie sur les
ruines
de celle du Vème siècle, selon un plan autant que possible conforme à
l'originale.
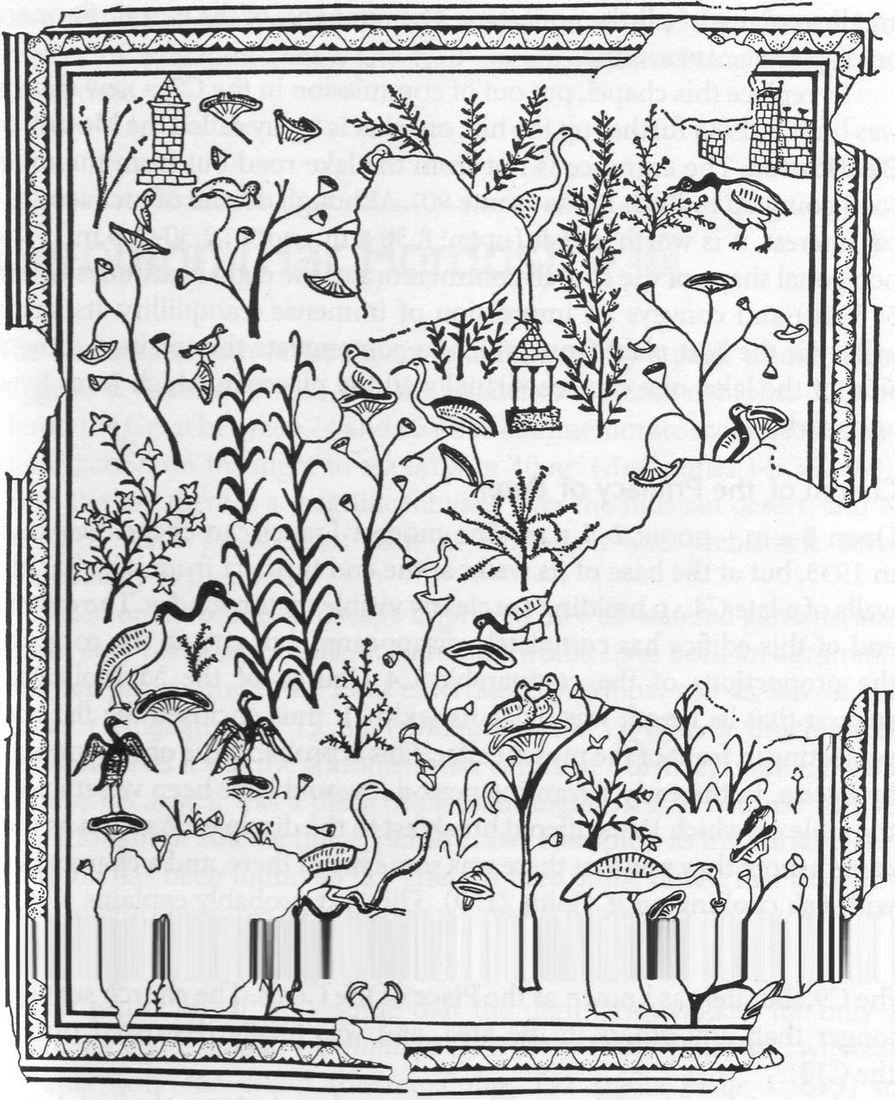
Mosaïque de Tabgha
(sacred-destinations.com).
Le
mont de la Transfiguration
Jésus
se déplaça jusqu'à la région de Césarée de Philippe, dans le sud de la
Syrie.
Il gravit une haute montagne accompagné de trois de ses apôtres qui
furent les
témoins d'une vision surnaturelle. Devant eux son aspect physique
changea
soudain pour apparaître extrêmement lumineux. Deux autres personnages
apparurent au cours de cette vision, identifiés aux anciens prophètes
Moïse et
Elie. Une voix céleste retentit et recommanda de faire confiance au
Fils
Bien-aimé (Mt. 17, 1 ; Mc. 9, 2).
Le nom de la
montagne où se passa la Transfiguration n'est pas précisé, ce qui ne
facilite
pas son identification. On a longtemps situé cet épisode sur le mont
Thabor,
une colline haute de 600 mètres située au sud-ouest du lac de
Tibériade. Cette
position est défendue par certains textes anciens. Pourtant le mont
Thabor est
peu élevé et bien éloigné de la nordique Césarée de Philippe. La ville
de
Césarée de Philippe se trouve à cinquante kilomètres au nord du lac, et
sur la
rive est du Jourdain. De plus, le sommet du Thabor était au premier
siècle
occupé par un fort militaire.
En revanche,
une autre montagne qui a davantage ses chances est la chaîne de
l'Hermon, un
massif situé encore plus au nord que Césarée et qui culmine à 2800
mètres.
C'est plutôt dans ce lieu lointain et isolé que le phénomène se serait
produit. Toujours est-il que la tradition a conservé le mont Thabor
comme lieu
supposé de
l'évènement ; c'est sur le Thabor, plus facile d'accès pour les
pélerins,
qu'ont été construites plusieurs églises successives dont l'actuelle
basilique
de la Transfiguration.

Le mont Thabor, lieu supposé
de la
Transfiguration
(biblewalks.com).
L'absence de certitude sur
l'authenticité du lieu a cependant
laissé de la
place pour le rêve et l'imagination. Un pèlerin du Vème siècle plein
d'inspiration eut un jour l'idée de concrétiser les paroles prononcées
par
Pierre pendant la vision : "Maître,
il est heureux que nous soyons ici ; dressons donc trois tentes, une
pour toi,
une pour Moïse et une pour Elie". Trois sanctuaires byzantins
furent
par conséquent élevés sur le mont Thabor. Démolis et reconstruits
plusieurs
fois durant les siècles suivants, leurs restes sont aujourd'hui
intégrés à
l'actuelle basilique franciscaine de la Transfiguration bâtie en
1924.
Si
l'on descend dans la crypte de la basilique, on peut admirer quatre
magnifiques
mosaïques représentant la vie du Christ. Les moines franciscains aiment
à dire
que par beau temps, les rayons solaires filtrent à travers les vitraux
et
jouent avec les couleurs des mosaïques, produisant des effets
merveilleux en
souvenir de la luminosité du Christ resplendissant.
|