|
Le Nouveau Testament s'ouvre sur quatre livres successifs, les évangiles, qui relatent chacun la vie de
Jésus de
Nazareth et dont les rédactions sont attribuées à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces
auteurs
s'identifient à quatre de ses disciples, apôtres ou témoins indirects
de sa
vie. Le contenu de ces textes indépendants est à peu près le même, à
quelques
différences près qui résident essentiellement dans la sélection des
épisodes
relatés.
C'est
le cas pour la naissance et les premières années de la vie du Nazaréen,
rapportées
seulement dans les évangiles de Matthieu et de Luc, et plus précisément
chez Luc
qui relate la révélation de sa future naissance.
A
Nazareth en Galilée, sous le règne d'Hérode le Grand, la jeune
villageoise
Marie eut une vision de l'ange Gabriel, qui l'informa qu'elle donnerait
naissance
à un fils voué à un grand destin devant Dieu. Marie étant encore
vierge, bien
que promise au charpentier Joseph, l'ange lui révéla que l'enfant à
naître serait
de conception divine (Lc. 1, 26-38).

L'entrée de la grotte de l'Annonciation
(fr.wikipedia.org).
La
grossesse de Marie mit son futur époux dans un embarras compréhensible.
Le
charpentier s'apprêtait à la répudier secrètement, lorsqu'il reçut à son
tour
une vision de l'ange précisant l'origine divine de l'enfant. Dès lors,
il
accepta d'épouser sa fiancée (Mt. 1, 18-25).
Le récit fait naître Jésus
non pas à Nazareth, mais à Bethléem en Judée, où ses parents durent se
rendre
pour un recensement de population. C'est ensuite à Nazareth qu'il
grandirait
avant d’accomplir sa mission publique à travers la Terre sainte.
La grotte
de
l'Annonciation
La
localité appelée Nazareth est implantée à l’Ouest du lac de Tibériade,
sur
une
colline proche de la vallée de Jezréel. Ce village insignifiant à
l'époque antique
est devenu aujourd'hui une ville de plus de soixante mille habitants,
où réside
la plus forte population arabe d'Israël et où se trouve l'un des plus
importants hauts lieux spirituels de la chrétienté.
Deux
millénaires
de
tradition chrétienne situent l'apparition de l'ange à Marie dans une
grotte
naturelle de Nazareth, un modeste abri rocheux aujourd'hui protégé par
un vaste
édifice contemporain : la basilique de l'Annonciation. Construite
en 1964
et reconnaissable à sa large coupole au toit conique, elle constitue
maintenant
la plus grande église de tout le Proche-Orient. Dans sa vaste nef
moderne, un
choeur en léger contrebas est construit en face de l'entrée d'une
crypte.
Quelques marches descendent vers une arche de pierre qui marque
l'entrée de la
grotte de l'Annonciation.

La grotte de
l'Annonciation
(holylandphotos.org).
L'intérieur offre un espace réduit dans
lequel un simple autel côtoie une colonne de
marbre
et quelques restes de murs anciens. Derrière l'autel s'ouvre un passage
vers un
petit escalier en angle qui remonte vers une citerne. Si la tradition
est
exacte, cette cave serait le cellier ou l'annexe d'une habitation de
pierres
bâtie en avant de celle-ci. L'apparition de l'archange se serait
produite dans
cette pièce retirée de ce qui était peut-être la résidence familiale de
Marie.
A
gauche de l'entrée en arcade de la grotte, s'ouvre une seconde cavité
appelée
le « martyrium de Conon », un espace qui contient entre
autres un intéressant
sol en mosaïque du Ve siècle et divers aménagements.
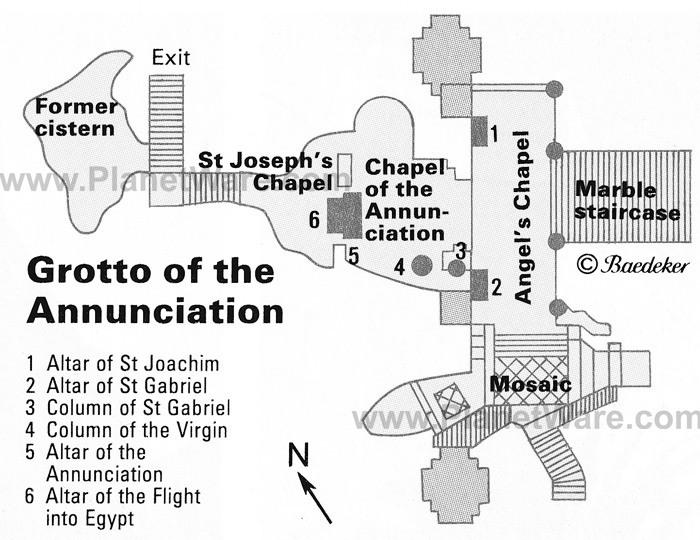
Plan de la grotte de l'Annonciation
(planetware.com).
Des fouilles
archéologiques ont été menées sur le site avant l'édification de la
basilique,
par des moines franciscains à partir de 1889 puis de 1955 [1].
L'équipe du père Bellarmino Bagatti, du Studium Biblicum
Franciscanum de
Jérusalem, dégagea les restes de plusieurs églises anciennes imbriquées
les
unes dans les autres. On découvrit ainsi les vestiges d'une église
croisée du
XIIe siècle, puis ceux d'une église byzantine du Ve, puis encore
quelques
éléments susceptibles de remonter au Ier siècle.
Certaines
pierres très anciennes sont revêtues d'un enduit marqué de signes et
d'inscriptions fort instructifs. La base d'une colonne antique porte
l'expression : « Xe Marya »,
c'est-à-dire : « Salut à Marie ». Ce graffiti est
antérieur au IVe
siècle et représente la plus ancienne inscription connue relative à la
Vierge.
D'autres inscriptions portées par des morceaux de revêtements
confirment le
caractère marial du sanctuaire, s'exprimant dans les mots : « Belle Dame », ou encore : « Sur
le lieu saint de M(arie), j'ai
écrit ».

Inscription
"Xe
Maria" sur
une antique
base de colonne en face
de la grotte
(christusrex.org).
L'intérieur
de la cave du diacre Conon intègre dans son sol en mosaïque le texte
d'une
dédicace : « Pour Conon, diacre
de Jérusalem ». Les archives historiques mentionnent en effet
un
certain saint Conon, martyr chrétien de Nazareth, parent éloigné de la
famille
de Jésus et exécuté en Asie Mineure en 249. D'autres informations
figurent
également sur l'une des parois de cette cave recouverte de six couches
de
plâtre. Une inscription peinte en rouge, antérieure au IVe siècle,
exprime une supplication
angoissée : « Seigneur
Jésus-Christ, Fils de Dieu, aidez votre servante Valeria ... et faites
passer
la douleur ... Amen ».
Ces
indices émouvants
témoignent que le lieu était déjà considéré comme saint par des
chrétiens à
partir des IIIe-IVe siècles.
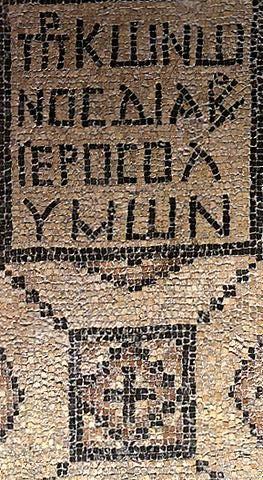
La
mosaïque du diacre
Conon
(codexbezae.perso.sfr.fr).
Autour de
la basilique, l'équipe du père Bagatti trouva des traces
d'occupation
s'échelonnant sur plusieurs millénaires avant et après J.-C. La ville
est
construite sur un réseau dense de cavités naturelles, susceptibles
d'avoir
servi d'habitations dans des temps reculés. Quelques traces
d'occupation
humaine ont été mises au jour, mais pendant longtemps aucune
construction maçonnée
datant du Ier siècle ne fut trouvée. Cette lacune a semé le doute chez
certains
érudits qui en ont conclu que le village de Nazareth n'existait pas
encore au
temps de Jésus [2]. Ce
problème a alimenté une controverse pendant des
décennies.
Une maison
juive du Ier siècle
Il
existe certes à Nazareth d'autres sites associés
à la sainte famille par la tradition. Ainsi une fontaine de la Vierge,
un
atelier de Joseph le charpentier et les restes d'une ancienne synagogue
peuvent
être visités. Ces vestiges ont livré des artéfacts d'époque romaine
tardive,
mais ne prouvent pas l'existence d'un village véritable au temps de
Jésus [3].
Que
les pélerins attachés à la tradition biblique
se rassurent : les doutes sur l'ancienneté du village ont
apparemment été levés.
Lorsqu'en 2009 la construction d'un grand centre pédagogique multimédia
dédié à
Marie fut entreprise à côté de la basilique de l'Annonciation, le
creusement de
ses fondations permit de découvrir des restes d'anciens murs
d'habitations. Le
terrain fut fouillé par le Service des antiquités d'Israël sous la
direction de
Yardenna Alexandre, qui identifia un enclos maçonné comprenant deux
pièces, une
cour, une citerne, un abri et des jarres de craie. Détail important, ce
matériau est caractéristique des poteries juives du Ier siècle car il
est
rituellement plus pur que l'argile. Ces ruines sont donc celles d'une
maison
juive qui date certainement de l'époque de Jésus-Christ [4][5].

Maison juive du Ier siècle à Nazarerth
(wiki.faithfutures.org).
La tombe du
Juste
Il
arrive que des lieux réputés saints d’après la
seule tradition locale voient leur crédibilité brusquement renforcée
par l'archéologie. A quelques dizaines de mètres au Nord de la
basilique de
l'Annonciation, un vieux couvent de religieuses fit un jour l'objet
d'une
étonnante découverte [6][7]. Le terrain avait été acheté au XIXe
siècle par les soeurs de Nazareth à des habitants qui affirmaient que
sous ce
terrain se trouvait la « tombe du Juste ». De quel
« Juste » s’agissait-il ? Etait-ce saint Joseph, père adoptif
de
Jésus à Nazareth et qualifié d' « homme juste » dans
l'évangile de Matthieu
(1,19) ? Quelques années plus tard, en 1884, un ouvrier qui
travaillait
dans la cour du couvent sentit soudain le sol se dérober sous ses
pieds. Il fit
une chute de deux mètres et se retrouva au milieu d'une ancienne salle
voûtée.
Les
religieuses
entreprirent alors elles-mêmes des fouilles. Le sous-sol livra des
vestiges
superposés remontant à plusieurs époques : une église byzantine et
médiévale, une habitation privée, des bains rituels, un dallage romain
et enfin
un réseau profond de caves naturelles accessibles par plusieurs
escaliers
successifs. L'une de ces cavernes était aménagée en chapelle, avec un
autel de
pierre et une odeur d'encens persistante. Au niveau le plus bas, une
pierre
roulée fermait l'entrée d'un tombeau rupestre.

Tombe
rupestre trouvée
sous le couvent des soeurs de Nazareth
(bible-archaeology.info).
L'ouverture
de cette tombe révéla qu'elle contenait deux niches funéraires vides,
un
squelette assis dans un angle et divers objets datant de l'époque des
croisés :
une bague, des lampes à huile et des pièces de monnaie. Le mobilier
était d’époque
croisée, mais l'agencement de la tombe était typique du Ier siècle.
La plupart
de ces
objets furent imprudemment confiés à des pélerins pour expertise, et on
ne les
revit jamais. Malgré cette perte regrettable, l'ensemble des
informations
recueillies indiquait que le culte d'un saint avait été pratiqué dans
cette
cave. En l'absence de plus de précision, la « tombe du
Juste » de
Nazareth demeurait candidate pour être celle de Joseph le charpentier.
La
maison d'enfance de Jésus ?
Des
précisions importantes furent cependant apportées lors de nouvelles
fouilles, entreprises
en 2006 sur le même site par l’archéologue britannique Ken Dark, de
l’université
de Reading [8]. Elles
livrèrent quelques objets du début de l’époque romaine, dont des
fragments de
vaisselle de calcaire indiquant là aussi une occupation juive.
L’habitation en
partie creusée dans la roche intégrait un point d’eau et deux tombes,
manifestement
taillées peu de temps après son abandon. Le bon état de conservation de
l’ensemble
était dû à l’église byzantine construite par-dessus.

La "maison de Jésus"
sous le couvent des soeurs de Nazareth
(livescience.com).
Un
rapprochement fut proposé avec un texte intitulé De Locus
Sanctis, émanant du pélerin du VIIe siècle Adomnan d’Iona,
et qui parle de l’ « église de la Nutrition »,
c’est-à-dire de l’enfance
du Christ. Il décrit une église construite à Nazareth sur des voûtes et
qui
coiffe une source et deux tombes, entre lesquelles se tient la maison
où Jésus
aurait grandi. Cette disposition correspond exactement au site du
couvent de
Nazareth. Dès lors, l’archéologue Ken Dark identifia le site à la
maison de l’enfance
de Jésus, ou du moins à celle que les pélerins byzantins considéraient
comme
telle. Certes, la « tombe du juste », plus récente, ne
pouvait plus être
celle du charpentier Joseph, mais l’habitation elle-même devenait celle
de
Jésus et de sa famille.
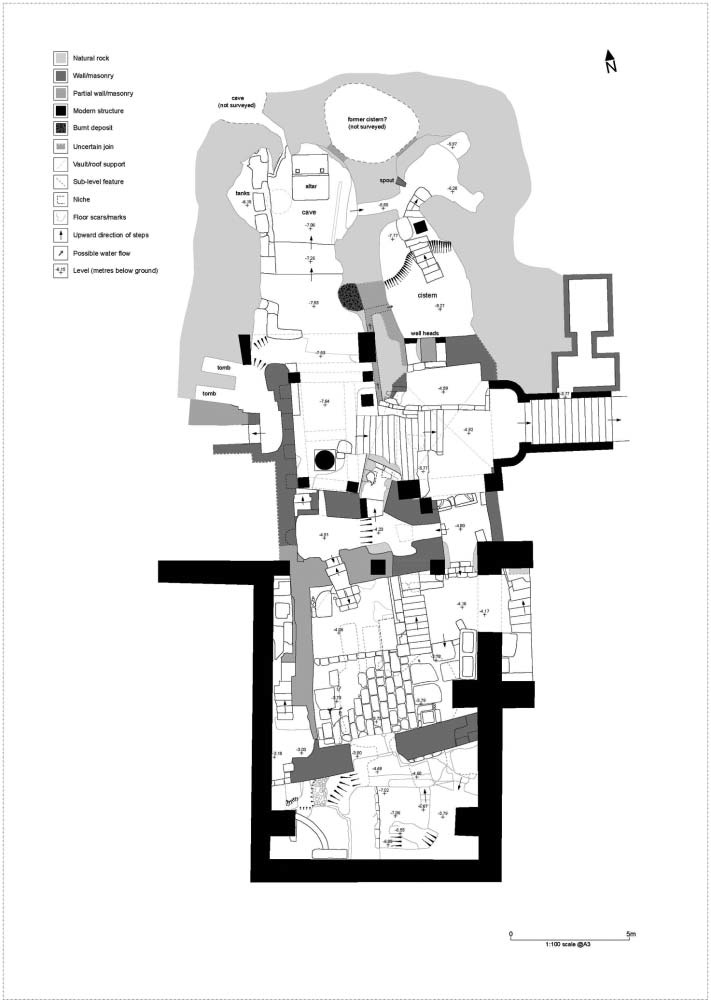
Plan du site de la "maison de Jésus"
sous le couvent des soeurs de Nazareth
(subcreators.com/blog).
Références :
[1] - B. Bagatti :
“Excavations in Nazareth”. Franciscan Printing Press, 1969.
[2] - R. Salm : “The Archaeology of Nazareth: A
History of
Pious Fraud?” SBL: November 17, 2012. http://www.nazarethmyth.info/SBL_2012_Salm_(Nazareth).pdf.
[3] - G. Jenks : « The
Quest for the Historical Nazareth ». School of Theology,
Charles Sturt University, 2013.
http://www.academia.edu/3988852/The_Quest_for_the_Historical_Nazareth.
[4] - D. Hadid : « First
Jesus-Era House Discovered in Nazareth ». APA 2009, december 21. http://phys.org/news/2009-12-jesus-era-house-nazareth.html.
[5] - “Residential
building from the time of Jesus exposed in Nazareth”. Israel Antiquities Authority, 21 dec. 2009. http://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/History/Pages/
Residential_building_time_Jesus_Nazareth_21-Dec-2009.aspx.
[6] - K. Dark : “Early Roman-Period Nazareth and the Sisters of
Nazareth convent”. The
Antiquaries Journal, Volume 92, September 2012, pp 37-64.
[7] - K. Dark : “The Byzantine Church of the Nutrition in Nazareth
Rediscovered ». Palestine
Exploration Quarterly, 144, 3 (2012), 164–184. http://subcreators.com/blog/wp-content/uploads/2015/03/Dark-Byzantine.pdf.
[8] - K. Dark : “Has Jesus’ Nazareth
house been found ?” Biblical
Archaeology Review, (2015) 41 (2). pp. 54-63. http://www.biblicalarchaeology.org/bar-issues/march-april-2015/#toc.
|
|