|
L'exil
forcé du peuple de Juda prit fin lorsque l'empire néo-babylonien
s'effondra à
son tour, victime de l'expansion du royaume perse, en 539 av. J.-C. Le
nouveau
conquérant, Cyrus II le Grand, venait de l'Est et constituait alors le
plus
vaste empire qu'ait connu le monde antique auparavant. A son apogée, il
allait intégrer
la Perse, la Mésopotamie, le Proche-Orient, l'Egypte et l'Asie Mineure.
L'immense
royaume allait se maintenir pendant deux siècles.
Le retour au pays
Le nouveau roi du Monde
fit paradoxalement preuve d'une grande tolérance religieuse à l'égard
des peuples qu'il avait soumis.
Plusieurs documents bibliques et historiques présentent en effet Cyrus
II comme
un libérateur. Un "édit de Cyrus" apparaît dans deux livres bibliques
(2 Chr. 36, 23 ; Esd. 1,2), document par lequel le roi perse autorise
les
Hébreux à retourner à Jérusalem et à y reconstruire leur Temple :
"Yahweh, le Dieu du Ciel, m'a donné
tous les royaumes de la terre ; il m'a chargé de lui construire une
maison à
Jérusalem qui se trouve en Juda. Quiconque d'entre vous appartient à
son
peuple, que Yahweh, son Dieu, soit avec lui et qu'il parte" (2 Chr.
36,
23).
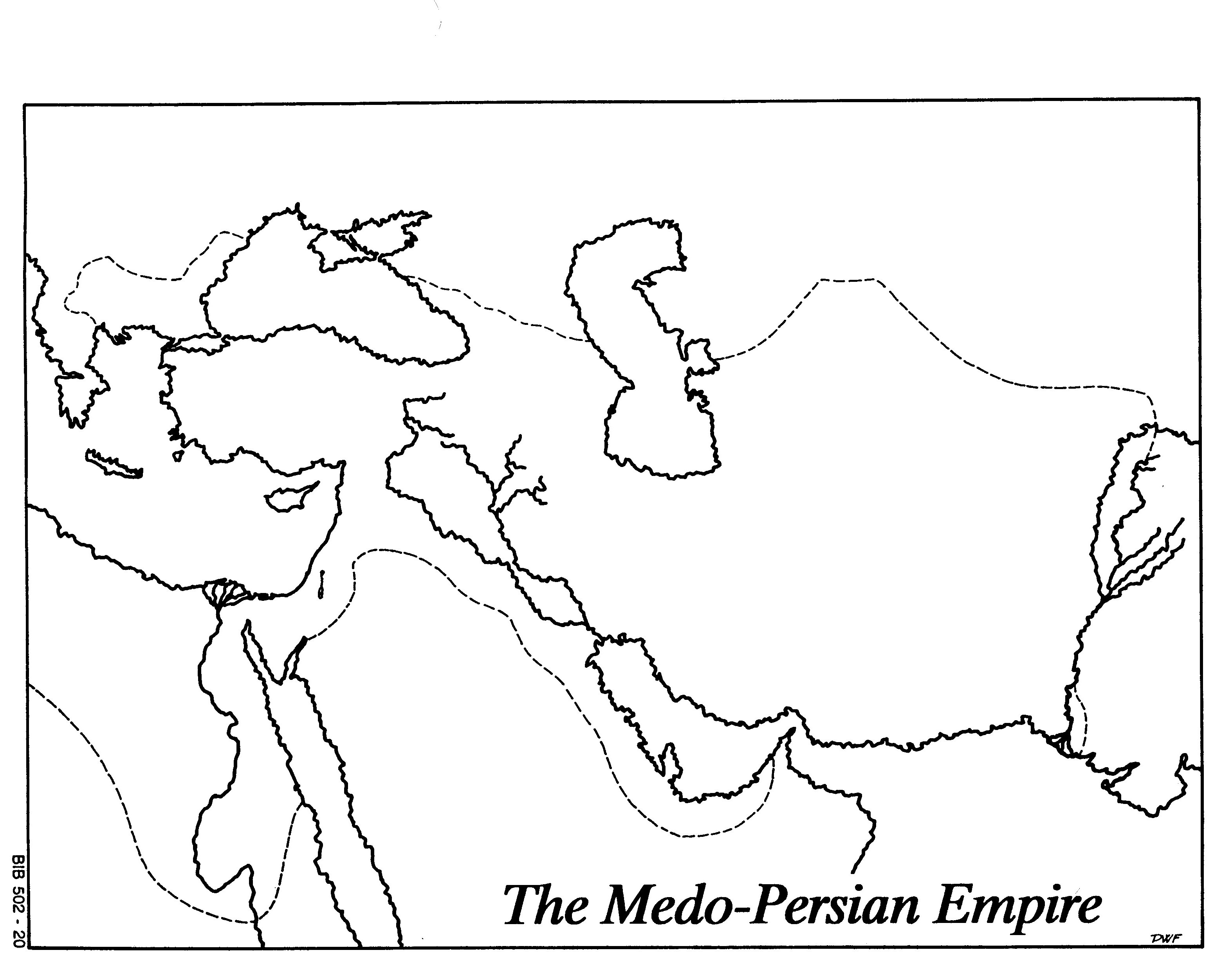
Carte
de l'empire
perse sous Cyrus II
(ot103.wordpress.com).
Ce texte est à comparer à un document
archéologique, le "cylindre de Cyrus", découvert à Babylone en 1879.
Sur
ce rouleau d'argile couvert de caractères cunéiformes est inscrite une
longue
déclaration du grand roi où il affirme avoir rendu la liberté à chaque
peuple :
"... J’ai ramené
en leurs lieux les dieux qui vivaient en elles (les villes)..., j’ai
rassemblé
tous les habitants et leur ai permis de retourner dans leurs villes..."
[1].

Le
cylindre de
Cyrus
(FreeStockPhotos.com).
La
chute de l'empire babylonien et l'édit de Cyrus ayant
dès lors rendu la liberté aux Juifs qui vivaient en exil, beaucoup
d'Israélites
présents à Babylone choisirent de rentrer à Jérusalem. Ils le firent
lors d'un
voyage mémorable, en formant une carvane de cinquante mille personnes
conduites
par le gouverneur juif Zorobabel et le grand-prêtre Josué.
Les exilés de retour à Jérusalem
trouvèrent
la cité sainte à l'état de ruines. La ville nécessitait d'être
reconstruite
pour accueillir sa nouvelle population. On s'attacha d'abord à
restaurer le
Temple, mais l'hostilité des peuples voisins retarda les travaux
pendant
plusieurs années. ll fallut intervenir auprès du roi perse Darius pour
que le
Temple puisse être achevé et rendu au culte (Esdr. 1-6). De même, le
mur d'enceinte
de la ville avait besoin d'être réparé : ce fut la mission du
gouverneur
Néhémie, nommé par le roi perse Artaxerxès, que d'organiser sa
reconstruction. Néhémie
instaura un tour de rôle pour défendre le chantier et y travailler. A
ce prix les
travaux furent menés à leur terme et la capitale retrouva sa sécurité
(Neh.
1-6).
La
période post-exilique est en même temps un moment
de renouveau spirituel. Le scribe Esdras, grand réorganisateur du culte
monothéiste, fonda la "Grande Assemblée" des sages (le futur
Sanhédrin) chargée de gérer la vie religieuse. Esdras, qui présidait à
la
lecture publique de la Torah, fit traduire le texte en araméen à
l’intention du
peuple rentré de Babylone qui ne parlait plus l'hébreu. C'est en effet
à partir
de cette époque que l'araméen commença à remplacer l'hébreu dans le
langage
courant. La pratique de l’écriture évolua dans le même sens, puisque
l'alphabet
paléo-hébreu fit place à l'hébreu carré, une forme nouvelle inspirée de
l'alphabet
araméen.
La
première Diaspora
Toutes les familles juives
n'optèrent
pas pour le retour au pays après la chute de Babylone. Il se forma à
l'étranger
une première "diaspora" (dispersion), c'est-à-dire une implantation
israélite durable dans de nombreux pays. Des communautés juives se
stabilisèrent
en Chaldée, en Asie Mineure, en Egypte,
à Rome, en Perse et même en Ethiopie.
Les conditions de vie
des Israélites hors de leur patrie étaient supportables. Selon certains
livres
bibliques, il arriva même que des émigrés juifs fussent promus à de
très hautes
fonctions. Ainsi le livre de Daniel affirme-t-il que ce prophète devint
le chef
des satrapes (les gouverneurs de provinces) du roi de Perse Darius.
Jalousé par
ses pairs, Daniel fut victime d'un complot et jeté dans une fosse aux
lions d'où
il sortit miraculeusement indemne (Dn. 6).
De même le livre d'Esther met-il
en
scène une jeune femme juive qui devint l’épouse du roi de Perse
Assuérus. Elle
sauva la communauté israélite de Suse d'un génocide, déclenché par le
premier ministre
Aman, en intervenant avec émotion auprès du monarque. Sa mémoire est à
l'origine de la fête juive traditionnelle de Pourim.
La figure du roi Assuérus
est à peu près historique, car il est assimilé à Xerxès Ier qui
séjourna à Suse.
Cette cité fut profondément transformée par Darius Ier, qui se fit
bâtir un somptueux
palais achevé par son fils Xerxès Ier. Les vestiges de l’imposant
monument ont
été fouillés par Jean Perrot entre 1967 et 1979. Ils comprennent une
grande enceinte,
des terrasses, des cours, des salles à colonnes décorées de taureaux
sculptés et
une splendide frise représentant des archers en briques émaillées. La
reine
Esther a-t-elle vécu dans ce palais ? A-t-elle seulement existé ?
Rien ne
le prouve, mais la disposition de l'édifice peut cadrer avec le
déroulement du drame [2].

La
frise des archers à Suse
(ancient.eu)
A côté de ces textes plus ou moins réalistes, l'existence de colonies
juives dispersées dans l’empire
perse à
partir du Ve siècle av. J.-C. est en revanche bien établie. Plusieurs
auteurs
antiques comme Strabon, Philon d'Alexandrie, Sénèque et Flavius Josèphe
en
témoignent. On en trouve également des traces sur le terrain, comme à
Nippur où
les fouilles ont livré les archives d'un établissement financier
prospère appelé
Murashu et qui travaillait avec des familles juives [3]. De
même qu'en Egypte, un lot de papyrus nous
informe qu’un temple dédié à Yahweh existait sur l'île d'Eléphantine au
Ve
siècle av. J.-C. [4]. Ces
communautés juives éloignées se sont maintenues
durant les siècles suivants.
Références :
[1] - J. Lendering : "Cyrus
Cylinder" (livius.org).
[2] - T.
Truschel : "La Bible et
l'archéologie". Eds.
Faton, Dijon 2010, p. 211.
[3] - M.D. Coogan :
"Patterns in Jewish Personal Names in the Babylonian Diaspora". Journal of the Study of Judaism Volume
4, Issue 2, 1973, pages 183-191 (booksandjournals.brillonline.com).
[4] - Cowley A., editor and
translator. "Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C." Oxford:
Clarendon,
1923 (cité par K.C. Hanson).
|
|