|
Quelques jours avant la Pâque juive, Jésus se
rendit à Jérusalem en même
temps
que de nombreux pélerins venus célébrer la fête juive
traditionnelle. Il y fit une entrée triomphale, monté sur
un âne et salué par une population en liesse qui agitait des branchages
pour
l'honorer. Il était pourtant conscient qu'il allait être arrêté et
condamné à
mort, mais il ne chercha aucunement à éviter l'issue fatale qu'il
considérait
comme une nécessité théologique.
Jésus
prit son
dernier repas en compagnie des douze apôtres, dans l'angoisse d'un soir
précédant la Pâque et la veille de son arrestation. Il institua le rite
de
l'Eucharistie, qui consistait à consommer du pain et du vin identifiés
à
son corps
et à son sang.
En
référence à l'Ancien
Testament, le dîner pascal
commémorait la libération
des Hébreux retenus esclaves en Egypte. Ceux-ci avaient consommé un
agneau
sacrifié la veille de leur départ. Jésus renouvela le rite en s'offrant
lui-même en sacrifice, le pain et le vin consommés s'assimilant à la
chair et
au sang de l'agneau tué. Sa démarche spirituelle s'inscrivait dans le
plan
divin du rachat des fautes de l'humanité par le sacrifice du Christ sur
la
croix.
Le
Cénacle
Le dernier repas de Jésus, appelé la
Cène, fut pris au premier étage d'une demeure de Jérusalem, dans une
salle qui
avait été réservée par les apôtres à la demande de Jésus (Mc. 14,
12-17).
Pierre et Jean s'étant rendus en ville, ils suivirent "un
homme portant une cruche d'eau". Entrés à sa suite
dans une habitation, ils demandèrent à réserver la salle du haut, "une grande pièce garnie de
coussins". Les apôtres y préparèrent le repas prévu pour le
soir-même.
La tradition chrétienne a gardé mémoire de cette
pièce,
appelée le Cénacle ou encore la "chambre haute". Elle se trouve sur
la colline de Sion, à quelques mètres au sud de la muraille actuelle de
la
ville et de la porte de Sion.
Cette pièce devait encore servir après la mort de Jésus, comme lieu de
réunion
et de refuge pour les apôtres et les premiers chrétiens. C'est là
qu'aurait eu
lieu une apparition de Jésus ressuscité, et c'est également là que se
déroula
la Pentecôte.

L'intérieur de la "chambre haute", ou Cénacle.
(FreeStockPhotos.com)
Au cours des
siècles suivants, la "chambre haute" fut démolie et reconstruite. Au
XIVème siècle on lui donna la forme d'une chapelle gothique à plan
carré, avec
une magnifique voûte en ogives. Aujourd'hui il en reste une belle pièce
carrée
au premier étage d'un bâtiment complexe. Le rez-de-chaussée est connu
pour
abriter un autre lieu saint traditionnel : le tombeau supposé du roi
David, qui
n'est en fait qu'un cénotaphe, ou mémorial.
L'arrestation à Gethsémané et le procès juif
Le repas terminé, Jésus et ses disciples
se rendirent dans un jardin appelé Gethsémané, sur le mont des Oliviers
situé à
l'est de la ville, de l'autre côté de la vallée du Cédron. Jésus passa
la nuit
sans dormir dans l'angoisse et la prière, redoutant le sort terrible
qui
l'attendait. Son arrestation eut lieu en fin de nuit dans ce même
jardin. Jésus
fut saisi par un groupe d'hommes armés qui firent irruption dans le
jardin,
sous l'ordre des prêtres juifs et guidés par l'apôtre Judas, qui servit
de
témoin pour identifier Jésus à coup sûr.
Sur cette colline est bâtie depuis 1924 une "église
de
toutes les nations", à la construction de laquelle de nombreux pays ont
participé. A l'intérieur de ce sanctuaire et devant l'autel est visible
un
large rocher plat sur lequel Jésus aurait prié et pleuré pendant les
longues
heures nocturnes.
A quelques mètres de là se trouve un autre
lieu-symbole de
la Passion : l'endroit supposé de l'arrestation. La tradition identifie
ce
point avec l'entrée d'une grotte, bien que les évangiles n'en fassent
pas état.
La vénération de cette caverne est attestée par saint Jérôme au VIème
siècle. Un
récit apocryphe de la Passion déclare que les moments les plus
angoissés de
Jésus ont été passés dans une caverne. En
1956, le site fut fouillé par les moines franciscains, qui y trouvèrent
des
fragments de mosaïque et d'autres vestiges remontant aux cinq premiers
siècles.
Parmi ceux-ci figuraient un pressoir à huile d'olive et une citerne. On
comprend mieux que les évangiles aient employé le nom de Gethsémané,
car il
signifie effectivement "pressoir à huile".
La grotte du jardin des
Oliviers,
où le Christ
aurait été arrêté
(christusrex.org).
Jésus fut d'abord conduit au domicile du
grand-prêtre
Caïphe, où le conseil des prêtres (Sanhédrin) s'était réuni. Ce conseil
religieux exerçait une autorité pour faire appliquer la loi juive. Il
déclara
que le prisonnier méritait la mort parce qu'il avait blasphémé.
Cependant le
clergé hébreu n'étant pas habilité à prononcer la peine capitale, Jésus
fut
présenté à l'autorité romaine qui seule décidait de la vie ou de la
mort.
Le tombeau de Caïphe
La sépulture de l’un des principaux
acteurs du procès fut découverte en 1990 dans un jardin public du sud
de la
ville. En effectuant des travaux de nivellement, des ouvriers
provoquèrent un
affaissement de terrain qui fit apparaître un vaste caveau funéraire
antique.
Le
service des antiquités d'Israël confia l'étude du site à l'archéologue
Zvi
Greenhut. Il s'agissait d'une sépulture juive du Ier siècle, de
conception
classique mais qui allait révéler un objet inattendu. Des douze
ossuaires
taillés qui renfermaient les restes de soixante-trois personnes, le
plus
richement décoré d'entre eux portait gravé sur un côté le nom de son
occupant :
« Joseph, fils de Caïphe ».
Les
ossuaires sont des sarcophages de petite taille dans lesquels les
ossements des
morts étaient regroupés plusieurs mois après leur première inhumation,
de
manière à libérer de la place dans les nécropoles pour les personnes
nouvellement décédées.
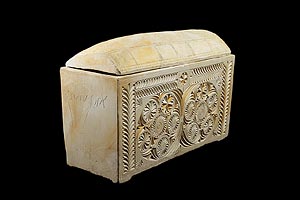
L'ossuaire
du grand-prêtre
Caïphe
(interbible.org). | 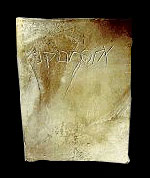
L'inscription
de l'ossuaire du
grand-prêtre Caïphe
(formerthings.com). |
Nous
savons grâce à Flavius Josèphe (Ant. Jud. 18, 2,2 ; 4,3) que
l'expression
« Joseph, fils de Caïphe » est précisément le nom complet du
grand-prêtre Caïphe qui selon les évangiles dirigea le procès juif
contre
Jésus. Cet ossuaire renfermait le corps d'un homme d'une soixantaine
d'années,
probablement l'un des responsables de la condamnation de Jésus.
Caïphe occupa le poste
de grand-prêtre du Temple entre l'an 18 et l'an 36. Il avait épousé la
fille
d'Anne, un autre chef d'un parti de prêtres. D'après les évangiles, il
justifia
le procès pendant une réunion secrète en déclarant qu'il « était préférable qu'un homme meure plutôt
que la nation toute entière ». C'est chez lui que Jésus fut
retenu
après son arrestation, et qui lui demanda s'il était le messie d'Israël.
Jésus
au prétoire : le procès romain
Le gouverneur
romain Ponce Pilate qui
siégeait dans le prétoire (le palais du prêteur), fut embarrassé par le
cas de
ce prisonnier qui lui semblait innocent. Apprenant que Jésus était
originaire
de Galilée, il le fit transférer vers le tétrarque de Galilée, Hérode
Antipas,
de passage à Jérusalem. Celui-ci ne voulut pas le condamner non plus et
renvoya
le prisonnier vers Pilate. Les prêtres et le peuple juif insistèrent
alors
lourdement auprès du romain pour que Jésus fût condamné à la croix. Ils
arguèrent du fait que Jésus s'était déclaré "roi des Juifs", alors
que le seul roi légitime était César. Pilate finit par céder sous la
pression
de la foule, et la sentence de mort par crucifixion fut prononcée. Il
rendit
son jugement depuis un tribunal séparé appelé Lithostratos,
c'est-à-dire "siège de pierre".
Une tradition
répandue identifie le prétoire à la forteresse Antonia, un bastion
militaire
qui se dressait à l'angle nord-ouest du mont du Temple. Ce terrain est
aujourd'hui occupé par le monastère des soeurs de Sion, ou couvent de l'Ecce homo, bâti au XIXème siècle sur
un site où subsistent des vestiges romains. Le sous-sol du couvent
contient un
lieu assimilé au Lithostratos, une
grande salle où subsiste aujourd'hui un dallage romain. Des graffiti
gravés sur
le sol figurent le "jeu du roi" que les légionnaires devaient pratiquer
pour s'occuper. On reconnaît le tracé de la lettre B qui pourrait être
l'initiale du mot Basileus (roi, en
grec). Au niveau le plus bas subsiste la "citerne de Strouthion", un
réservoir d'eau voûté qui alimentait probablement la garnison romaine.
Au
sous-sol toujours, une cellule de prison porte l'inscription grecque :
"Prison du Christ", où Jésus aurait été enfermé et maltraité.
Cependant rien de tout cela n'est attesté, car le prétoire pourrait
tout aussi
bien se trouver dans le palais d'Hérode le Grand implanté à l'ouest du
mont du
Temple.

La
salle de la forteresse Antonia,
lieu du procès de Jésus
(christusrex.org).
| 
Graffiti
romains visibles sur le dallage
de la
forteresse
Antonia
(christusrex.org).
|
La stèle de Ponce Pilate
Des informations historiques
sur
le
gouverneur Ponce Pilate sont fournies par des auteurs anciens comme
Tacite,
Philon d'Alexandrie et Josèphe, ainsi que par quelques pièces de
monnaie émises
sous sa législature. L'existence de Pilate a également été confirmée en
1961,
par une stèle trouvée dans la ville de Césarée maritime, à
quatre-vingts
kilomètres à l'ouest de Jérusalem. Cette cité construite sur la
côte
méditerranéenne avait été bâtie par le roi Hérode le Grand au service
de
l'occupant romain. Lorsque les archéologues italiens fouillèrent
Césarée,
l'équipe du docteur Antonio Frova dégagea un ancien théâtre, au milieu
duquel
trônait une dalle de calcaire de réemploi portant l'inscription latine
suivante
: "Tiberieum, Pontius Pilatus,
Prefectus Iudea", c'est-à-dire : "A Tibère, Ponce Pilate, préfet
de Judée".
Il est intéressant de
remarquer que l'historien
Tacite donne
par erreur à Pilate le titre de procurateur. La présente inscription
"rétablit" Pilate dans sa fonction de préfet ; en effet le titre de
préfet disparut à la fin du premier siècle, remplacé par celui de
procurateur. Les
évangiles, quant à eux, emploient simplement le terme de gouverneur.

La stèle de Ponce Pilate,
découverte dans le théâtre de Césarée
(worshipexcellence.org).
Le
jour du dernier repas
Si le récit de la Passion de
Jésus de Nazareth est rapporté en détail, il donne en revanche assez
peu
d'informations permettant d'en connaître la date exacte. Les
historiens qui ont essayé de la calculer se
sont plongés dans de difficiles reconstitutions du calendrier. L'un
des problèmes rencontrés
concerne le déroulement de la semaine sainte qui précède la
condamnation, car
le calendrier recèle une contradiction : alors que les trois premiers
évangiles
font de la Cène un repas pascal (Mt. 26,17 ; Mc. 14,12 ; Lc. 22,7),
l'évangile
selon saint Jean place le dernier repas un ou plusieurs jours avant la
fête de
la Pâque (Jn. 13,1 ; Jn. 18,28).
D'autres
incohérences ont été relevées dans le récit. Habituellement, la
liturgie
chrétienne célèbre le dernier repas pascal de Jésus le jeudi saint, et
sa mort
le lendemain vendredi saint. Le problème tient au laps de temps écoulé
entre
son arrestation et son exécution, délai qui peut paraître bien court
pour un
déroulement complet du procès. En l'espace d'une nuit, Jésus aurait été
transféré chez l'ancien grand-prêtre, puis chez le nouveau, puis deux
fois au
prétoire où siégeait Pilate, et entretemps chez Hérode ... Il faut
aussi tenir
compte de certaines lois et pratiques juives qui figurent dans le
Talmud :
interdiction pour un tribunal de siéger la nuit, interdiction de
condamner à
mort un prisonnier en moins de vingt-quatre heures, et interdiction de
condamner à mort une veille de sabbat.

Prison supposée du Christ,
proche de la
forteresse Antonia
(christusrex.org).
Une
solution élégante a été proposée en 1959 par une spécialiste de
l'exégèse
biblique et chercheuse au CNRS, Annie Jaubert. Elle a publié une étude
remarquable qui permet de lever la contradiction tout en étalant
davantage dans
le temps le récit du procès. Son travail se fonde sur une information
déterminante fournie par les manuscrits de la mer Morte.
En
effet, les rouleaux de parchemin découverts à Qumran nous apprennent
l'existence
d'un deuxième calendrier hébreu utilisé au temps de Jésus. Les
incohérences
tombent si l'on suppose que les quatre évangélistes n'ont pas utilisé
le même
calendrier. Cette hypothèse met les quatre textes d'accord en proposant
que la
Cène se soit déroulée non pas le jeudi, mais le mardi. De ce fait, les
contradictions disparaissent, les délais sont respectés et le
déroulement
devient plausible.
La
thèse est en outre appuyée par des témoignages chrétiens très anciens,
comme la
Didachè des apôtres, un texte catéchétique du Ier ou du
IIème siècle
retrouvé en 1873 à Constantinople. Ce document semble indiquer qu'au
temps de
l'Eglise primitive la Cène était célébrée le mardi soir. Si Jésus prit
réellement son dernier repas pascal un mardi, il aurait donc passé deux
jours
en captivité.
Le résultat de ce travail a emporté de nombreux
suffrages chez les exégètes, y compris même au sein du Vatican.
Toutefois,
cette conclusion risque de perturber les habitudes de la pratique
chrétienne.
Faut-il pour autant remettre en question le calendrier liturgique
actuel de
Pâques ? Pas nécessairement : celui-ci a une vocation de célébration
plutôt que
de reproduction rigoureuse des faits.
Références :
[1] - J. Abela, E. Alliata, E.
Bermejo : "Christian Mount
Sion". Franciscan Cyberspot, march 24, 2005.
[2] - J. Abela : "The Garden
of Gethsemane - Kidron Valley part I". Franciscan Cyberspot,
January 6, 2002 (christusrex.org).
[3] - Bernard-Marie (fr.) : "Le
cinquième Evangile,
d'après les agrapha et quelques mystiques". Presses de
la
Renaissance, Paris 1998. Imprimatur 1997.
[4] - Terrien S. : "Les pays
bibliques". Deux Coqs
d'Or, Paris 1977.
[5] - "The
"Holy Prison". The area of the Antonia Fortress". Franciscan
Cyberspot, January 6, 2002 (christusrex.org).
[6] - F. Manns : "Les témoignages
archéologiques
liés à la vie de Jésus". Dossiers
d'archéologie n°249, déc. 1999.
[7] - J. Abela : "The meaning
of the Way of the Cross". Franciscan Cyberspot, January 6, 2002
(christusrex.org).
[8] - "Lithostrotos
- Citerne de Strouthion". Couvent de l'Ecce
Homo, 3 déc. 2008
(eccehomoconvent.org).
[9] - K.N. Schoville : "Top Ten
Archaeological Discoveries of the Twentieth Century Relating to the
Biblical World" (biblicalstudies.info).
|