|
L'histoire du roi Salomon
relatée dans la Bible contient l'épisode
fameux de sa rencontre avec la reine de Saba, une souveraine étrangère
qui avait
entendu parler de sa renommée et qui se déplaça pour connaître sa
sagesse
légendaire. Elle se rendit à Jérusalem "par la route de l'or et de
l'encens",
accompagnée d'une longue suite. Elle fut reçue avec les plus grands
honneurs
par le roi d'Israël, et fut témoin de ses richesses et de son prestige
intellectuel. L'ayant interrogé avec ses questions énigmatiques, elle
obtint
des réponses brillantes qui confirmèrent sa réputation de sagesse à un
point qui
dépassa ce que la reine avait auparavant entendu dire. De grandes
quantités de
présents furent échangés entre les souverains avant que la reine ne
reparte vers
son pays (1 R. 10, 1-13 ; 2 Chr. 9, 1-2).
De cet énigmatique
royaume de
Saba, la Bible ne dit rien sinon que la reine avait fait un long voyage
chargée
de denrées luxueuses : or, pierres précieuses et parfums. L'évangile
selon
saint Luc (11, 31) l'appelle "reine du Midi", impliquant qu'elle
venait du Sud. L'emplacement véritable de son royaume teinté d'exotisme
est
longtemps resté une énigme. Le nom de la souveraine elle-même demeure
inconnu,
même si plusieurs légendes tentent de combler ce vide, telle une
tradition
arabe qui la nomme Belqis.
Une hypothèse
longtemps défendue situe
le pays de Saba en Ethiopie, selon une tradition africaine locale
solidement établie. La littérature éthiopienne a brodé sur ce thème,
ajoutant
même que la rencontre des deux souverains aurait donné naissance à un
fils appelé
Ménélik. L'enfant serait devenu plus tard roi d'Ethiopie, son pays
pouvant dès
lors revendiquer une filiation avec le peuple hébreu. Quoique rien de
tout cela
n'apparaisse dans la Bible, cette version alimente le fonds culturel
éthiopien
depuis des siècles.
Une autre piste de
recherche qui
s'est avérée plus proche du récit de l'Ecriture est celle du sud de la
péninsule arabique. Cette région, le Yémen actuel, est longtemps restée
isolée
du monde occidental. Elle fut explorée en 1843 par le voyageur français
Thomas
Joseph Arnaud, premier Européen à pénétrer dans l'ancienne capitale du
Yémen,
Marib [1]. Il
en revint chargé de copies qu'il avait faites de dizaines
d'inscriptions
anciennes trouvées sur place. Par la suite le Français Joseph Halévy et
l'autrichien
Eduard Glaser lui succédèrent et parcoururent l'ancienne cité au péril
de leur
vie, le pays étant interdit d'accès aux Occidentaux. Ils rapportèrent
de
nouvelles copies et empreintes de documents écrits.
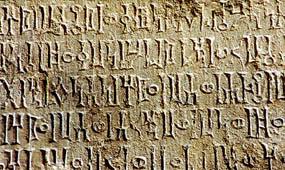 Ecriture
alphabétique du pays yémenite
Ecriture
alphabétique du pays yémenite
(helga.com ; © 1998 Helga Tawil).
L'écriture yéménite
antique était
totalement inconnue et la signification des textes reproduits demeurait
obscure.
Elle le resta jusqu'à ce que vers 1870 le mystère de son déchiffrement
fut percé,
grâce au travail de plusieurs savants et notamment des Allemands
Gesenius, Rödiger
et Osiander [2]. La traduction des copies
de documents fut effectuée et permit d'esquisser l'histoire de ce pays
depuis
les temps les plus anciens.
Ainsi sortirent de
l'oubli les
noms de quatre royaumes antiques qui se partageaient la péninsule
méridionale :
Minéa, Kataban, Hadramaout et ... Sheba. Le lien fut immédiatement
établi entre
Sheba et le royaume biblique de Saba, qui avait donc bel et bien eu une
réalité
historique [3][4][5]. La
tradition des Ecritures était vérifiée, mais aucune information
n'émergea quant
au personnage d'une reine qui aurait rencontré un roi d'Israël.

Carte du
Yemen, où se situait
l'ancien royaume de
Saba
(longpassages.org).
| 
Les ruines
de Marib
(ftiyemen.com).
|
Les
explorations et les fouilles effectuées au Yemen ont néanmoins permis
de redécouvrir
le patrimoine de ce pays. Plusieurs missions archéologiques furent
organisées
au XXème siècle dans des conditions encore périlleuses, dues aux
risques
d'attaques venant des tribus nomades. En 1951, une expédition dirigée
par l'archéologue
américain Wendell Phillips entama des fouilles à Marib, mais fut
contrainte
d'abandonner précipitamment le terrain à la suite d'un incident avec
les
bédouins. Le site fut abandonné au pillage, et les fouilles
clandestines
alimentèrent le marché noir, détruisant peu à peu le patrimoine
archéologique du
Yemen. En 1998 cependant, le gouvernement yémenite s'en inquiéta et
invita la
Fondation Américaine pour l'Etude de l'Homme, présidée par Merylin
Phillips
Hodgson (la sœur de Wendell Phillips) à reprendre les fouilles
interrompues sur
le site de la capitale du royaume de Saba [6]. Les
recherches n'en sont encore qu'à leurs débuts tant la tâche est immense.

Ruines du
temple de Haram Belqis
(al-bab.com
; © Yemen Explorer Tours).
| 
Une citerne
au royaume de Saba
(longpassages.org).
|
Sur une
colline perdue en plein désert, l'ancienne cité de Marib se présente
comme un étonnant
groupe d'habitations à étages, en partie ruinées et aux silhouettes
fantomatiques. Dans l'Antiquité la ville était entourée d'une muraille
puissante
digne de son statut de capitale. Si l'on s'éloigne de quatre kilomètres
vers le
sud-est de la ville, on rencontre également les ruines d'un temple
vieux de
3000 ans : le Mahram Belqis. Ce sanctuaire est repérable de loin par un
alignement de piliers carrés que complètent les fondations d'un
bâtiment
imposant et une vaste enceinte de forme ovale.
La région
de Marib se caractérise par un autre ouvrage remarquable. Sur le cours
du
fleuve Adhanat, les anciens Sabéens avaient bâti un barrage monumental
qui devait
permettre une irrigation intensive des terres et favoriser une
production agricole
abondante. La culture des épices permit à Marib d'atteindre un haut
niveau de
prospérité économique, les échanges commerciaux se faisant par la
"route
des épices" qui longeait les côtes arabes méridionales depuis l'Inde
jusqu'au
nord du Proche-Orient. Marib alimentait un trafic incessant de
caravanes chargées
de matières précieuses.

Vue aérienne du temple
de
Mahram Belqis
(redicecreations.com).
La documentation
actuellement disponible a permis de reconstituer les grandes lignes de
l'histoire
de Saba. L'existence d'un "royaume de Sabum" est mentionnée vers 2500
av. J.-C. dans une inscription de l'un des premiers rois sumériens
d'Ur, Arad-Nannar,
mais son identification avec l'Etat de Saba est discutée [7][8].
Celui-ci
n'est attesté de façon certaine qu'au VIIIème siècle av. J.-C., soit
deux cents
ans après Salomon. L'Etat de Saba apparaît en effet dans des
inscriptions assyriennes
en 733 av. J.-C., lorsque le roi sabéen paye un tribut au puissant roi
Téglat-Phalasar.
Peu de temps après, vers 689, le royaume de Saba prit le contrôle de
ses
proches voisins, sous la conduite du roi Karib'il Watar qui fonda le
premier
Etat yéménite unifié avec Marib comme capitale.
Quarante-cinq
rois ont régné sur les Etats du Yémen antique. La puissance de Saba
déclina
autour du VIème siècle avant notre ère lorsque la route des épices
changea
d'itinéraire, provoquant le déclin et l'abandon de Marib. A la même
époque, les
principautés rivales d'Hadramaout et de Qataban imposèrent à leur tour
leur suprématie
sur l'Arabie du Sud. L'empire romain ne parvint pas à s'implanter dans
la
péninsule. Après de brèves tentatives de retour en force, le royaume de
Saba
disparut progressivement entre le IIIème et le VIème siècles de notre
ère.

Restes de l'ancien
barrage de Marib
(26sep.net).
Le lien
avec l'Ancien Testament est peu documenté. L'existence d'une reine de
Saba contemporaine
de Salomon n'a pas laissé de traces archéologiques connues, d'autant
que les témoignages relatifs à un royaume de Saba déjà constitué au
Xème siècle sont rares. Néanmoins
la ville de Marib était probablement déjà en place à cette époque, le
début de
l'occupation du temple du Mahram Belqis se plaçant entre 1200 et 550
av. J.-C.
d'après les fouilles.
En 2010, l'épigraphiste
français André Lemaire publia une étude concernant une plaque de bronze
sabéenne,
gravée d'un texte qui rend compte d'un voyage commercial entre l'Arabie
du sud
et les "villes de Juda". Signé d'un messager du roi sabéen Yada il
Bayin, elle mentionnait une expédition importante vers "Dedan, Gaza et
les
villes de Juda". Lemaire fait remonter cet objet aux alentours de l'an
600
av. J.-C. [9]. Le
fait que des relations commerciales judéo-sabéennes étaient déjà
établies à
cette date permet d'envisager l'existence de contacts plus anciens. Le
paysage
économique du célèbre voyage de la reine de Saba en pays israélite ne
relève peut-être
pas entièrement du mythe.
Références :
[1]- J. Donnett : "Archaeology. Quest for
a
Queen". Frontline, Vol. 19, Iss. 3, Feb. 02 - 15, 2002
(frontlineonnet.com).
[2] - "Sabaeans". The 1911
Classic
Encyclopaedia (1911encyclopedia.org).
[3] - W. Keller : "La
Bible arrachée aux sables". Famot, Genève 1975.
[4] - M. Arbach : "Une
reine en Arabie du Sud ?" Chroniques yéménites, 12 / 2004
(cy.revues.org).
[5] - "Yémen, au pays de
la reine de Saba" (imarabe.org).
[6] - A. Wark : "Arabian
desert surrenders Queen of Sheba's secrets". University of Calgary, sept. 2000
(ucalgary.ca).
[7] - H. Yahya : "Les
nations disparues", ch. 7, Le peuple de Saba et l'inondation d'Arim
(nationsdisparues.com).
[8] - M. Arbach : "La
situation politique du Jawf au Ier millénaire avant J.-C.". Chroniques
yéménites, 11 / 2003 (cy.revues.org).
[9] - A; Leamire : "Solomon &
Sheba, Inc." Biblical Archaeology Review Jan/Feb
2010, Vol 36 No 1, pp. 54-59 ; 82.
|
|