|
La
situation politique de la Terre sainte au début de l'époque romaine est
décrite
par les auteurs de l'Antiquité, en particulier l'historien Flavius
Josèphe
(37-100).
Le
royaume israélite indépendant qu'avaient reconstitué les rois-prêtres
hasmonéens au IIe siècle av. J.-C. ne résista pas aux ambitions de
l’empire
romain. En 63 av. J.-C., le général Pompée, qui venait de conquérir la
Syrie,
fut appelé comme arbitre par les deux princes hasmonéens Aristobule II
et
Hyrcan II pour désigner celui qui accèderait au trône. Pompée se
prononça pour
Hyrcan II, mais en profita pour s'emparer de Jérusalem avec l’aide de
ses
légions. Le nouvel occupant partagea le territoire israélite en trois
parties,
confiant la Judée et la Galilée à Hyrcan II et rattachant la Samarie à
la
province romaine de Syrie.
Trois grandes zones
géographiques divisaient désormais le pays des Hébreux. Au Sud, la
Judée
désignait l'ancien royaume de Juda, entre la mer Morte et la
Méditerranée. Au
Nord, la Galilée s’étendait sur la région située à l'Ouest du lac de
Tibériade.
Entre les deux s'insérait la Samarie, qui correspondait plus ou moins à
l'ancien royaume schismatique d'Israël.
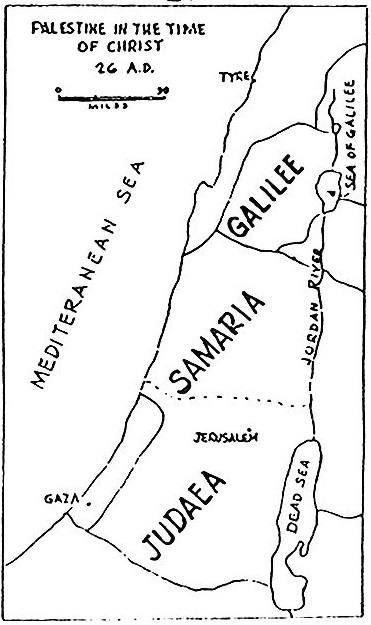
La
Terre sainte à l'époque romaine
(answering-islam.org).
Après
la défaite de Pompée devant Jules César, l'un des ministres de Hyrcan
II, un
prince édomite nommé Antipater, obtint la royauté au profit de son fils
Hérode.
En 40 avant J.-C, le futur Hérode le Grand se rendit à Rome où il fut
nommé roi
de Judée par Antoine et Octave.
De
retour en Judée, Hérode eut un rival à combattre, le roi hasmonéen
Antigone II,
fils d’Aristobule II. Avec l'appui des troupes romaines, il réussit à
le
repousser et à prendre le contrôle de la plupart des territoires que lui octroyait le pouvoir romain.
Son
sceptre réunissait un vaste domaine qui s'étendait de l'Edom, au Sud de
la mer
Morte, jusqu'à la Galilée, en couvrant la Judée et la Samarie. A cet
ensemble
s'ajoutaient d'autres régions situées à l'Est du Jourdain : la
Pérée au
Nord-Est de la mer Morte, et plusieurs territoires de Syrie au-delà du
lac de
Galilée. Israël n’avait jamais connu un royaume aussi étendu depuis
l’époque de
David.

Etendue
du royaume d'Hérode le Grand
(jewishvirtuallibrary.org).
Hérode
qui n'était pourtant pas juif mais édomite, voyait sa légitimité
contestée.
Cette situation semble expliquer sa crainte maladive des complots et la
politique
sanguinaire qu'il mena, faisant assassiner tous les suspects présumés
jusque
dans sa propre famille. Sa première épouse et trois de ses fils
perdirent leur
vie à cause de son caractère suspicieux.
Ces
crimes n'empêchèrent pas Hérode d'être par ailleurs un bâtisseur
ambitieux, qui
entreprit et réalisa un programme de travaux proprement gigantesques.
L'oeuvre
architecturale d'Hérode le Grand est impressionnante. Sa volonté fut
d'abord de
reconstruire une ancienne ligne de défense hasmonéenne implantée de
part et
d'autre du Jourdain. Il fit ainsi élever des forteresses imposantes
comme
celles de Massada sur la rive ouest de la mer Morte, Machéronte en
Transjordanie, l'Hérodion au Sud de Bethléem et Antonia en plein coeur
de
Jérusalem. L'intérieur de ces places fortes fut aménagé en palais
somptueux mis
à la disposition de la famille royale.

Le roi Hérode
le Grand
(israelandstuff.com).
A
côté de ces ouvrages de défense, Hérode entreprit la construction de
villes
nouvelles dotées de bâtiments monumentaux. Sur la côte méditerranéenne,
il
fonda Césarée Maritime en l'honneur des empereurs romains. La nouvelle
cité fut
dotée d'un hippodrome, d'un théâtre, d'un amphithéâtre, d'un port
artificiel,
d'un temple et d'un palais en avancée sur la mer. La ville devint
rapidement
une cité commerciale de premier plan, et servirait plus tard de lieu de
résidence principale aux gouverneurs romains.
Hérode
bâtit également la ville de Sébaste (nom qui signifie
« Auguste » en
grec) sur l'ancienne cité de Samarie. Construite selon le modèle
gréco-romain, cette
cité vit s'élever un temple païen à la place de l'ancien palais
d'Achab, roi
d'Israël. Enfin, il fit construire en un lieu nommé Panium
proche du mont Hermon et des sources du Jourdain, un
magnifique temple romain en marbre blanc.
Mais
le chantier le plus important fut sans doute la reconstruction du
Second Temple
de Jérusalem, qui remplaçait celui de Salomon. Les nouvelles dimensions
de l’édifice
et les moyens employés pour le réaliser furent colossaux. Terminé
seulement
après sa mort, le Temple d’Hérode fut au service du culte juif et
accueillit
d'innombrables pélerins au moment des fêtes juives.
Hérode décéda
vraisemblablement en l'an 4 avant J.-C. Il laissait derrière lui des
édifices
monumentaux et le souvenir d'un roi cruel et mégalomane, très jaloux de
son
autorité mais en même temps fidèle à Rome et respectueux des traditions
juives.
Sa politique religieuse ambiguë soutenait à la fois les cultes païens
et le
monothéisme israélite.
Le Temple d’Hérode le Grand
L’oeuvre
majeure d’Hérode le bâtisseur est sans doute la reconstruction du grand
et
unique sanctuaire de Jérusalem. Le Premier Temple du roi Salomon avait
été
abattu par les Babyloniens en 587 av. J.-C., et un second fut construit
à sa
place après le retour de l’exil en 516 av. J.-C. Hérode entreprit de
restaurer
et d’agrandir ce Second Temple à partir de l'an 19 avant notre ère.
Implanté
comme le précédent sur l’actuelle esplanade des mosquées, il fut achevé
en une
quarantaine d'années.
Les informations dont
nous disposons sur ce monument proviennent essentiellement des écrits
de
Flavius Josèphe [1] et de la Mishna rabbinique.
Sa reconstruction nécessita des travaux encore
plus conséquents que pour le premier. L'esplanade fut pratiquement
doublée de
surface, ce qui nécessita le creusement de la colline rocheuse au Nord
et
l'agrandissement du remblai au Sud. La nouvelle cour fut entourée d'un
mur de
soutènement cylopéen qui la maintenait sur quatre côtés. L'esplanade se
divisait en plusieurs zones, d'abord le « parvis des
gentils »,
c'est-à-dire des païens, puis une zone accessible aux seuls Juifs,
elle-même
compartimentée en parvis réservés aux hommes, aux femmes et aux
prêtres. C'est
dans ce dernier périmètre qu'était bâti le Temple proprement dit.

Maquette
du Second Temple au musée d'Israël
(fr.wikipedia.org).
Les
architectes s’inspirèrent
plus ou moins fidèlement de l'ouvrage de Salomon. Plus grand que le
premier
avec ses cinquante mètres de haut, cinquante mètres de long, cinquante
mètres
de large en façade et trente-cinq à l'arrière, il était également
subdivisé
intérieurement en trois salles : porche, lieu saint et lieu très
saint. Ce
dernier était séparé du précédent non plus par une porte mais par un
rideau, et
n'était plus occupé par l'Arche d'Alliance qui avait depuis longtemps
disparu.
La
vaste cour extérieure communiquait avec le reste de la ville par huit
portes.
Celles du Sud-Ouest donnaient sur des escaliers d'accès supportés par
des
arches dont les extrémités sont encore visibles aujourd'hui, l'arche de
Wilson
et l'arche de Robinson. La partie sud-est du remblai est encore
soutenue
aujourd'hui par un réseau caché de piliers et d'arches souterrains, qui
forment
une vaste salle portant l'appellation impropre d' « écuries de
Salomon ».

Vestige de l'Arche de Robinson,
ayant supporté un escalier d'accès
au Temple
(mc-rall.de).
De
ce Second Temple relevé par Hérode, il ne reste rien aujourd'hui si ce
n’est une
portion de son mur de soutènement, le fameux « mur des
Lamentations »
ou Kotel. Visible de l'extérieur par sa face sud-ouest, c’est devant
lui que les
Juifs du monde entier viennent se recueillir. Ce vestige symbolique est
un lieu
de première importance pour la communauté juive actuelle.

Le Mur des Lamentations,
seul
vestige actuel du second Temple
(ebibleteacher.com)
Les recherches
contemporaines menées par les archéologues israéliens se sont
concentrées autour
du mur de soutènement de l'esplanade des mosquées. Des fouilles furent
conduites
au Sud du mont du Temple à partir de 1968 par le professeur Benjamin
Mazar, de
l'Université hébraïque de Jérusalem. Elles ont permis de dégager des
vestiges
d’époque romaine, des ruelles pavées et entourées de boutiques
couvertes, des
restes d'habitations et un large escalier d'accès à la face sud du mont
du
Temple. Quelques éléments exhumés à cette occasion semblent provenir du
Temple
d'Hérode. Ainsi une grande pierre taillée en angle et portant une
courte
inscription signifiant « ... à la place des trompettes »
fut-elle
identifiée à la pierre d'angle du parapet d'où un prêtre venait
rituellement
sonner de la trompe. Un autre bloc porte également une inscription
gravée en
grec interdisant l'entrée du sanctuaire aux non-juifs. Il s'agit sans
doute
d'une portion du parapet qui séparait la cour des gentils des
différents parvis [2].

Pierre
gravée datant du Second Temple
(theosophical.wordpress.com).
Un
tunnel permet aujourd'hui de longer la base du mur occidental, depuis
le Kotel
jusqu'à l'extrémité nord de l'enceinte. Il a été creusé à la demande du
rabbin
Meir Yehuda Guetz afin d'explorer les fondations enfouies du mur de
soubassement. Ce travail a permis de constater que la maçonnerie était
entièrement hérodienne, et laisse songeur quant à l'ampleur des moyens
employés. Les blocs taillés sont des monolithes géants, polis avec soin
et
reliés entre eux par des attaches métalliques. Le plus volumineux de
ces blocs
cyclopéens ne mesure pas moins de treize mètres de long ! Ce gigantisme
dans la
méthode de construction est à la hauteur des ambitions hérodiennes.

Un bloc cyclopéen
appartenant aux fondations
de l'ancienne
muraille extérieure
(mc-rall.de).
Le tombeau d'Hérode
Parmi les autres constructions
du mégalomane roi Hérode Ier, le palais de l’Hérodion s’éleva sur une
colline
artificielle au sein de laquelle sa sépulture fut également aménagée.
Ce palais
est décrit par l'historien Flavius Josèphe, qui relate également la
mort et les
funérailles du monarque qui se déroulèrent au pied de la colline de
l’Hérodion.
Le
site de l'Hérodion est identifié depuis le XIXe siècle, près de
Bethléem, à une
douzaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Il fut fouillé dès les
années 1960
par les moines franciscains dirigés par le père Virgilio Corbo, puis à
partir
de 1972 par l'équipe israélienne du professeur Ehoud Netzer, de
l'université
hébraïque de Jérusalem. Ce dernier espérait réaliser un vieux
rêve :
retrouver la tombe d’hérode le Grand.
La colline de
l'Hérodion a la forme d'un cône tronqué, au sommet duquel subsistent
les ruines
d'une imposante forteresse circulaire renfermant un somptueux palais.
Au pied
de la colline, un immense complexe architectural était implanté,
également
hérodien, complété par de vastes jardins et une longue allée. Ces
vestiges ont
été longuement fouillés, à l'exception de la tombe royale dont
l'emplacement
restait inconnu.
La
recherche de la sépulture d'Hérode fut une longue quête qui demeura
longtemps
infructueuse. Les archéologues commencèrent par fouiller l'extrémité de
l'allée
majestueuse aménagée au pied de la colline, mais cette voie ne menait à
aucune
sépulture.

La colline
de l'Hérodion
(bibliatheologica.blogspot.com). | 
Les
fouilles de l'Hérodion
(mfa.gov.il). |
Ehoud
Netzer fit fouiller partout, dans la plaine et au sommet de l'Hérodion,
employant des techniques modernes comme celle des sondages
géophysiques.
Ceux-ci permirent effectivement de déceler l'existence d'une cavité
souterraine, mais on n'en trouva jamais l'accès et elle fut finalement
délaissée.
En
2007, les fouilles étant toujours sans résultat, on se mit à prospecter
également sur les flancs de la colline. C'est alors qu'à proximité d'un
large
escalier
qui gravissait la pente, son équipe commença à trouver des
fragments
éparpillés de pierre ocre finement sculptés. Peu à peu apparurent les
débris
dispersés d'un volumineux sarcophage de calcaire rose, décoré de
magnifiques
rosaces. Bien qu'il fût exempt de toute inscription, la qualité et le
soin
apportés à ce cercueil incitèrent Netzer à l'attribuer au roi Hérode de
Judée.
Autour
de la sépulture furent encore trouvés les fragments de deux autres
sarcophages
plus sobres, ainsi que les pierres d'un monument en ruines. On esquissa
alors
un plan d'ensemble du tombeau. C'était un mausolée haut de vingt
mètres, qui
avait contenu trois chambres superposées, chacune ayant dû abriter l'un
des
trois cercueils.
En l'absence de toute
inscription ou ossement, les deux autres sarcophages furent attribués à
des
membres de la famille d'Hérode. Bien qu'elle ait été retrouvée en
miettes, la
découverte de cette tombe avait résolu une énigme vieille de plus de
trente
ans.

Ehoud
Netzer et
un fragment du sarcophage
(decouvertes-archeologiques-en-images.blogspot.com). | 
Reconstitution
du sarcophage
(foxnews.com). |
Mais
la colline de l'Hérodion n'avait pas fini de révéler ses secrets. De
l'autre
côté de l'escalier, un autre ouvrage inattendu fut exhumé, rien de
moins qu'un
amphithéâtre de quatre cent cinquante places orienté vers la plaine.
Apparut
alors la partie la plus magnifique de tout le site : la loge
royale qui
trônait à son sommet, et dont les parois intérieures étaient
recouvertes de
splendides fresques polychromes. De fausses fenêtres peintes en
trompe-l'œil
s'ouvraient fictivement sur des paysages imaginaires et fabuleux,
représentant
des mers et des îles, des plantes et animaux, des navires et des
personnages.
Même s'il n'y a pas de
preuve absolue, tous ces aménagements traduisent la volonté d'un
commanditaire
richissime que l’on peut raisonnablement identifier au roi Hérode Ier.
Si tel
est le cas, ce site montre que l'un des plus cruels monarques de
l'Antiquité a
fait preuve d'un goût artistique raffiné [3].
C'est
peu de temps avant sa mort que naquit le fondateur d'un nouveau courant
religieux, un Galiléen nommé Jésus.

Fresque de l'Hérodion
(news.nationalgeographic.com)
Références :
[1] - F.
Josèphe, "Antiquités Judaïques, 15" et
"Guerre des Juifs, 5".
[2] - A.
Altabé : "Le Beth Hamikdach, Temple de
Jérusalem" (www1.alliancefr.com).
[3] - E.
Netzer : "In Search of Herod's tomb", Biblical Archaeology
Review, january/february 2011, vol. 37 No 1,
pp. 36-48;70.
|
|